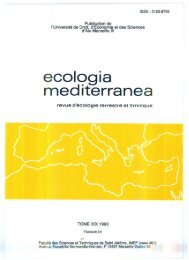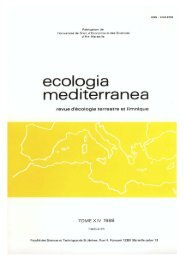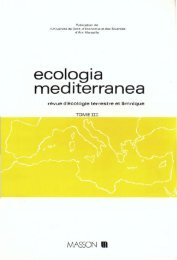Revue internationale d'écologie méditerranéenne Mediterranean ...
Revue internationale d'écologie méditerranéenne Mediterranean ...
Revue internationale d'écologie méditerranéenne Mediterranean ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Résumés de thèses<br />
sont précisées grâce à l’analyse conjointe des microfossiles<br />
non polliniques, des macrorestes végétaux et entomologiques,<br />
la caractérisation géochimique et géophysique des<br />
sédiments, la datation par le radiocarbone et le plomb 210,<br />
et enfin par confrontation avec les résultats des approches<br />
historique et archéologique.<br />
Les premiers signes d’impact humain sur la végétation sont<br />
ressentis dès la transition Mésolithique/Néolithique et le<br />
Néolithique ancien, y compris à très haute altitude. L’Âge<br />
du bronze et la période médiévale semblent marquer des<br />
phases d’occupation majeure, généralisées à l’ensemble du<br />
territoire. Les différences et asynchronismes observés entre<br />
sites soulignent un degré important d’hétérogénéité spatiale<br />
et pourraient suggérer d’abord l’existence de systèmes<br />
d’exploitation mobiles, puis un déséquilibre dans l’utilisation<br />
de l’espace montagnard depuis les 2 000 dernières<br />
années. Les épisodes de détérioration climatique ne paraissent<br />
pas avoir eu de répercussions importantes sur les activités<br />
anthropiques et la gestion du territoire par les sociétés<br />
alpines.<br />
Jean-François DEBRAS 2007<br />
Rôles fonctionnels des haies<br />
dans la régulation des ravageurs :<br />
le cas du psylle Cacopsylla pyri L.<br />
dans les vergers du sud-est de la France<br />
237 p.<br />
INRA.UR 1115 Plantes et systèmes de culture horticoles,<br />
F-84000 Avignon-France. Thèse d’université soutenue le<br />
27 septembre 2007 à l’université d’Avignon et des pays de<br />
Vaucluse, IUT d’Avignon.<br />
Jury – P r Thierry DUTOIT (IUT, université d’Avignon), président.<br />
René RIEUX (chargé de recherche, INRA, Avignon), codirecteur de<br />
thèse. P r Serge KREITER (SUPAGRO, Montpellier), rapporteur. D r Françoise<br />
BUREL (CNRS, Rennes), rapporteur. Luc BARBARO (chargé de<br />
recherche, INRA, Bordeaux) examinateur.<br />
Mots Clés : haie composite, écosystème, lisière, écotone,<br />
arboriculture, ravageurs, prédateurs, Cacopsylla pyri, Pyrus<br />
communis, forficules, arthropodes, protection intégrée,<br />
mouvements d’arthropodes, biodiversité.<br />
L<br />
’agriculture intensive est responsable de changements<br />
considérables dans les pratiques agricoles et la structure<br />
du paysage, la transformation des habitats, la simplification<br />
des systèmes agricoles. Si la lutte chimique à l’aide<br />
de pesticides de synthèse a longtemps été considérée<br />
comme la plus efficace, du moins dans le cadre d’une agriculture<br />
productiviste, les effets secondaires des pesticides<br />
sur l’environnement et la santé humaine ne s’avèrent plus<br />
compatibles avec une exploitation durable des écosys-<br />
102<br />
tèmes. Des solutions alternatives sont donc à rechercher.<br />
On est ainsi amené à concevoir une stratégie phytosanitaire<br />
nouvelle, reposant d’abord sur la gestion agro-écologique<br />
des populations et des peuplements avec une remise en<br />
cause des pratiques courantes, une adaptation des systèmes<br />
de culture et une prise en considération rationnelle des problèmes<br />
environnementaux à l’échelle du paysage.<br />
Dans le cadre de cette stratégie, les haies composites jouent<br />
un rôle de réservoir de biodiversité pour renforcer le peuplement<br />
des auxiliaires des monocultures adjacentes, mais<br />
très peu d’études ont été conduites pour identifier le rôle<br />
de réservoir d’auxiliaires des essences utilisées. C’est donc<br />
sur la base de critères totalement étrangers à cette fin que<br />
les végétaux à planter sont habituellement choisis. En<br />
outre, les risques dus à l’enrichissement éventuel en ravageurs<br />
potentiels sont difficiles à prendre en compte. L’optimisation<br />
du rôle des haies comme régulateur biologique<br />
naturel fait partie à part entière de cet objectif, pour cela il<br />
est nécessaire de connaître leur impact sur la régulation des<br />
ravageurs des cultures. La problématique générale de ce<br />
travail de thèse s’intègre dans les impératifs de la production<br />
fruitière intégrée (PFI) et s’inscrit dans la continuité<br />
des recherches sur la relation entre biodiversité et stabilité<br />
des agrosystèmes. L’objectif de notre recherche a pour but<br />
de mettre en évidence des mécanismes de régulation des<br />
populations, inhérents au fonctionnement des agrosystèmes<br />
haies/vergers, permettant de réduire la consommation de<br />
pesticides. La recherche de ces mécanismes est envisagée<br />
principalement au niveau de la parcelle élémentaire, formée<br />
d’un verger et de sa haie.<br />
Les travaux sur un rôle éventuel des haies restent encore<br />
assez peu nombreux, grâce à une approche multiscalaire<br />
notre étude a pour objectif de répondre à 4 questions fondamentales<br />
:<br />
1. Quel est l’impact des pratiques culturales sur la composition<br />
et la structuration des peuplements d’arthropodes<br />
des vergers en système bocager, par rapport aux variables<br />
écologiques liées à la distance et à la structure des haies ?<br />
2. Quel est l’impact de la haie sur la distribution des communautés<br />
d’arthropodes prédateurs du psylle ? Peut-on<br />
identifier un rôle de la haie dans le temps et l’espace ?<br />
3. La distribution du ravageur et de son entomofaune auxiliaire<br />
associée dans une parcelle est-elle corrélée à un<br />
effet de la haie différent des autres effets de bordure ou<br />
de lisière ?<br />
4. Quelles sont les modalités qui régissent les déplacements<br />
des auxiliaires de la haie vers le verger et plus particulièrement<br />
pour le modèle forficule ?<br />
Le chapitre I présente une étude dont l’objectif est de discriminer<br />
l’impact des variables « pratiques agricoles » par<br />
rapport aux variables « environnement des parcelles » sur<br />
le peuplement en arthropodes des vergers. Par pratiques<br />
agricoles, nous entendons essentiellement les différents<br />
modes de conduite des parcelles et les traitements phytosanitaires<br />
qui y sont associés et pour les variables environnementales,<br />
nous avons pris en compte les composantes<br />
végétales de l’environnement proches des vergers, « les<br />
haies ». Cinq sites avec trois modalités (agriculture conven-<br />
ecologia mediterranea – Vol. 33 – 2007