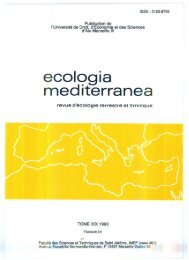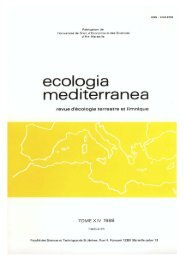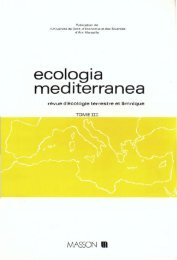Revue internationale d'écologie méditerranéenne Mediterranean ...
Revue internationale d'écologie méditerranéenne Mediterranean ...
Revue internationale d'écologie méditerranéenne Mediterranean ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Résumés de thèses<br />
conséquences. Nous assistons depuis cette époque à une<br />
bipolarisation progressive de l’espace rural marquée par<br />
une intensification de l’agriculture dans les zones les plus<br />
fertiles opposée à un abandon des zones les moins fertiles.<br />
À son tour l’abandon des pratiques agropastorales dans les<br />
zones marginalisées a pour conséquences majeures une<br />
extension des surfaces forestières. Ces transformations<br />
environnementales sont souvent diversement perçues,<br />
notamment dans les territoires à forte valeur culturelle, où<br />
la cessation des activités agricoles, l’uniformisation du paysage<br />
et la disparition des espèces animales et végétales<br />
inféodées aux milieux ouverts entraînent une perte de<br />
diversité et d’identité culturelle. A contrario ces nouveaux<br />
espaces forestiers peuvent permettre d’augmenter la « naturalité<br />
» des écosystèmes, contrecarrer la fragmentation des<br />
forêts, participer à la séquestration du carbone ou encore<br />
fournir un combustible renouvelable. Face à ses multiples<br />
conséquences économiques, sociales et environnementales,<br />
de nombreux problèmes de gestion se posent et il apparaît<br />
primordial d’étudier ses nouvelles forêts afin de pouvoir<br />
les gérer.<br />
Il faut pour cela tenter de préciser les mécanismes à l’origine<br />
des expansions forestières et notamment les modalités<br />
d’abandon (date, rythme, cinétique), mais également les<br />
modifications qu’ont subies les paysages et les peuplements<br />
forestiers qui le composent depuis cet abandon afin<br />
de comprendre les modalités d’extension et de maturation<br />
des peuplements forestiers. Nous devons comprendre plus<br />
particulièrement quels sont les effets des pratiques agrosylvo-pastorales<br />
passées et actuelles, du climat et des herbivores<br />
sur les peuplements forestiers et sur les individus<br />
qui les composent pour, à terme, pouvoir proposer des<br />
mesures de gestion.<br />
Dans cette perspective, nous nous sommes intéressés à la<br />
dynamique d’un paysage forestier des Préalpes françaises<br />
(montagne du Malay, camp militaire de Canjuers, Var).<br />
Afin de retracer l’histoire de ce paysage, nous avons analysé<br />
à la fois (I) l’histoire agricole locale par le biais des<br />
données cadastrales et des sources écrites, (II) la composition,<br />
la dynamique et la diversité des peuplements forestiers<br />
constituant le paysage grâce à une analyse dendrochrono-écologique<br />
(chapitre II). Le rôle éventuel des<br />
grands herbivores dans la gestion du milieu, notamment à<br />
travers le maintien du milieu ouvert, a également été<br />
exploré.<br />
L’analyse conjointe de l’histoire agricole de la structure et<br />
de la dynamique du paysage forestier nous a permis de<br />
montrer que non seulement la dynamique forestière dépend<br />
des dates d’abandon mais également que la composition et<br />
la diversité des arbres sont fortement dépendantes des<br />
anciens usages (chapitres III et IV). En effet, les usages<br />
anciens ont conditionné la disponibilité des essences lors<br />
de la colonisation forestière alors que les modalités d’abandon<br />
(date, vitesse et localisation) conditionnent fortement<br />
le déroulement temporel de la colonisation. Il en résulte<br />
que des différences d’utilisation ancienne et d’abandon se<br />
traduisent par des dynamiques forestières, des compositions<br />
et des biodiversités différentes. Les peuplements<br />
actuels pris individuellement sont, certes, peu diversifiés<br />
mais ils présentent de fortes différences entre eux ainsi<br />
qu’un fort potentiel de maturation du fait de la présence<br />
dans leur sous-bois de nombreux jeunes feuillus et de<br />
sapins. Le fort potentiel de maturation et de naturalité de<br />
ces peuplements et paysages nous pousse à préconiser la<br />
préservation et la gestion durable, respectueuse des équilibres<br />
écologiques, de certains de ces nouveaux territoires<br />
forestiers, en parallèle et au même titre que les actuelles<br />
conservation et gestion des milieux ouverts au bénéfice des<br />
seules espèces d’habitats herbacés.<br />
Actuellement, la montagne du Malay fait l’objet de mesures<br />
de gestion pour préserver les espaces ouverts favorables<br />
à la vipère d’Orsini. Dans cette optique, deux coupes forestières<br />
ont été réalisées et la pression pastorale a été augmentée<br />
depuis les années 1990. En parallèle, les densités<br />
d’ongulés sauvages ont significativement augmenté depuis<br />
les années 1980 comme dans l’ensemble de la région <strong>méditerranéenne</strong><br />
française. Cette augmentation récente des<br />
ongulés laisse à penser qu’ils pourraient avoir un impact<br />
sur le développement actuel et futur des peuplements forestiers<br />
du site, notamment en limitant l’expansion forestière.<br />
L’analyse de la croissance et de la dynamique du sapin pectiné,<br />
espèce très sensible aux herbivores, a montré que les<br />
pressions pastorales actuelles ont un impact sur la croissance<br />
radiale et apicale des sapins mais ne permettent pas<br />
d’enrayer sa dynamique (chapitre V). Ainsi les mesures de<br />
gestion et de conservation de l’habitat de la vipère d’Orsini<br />
sont actuellement insuffisantes pour restreindre la fermeture<br />
du paysage. Une nouvelle augmentation de la pression<br />
pastorale pourrait être envisagée. Cependant, cette<br />
augmentation pourrait entraîner la reprise du recrutement<br />
du pin sylvestre qui ne régénère pratiquement plus aujourd’hui.<br />
En effet, ce dernier très sensible à la compétition<br />
avec les herbacées ne régénère qu’en présence d’un pastoralisme<br />
modéré (chapitre III). Dès lors de nouvelles<br />
mesures de gestion doivent être envisagées.<br />
La discussion de la thèse (chapitre VI) aborde non seulement<br />
des mesures de conservation comme nous l’avons vu,<br />
mais propose également une confrontation des résultats<br />
obtenus à la littérature afin d’aborder des questions plus<br />
larges : I) comment les résultats de la thèse s’inscrivent<br />
dans les schémas connus de dynamique forestière et permettent<br />
d’en améliorer notre connaissance, II) compare les<br />
différents effets des grands herbivores à ceux observés par<br />
ailleurs afin de discuter le rôle des grands ongulés dans les<br />
dynamiques forestières.