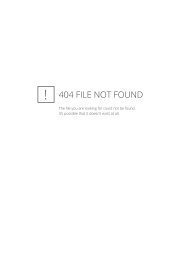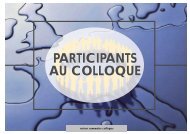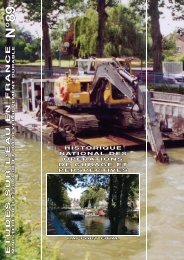Les macrophytes aquatiques bioindicateurs des systèmes lotiques ...
Les macrophytes aquatiques bioindicateurs des systèmes lotiques ...
Les macrophytes aquatiques bioindicateurs des systèmes lotiques ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
qui apportent <strong>des</strong> renseignements complémentaires (et éventuellement irréductibles les<br />
uns aux autres).<br />
3.2. – Application aux <strong>macrophytes</strong><br />
<strong>Les</strong> systèmes de bioévaluation de terrain testés se basent sur la recherche et<br />
l’identification de taxons ou de communautés végétales <strong>bioindicateurs</strong>, utilisés pour la<br />
détection et le suivi de différentes formes de pollution (MERIAUX, 1982 ; HAURY, 1985 ;<br />
1990a ; BLANDIN 1986).<br />
Il est donc nécessaire d’envisager l’écologie <strong>des</strong> espèces; non seulement telle qu’elle<br />
peut être étudiée ex-situ, notamment en conditions expérimentales, mais aussi telle qu’elle<br />
apparaît in situ, en tant que résultante à la fois <strong>des</strong> interrelations fonctionnelles existant dans<br />
le cours d’eau (relations milieu physique, qualité de l’eau, entre populations macrophytiques,<br />
relations biotiques diverses avec les animaux, ...), la différence entre les résultats <strong>des</strong> étu<strong>des</strong><br />
de laboratoire et les observations in situ ayant été démontrée depuis <strong>des</strong> décennies pour les<br />
espèces terrestres (LEMEE, 1967). L’évaluation de la valeur bioindicatrice <strong>des</strong> espèces permet<br />
de distinguer deux groupes majeurs de végétaux, soit polluo-sensibles, soit polluo-résistants<br />
(MULLER, 1995). L’intérêt de ces <strong>bioindicateurs</strong> est leur aspect intégrateur qui justifie leur<br />
emploi mais qui ne permet que difficilement d’apprécier la nature et l’impact d’un facteur<br />
donné et isolé (à l’opposé <strong>des</strong> biomarqueurs).<br />
Intermédiaire entre l’approche spécifique et l’étude <strong>des</strong> communautés structurées<br />
(analysées comme <strong>des</strong> groupements végétaux ou <strong>des</strong> phytocénoses), l’analyse <strong>des</strong> ensembles<br />
floristiques considère l’ensemble <strong>des</strong> taxons présents dans un tronçon donné, quels que<br />
soient leurs patrons de distribution et d’agrégation. Ce sont souvent ces ensembles floristiques<br />
qui sont étudiés par les non-spécialistes de la végétation aquatique. <strong>Les</strong> renseignements que<br />
l’on peut en tirer sont une juxtaposition <strong>des</strong> indications apportées par chaque espèce de la<br />
liste, sachant néanmoins que le milieu et les interrelations entre espèces ont déjà joué dans la<br />
sélection <strong>des</strong> taxons présents :<br />
• L’étude <strong>des</strong> groupements végétaux (MERIAUX & WATTEZ, 1980) donne <strong>des</strong><br />
renseignements plus précis que la prise en compte <strong>des</strong> renseignements apportés<br />
individuellement par les espèces constitutives de ces groupements, dans la mesure<br />
où ces groupements correspondent à <strong>des</strong> relations sociales témoignant d’un niveau<br />
d’organisation supérieur : au pire, le renseignement résultant correspond à<br />
l’intersection <strong>des</strong> valences écologiques <strong>des</strong> espèces constitutives, et au mieux à un<br />
domaine encore plus restreint correspondant à la mise en place du groupement.<br />
• L’établissement de phytocénoses de référence est un objectif majeur. Il semble<br />
judicieux de limiter le terme de phytocénose de référence aux conditions non<br />
altérées par l’anthropisation, et de parler de pseudo-référence pour <strong>des</strong> conditions<br />
pseudo-naturelles (dont l’idée, sinon le terme, apparaît dans les actes du colloque<br />
“ Ecologie et Développement ” (LEFEUVRE et al., 1981), qui prévalent dans la<br />
majorité <strong>des</strong> cours d’eau les moins altérés de plaine. Cette démarche pragmatique<br />
de “ phytocénose la moins altérée possible dans l’état actuel de nos<br />
connaissances ”, qui est celle <strong>des</strong> Anglo-saxons, semble la seule raisonnable<br />
lorsqu’aucune référence sans atteinte anthropique ne peut être trouvée. C’est<br />
12