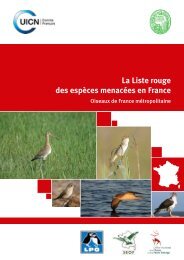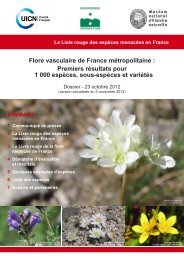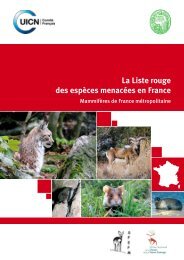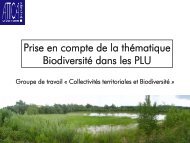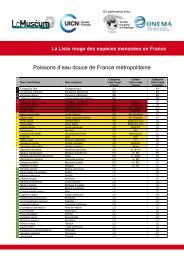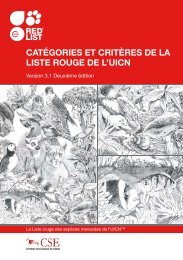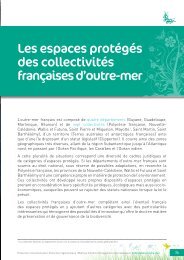Or vert contre or jaune Quel avenir pour la Guyane - Comité français ...
Or vert contre or jaune Quel avenir pour la Guyane - Comité français ...
Or vert contre or jaune Quel avenir pour la Guyane - Comité français ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
du Parc Amazonien, voire en zone cœur selon les modalités définies à l’article 15 du décret de<br />
création. Il faut noter ici que certains pays proches développent déjà avec succès un tourisme <strong>vert</strong><br />
de ce type.<br />
Le secteur touristique constitue par ailleurs une activité appelée à se développer en <strong>Guyane</strong>, en tant<br />
que vecteur économique et de sources d'emplois alternatifs. Un environnement de qualité<br />
commandera à l'offre touristique et en renf<strong>or</strong>cera <strong>la</strong> f<strong>or</strong>ce et l'attrait.<br />
Les zones accueil<strong>la</strong>nt des activités touristiques et sp<strong>or</strong>tives sont représentées en violet sur <strong>la</strong> carte<br />
n°2 « Autres enjeux humains ».<br />
3.4.2.2. L’agriculture<br />
L’activité agricole en <strong>Guyane</strong> se caractérise par <strong>la</strong> coexistence entre une agriculture<br />
traditionnelle basée sur <strong>la</strong> pratique itinérante de l’abattis, notamment par les popu<strong>la</strong>tions<br />
amérindiennes, et une agriculture plus moderne, mais aux premiers résultats enc<strong>or</strong>e timides.<br />
Actuellement, l’agriculture guyanaise, surtout imp<strong>la</strong>ntée dans les communes litt<strong>or</strong>ales, ne permet<br />
pas d’assurer l’autonomie alimentaire de <strong>la</strong> région, globalement elle peut y contribuer, et donc<br />
potentiellement se développer.<br />
L’agriculture itinérante sur brûlis est enc<strong>or</strong>e <strong>la</strong>rgement répandue dans les communes rivu<strong>la</strong>ires de<br />
l’intérieur de <strong>la</strong> région. En revanche, sur le litt<strong>or</strong>al, cette pratique est de plus en plus marginale. De<br />
très nombreuses petites exploitations (surtout maraîchères à but d’autosubsistance et aux petits<br />
moyens) font face à quelques grandes exploitations, tournées vers <strong>la</strong> culture de vergers,<br />
l’exploitation en pâturage des prairies et savanes et <strong>la</strong> pratique de <strong>la</strong> riziculture sur polder.<br />
L’ouest de <strong>la</strong> région est marqué à <strong>la</strong> fois par <strong>la</strong> riziculture et <strong>la</strong> pratique de l’abattis. La culture du riz<br />
est possible grâce à <strong>la</strong> construction, sur <strong>la</strong> commune de Mana, d’un polder en 1993 (réaménagé en<br />
2003 <strong>pour</strong> limiter les risques d’infiltration d’eau de mer). Ce système nécessitant un app<strong>or</strong>t en eau<br />
douce depuis <strong>la</strong> Mana permet actuellement plus d’une récolte par an. La production couvre presque<br />
<strong>la</strong> totalité des besoins de <strong>la</strong> <strong>Guyane</strong>, et les meilleures années de récolte permettent l’exp<strong>or</strong>tation. La<br />
culture de l’abattis y est également bien développée, pratiquée par les différentes communautés de<br />
l’ouest guyanais.<br />
Grâce aux terres fertiles, Cacao se démarque par l’imp<strong>or</strong>tante production maraîchère réalisée par <strong>la</strong><br />
communauté des Hmongs. Les surfaces agricoles auraient toutefois tendance à régresser face à <strong>la</strong><br />
f<strong>or</strong>te pression de l’urbanisation. Ce même phénomène est observé à l’est de Macouria et sur l’île de<br />
Cayenne.<br />
On comptait en 2000, près de 5 000 exploitations dont <strong>la</strong> surface cultivée était comprise entre moins<br />
d’1 ha à 5 ha (INSEE, 2000) et dont les # pratiquaient l’abattis. Mais à partir de 2003, cette<br />
tendance s’est écroulée. Le nombre des très petites exploitations a chuté de 84 % et celles de 1 à 2<br />
ha de 81 %. En revanche, les exploitations de plus de 20 ha ont progressé dans le même intervalle<br />
de temps, de l’<strong>or</strong>dre de 4,6 %. En 2005, <strong>la</strong> surface agricole utilisée en <strong>Guyane</strong> était de 23 478 ha<br />
(INSEE). Elle était de 23 176 ha en 1997 et représentait 0,3 % de <strong>la</strong> surface du département.<br />
Il n’y a pas à proprement parler de filière qualité dans <strong>la</strong> région. Néanmoins, eu égard au rôle<br />
imp<strong>or</strong>tant que doit jouer l’agriculture en <strong>Guyane</strong>, il convient de <strong>la</strong> préserver de toute activité<br />
polluante.<br />
La carte n°1 « Enjeux économiques » présente l’ensemble des zones agricoles actuelles ou<br />
attribuables à court terme.<br />
De manière générale, les gisements aurifères ne se superposent pas aux zones agricoles.<br />
Cependant, quelques secteurs très localisés <strong>pour</strong>raient présenter des conflits d’usages, notamment<br />
sur <strong>la</strong> commune de Saint-Laurent du Maroni (secteur amont de Saint-Jean), sur <strong>la</strong> commune de<br />
Roura (à Cacao notamment) ainsi que sur celle de Saül, où le périmètre du PER-Rexma de Limonade<br />
55