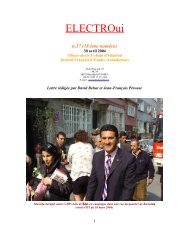Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Chapitre II: La mémoire collective, l'inconscient collectif, le rêve<br />
commun<br />
Le problématique du mémoire collectif est sujet de recherches et réflexions de différentes branches<br />
scientifiques. S'y prêtent les sociologues, les historiens, les psychologues sociaux et les<br />
psychanalystes. Ces derniers ont certainement une grande contribution dans le traitement du sujet,<br />
parce qu'il s'agit de la partie de personnalité humaine qui correspond avec l'inconscient. La mémoire,<br />
en tant que telle, - selon le concept de David Goleman - peut être divisée en deux champs: mémoire<br />
contextualisante et émotionnelle. Cette deuxième partie influence la personnalité humaine à l'insu de<br />
l'individu, l'incite aux comportements et gestes qui restent souvent incomprises ou mal interprétés par<br />
l'individu même. Freud parle de l'importance irréfutable de la période infantile pour la détermination<br />
des traits de la personnalité, et les psychanalystes qui suivent son raisonnement, cherchent à<br />
comprendre l'individu à partir de son passé, surtout sa partie se rapportant à la période de l'enfance. Il<br />
en est de même sur le plan social – psychologie sociale, et aussi certaines philosophes postmodernes<br />
(Habermas) indiquent qu'il est possible et juste de traiter la société, ou plutôt les groupes sociaux<br />
distincts, comme un « individu » muni d'une personnalité, agissant de la façon déterminée par sa<br />
culture d'origine, et ayant vécu un certain passé dont il se rend plus ou moins compte et dont il<br />
préserve les souvenirs plus ou moins conscients.<br />
Toute cette problématique des comportements divergents des intentions ou du discours officiel de la<br />
personne, occupent, bien sûr, les sociologues – qui en trouvent les explications sociologiques. On<br />
peut multiplier les exemples – nous allons en évoquer un, le plus classique, de Durkheim et sa théorie<br />
du suicide, qui explique l'acte par les circonstances déterminées socialement. Il nous paraît pourtant<br />
incomplet de considérer comme ces circonstances socialement déterminées uniquement les éléments<br />
ouvertement considérés comme culturels. Surtout les sociétés modernes vivent le mélange de la<br />
culture traditionnelle avec la nouvelle culture – produit de modernité et de la raison. Ce mélange<br />
comprend les éléments que l'analyse purement sociologique ne peut parfois pas suffisamment<br />
expliquer, et qui par contre sont plus claires de point de vue de psychologie sociale ou<br />
d'anthropologie culturelle.<br />
Les historiens y ajoutent une approche intéressante – p.ex. Pierre Nora parle des « lieux de<br />
mémoire ». De son point de vue – comme cela va aussi être le cas de notre analyse – il considère<br />
l'espace physique, un endroit, à travers le souvenir – ce qui charge cet endroit de la valeur<br />
symbolique, alors change sa perception, son poids et sa signification dans la culture. Henri Levebvre<br />
parle ainsi de la représentation historique de l'espace.<br />
Dans notre étude, on va se pencher vers l'analyse de la partie émotionnelle de la mémoire collective,<br />
la partie contextualisante nous servant surtout du matériel de comparaison. Le thème du rêve collectif,<br />
ayant ses racines dans le passée idéalisée, qui de son tour provient des récits et des témoignages; le<br />
mélange de l'imaginaire, du passé réellement vécu et des émotions va constituer le noyau de notre<br />
analyse. En analysant ce rêve, concernant directement l'espace urbain et l'espace d'habitat, on va tenter<br />
de déchiffrer les informations indirectes se rapportant à l'histoire, l'identité nationale et ethnique, au<br />
passé, présent et même au futur idéal que les Turcs modernes souhaiteraient voir pour son pays. Le<br />
simple discours sur l'habitat devient ainsi un discours métaphorique sur le souvenir douloureux du<br />
passé refoulé, relève l'incohérence (conflit) entre l'appropriation de la version officielle de l'histoire,<br />
appréhendé au niveau intellectuel, et sa version transmise de bouche à bouche, plus proche à la<br />
vérité historique, refusée par le conscient mais très présente dans l'inconscient et dans l'émotionnalité.<br />
I.1. Maison, rue, ville: famille, voisinage, entité urbaine.<br />
Pour donner l'ordre à notre analyse, nous avons établi un schéma structurel suivant: au niveau de<br />
l'espace physique, on prendra la maison individuelle comme unité de base, la rue comme l'ensemble<br />
des maisons, et la ville comme ensemble des rues (sans passant par le quartier, qui aurait du trouver<br />
sa place entre la rue et la ville, et qui est un élément urbain surchargé de significations intéressantes –<br />
11