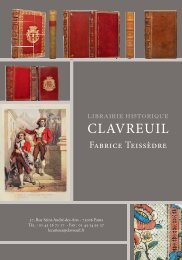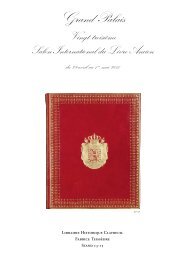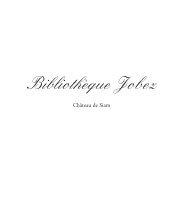Librairie Historique Clavreuil Fabrice Teissèdre
Librairie Historique Clavreuil Fabrice Teissèdre
Librairie Historique Clavreuil Fabrice Teissèdre
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1468- [MANUSCRIT] - MAUROY (Baron Léon). Journal d’une famille militaire. In-4, 52 ff. avec différentes paginations, demi-daim vert à<br />
coins, dos lisse (rel. de l’époque). Coiffes frottées, coins émoussés. Mouillures. (S240). {144920} 2.500 €<br />
Retranscription par son fils cadet Victor Emile, d’une partie des notes de Louis-Pierre Musnier, baron de Mauroy, aide de camp du général Friant puis du maréchal<br />
Mac-Donald.<br />
Destinées à former les mémoires d’un ancien officier d’Empire, ces notes rassemblées ne semblent cependant former qu’une partie ; elles constituent un bon<br />
témoignage sur les campagnes et la période napoléonienne, tout en restant anecdotiques et propres à l’histoire familiale du baron de Musnier. Elles se distribuent<br />
de la façon suivante :<br />
ff. 25-59 : « Mon père. Sa jeunesse, ses premières campagnes. » Mémoires qui commencent ainsi : « Je suis le fils du chevalier de Mauroy, colonel d’artillerie et<br />
chevalier de St Louis (…) ». Louis-Pierre de Musnier était le fils aîné de Augustin-Louis originaire de Coulommiers, et de Marie Legras de Vaubercey d’une<br />
ancienne famille noble de Champagne, dont la grande différence d’âge est soulignée. La destinée de Louis-Pierre sera très tôt lié au Bonaparte et à de grandes<br />
familles, puisque il apparait que sa marraine fut la comtesse de Montesquiou, plus tard gouvernante du Roi de Rome, et que Jérôme Bonaparte « le frère du général<br />
en chef des Armées d’Italie » sera un de ses meilleurs camarades de collège. Après quelques annecdotes sur la Révolution, ses années au collège de Meaux, puis<br />
comme élève au Prytanée militaire sur la recommandation du Premier Consul, le récit se poursuit avec quelques détails sur l’école d’officiers de Fontainebleau, et<br />
plus spécialement sur sa première campagne lors de la guerre contre la Prusse en 1806. Affecté au régiment de Piémontais commandé par Davoust, le jeune officier<br />
brosse un paysage des pays traversés en Allemagne puis de Pologne de Berlin à Varsovie, des premiers combats près d’Eylau et de la manœuvre Pultusk, début<br />
février, récit qui, sans être précis, donne une vie particulière aux péripéties quotidiennes et des impressions précieuses sur la vie militaire. « Le bruit du canon, la<br />
rapidité avec laquelle passait les boulets, les cris des blessés, le bruit des tambours batant la charge, ce mélange confus d’horreur auquel je pris part sans avoir le<br />
temps de la réflexion, m’identifièrent de suite à ma nouvelle position et je restais impassible au milieu de mes camarades qui tombaient autour de moi (…) » (f°41).<br />
Après l’entrevue de Tilsit, le cantonnement en Pologne (1807-1808), les visites à Jérôme Bonaparte au chateau de Napoléon-Sée près Cassel, les bals en présence de<br />
l’Empereur (dont « sa maitresse Waleska était fort gauche et ne dansait guère que la monaco »), le jeune militaire est nommé officier d’Etat-Major auprès du général<br />
Friant. Commence alors le récit de sa deuxième campagne, en 1809, où est abordée la manœuvre de Landshut et Eckmühl (f°50), Essling et la relation très détaillée<br />
de Wagram (f°52-56) ; à travers la lecture de ces souvenirs suppléés par les Bulletins de la Grande Armée, on observe le rôle d’un aide de camp entre Friant et le<br />
quartier général de Davoust. Cette première partie des mémoires se termine sur quelques remarques concernant divers personnages et sa nommination comme aide<br />
de camp du maréchal Mac Donald.<br />
ff.1-8. Reprises des mémoires du marquis de Mauroy devenu chef de Bataillon, pendant la période des Cent-Jours, et le début de la Seconde Restauration avec des<br />
anecdotes intéressantes sur les revirements de position de quelques personnalités, les alliés à Paris et aux environs, le retour de Louis XVIII, la réorganisation des<br />
Armées par MacDonald à Bourges. S’étant mis en congé, ces notes n’abordent principalement que la vie privée dont le principal événement est le mariage en 1814<br />
avec Amélie-Célestine d’Aumont, fille naturelle de Louise d’Aumont duchesse de Mazarin, épouse divorcée du prince de Monaco, et sur qui Mauroy porte une<br />
rancœur désabusée pour avoir supporté les créances et le train de vie fastueux de la belle-mère…<br />
ff. 9-14. « Notes retrouvées, retranscrit sous forme de journal », datées depuis janvier à mars 1819.<br />
ff.15-19. Quelques « portraits tracés par mon père », la plupart particulièrement acerbe (parmi les personnalités militaire, le général St Cyr et le colonel Verdun<br />
qualifié « pour mémoire, de nullité personnifiée ».<br />
Louis-Pierre Musnier de Mauroy deviendra par la suite lieutenant-colonel en 1836, colonel en 1840, et créé baron héréditaire par lettres-patentes du 30 mai 1817.<br />
Il décède en mars 1851 à Paris.<br />
Le manuscrit se poursuit avec les souvenirs de son fils Victor Emile Vivan, né en octobre 1820, militaire qui apparait comme officier d’ordonnance de Napoléon<br />
III. Ces souvenirs se composent de 3 notes :<br />
- 7 pp. sur la campagne d’Italie de 1859, le baron de Mauroy étant incorporé au 2e Régiment de Voltigeurs de la Garde ; récit de campagne qui reste tout à fait<br />
anecdotique sur l’arrivée à Gêne, la traversée de la Lombardie, les premiers engagements contre les Autrichiens à Montebello, combats de Turbigo et la bataille de<br />
Magenta début juin, les fêtes à Milan, les charges du 2e Voltigeurs à Solférino et la poursuite de l’ennemi … se finissant avec la revue général à Paris. On notera<br />
quelques détails sur l’empereur souvent présent au bivouac, et quelques hautes personnalités dont le prince Murat, Tascher de la Pagerie, les généraux d’Andelot et<br />
Waubert de Genlis, la rencontre avec le Duc de Chartres engagé dans un régiment de cavalerie au service du Piémont.<br />
- 2 pp. « Mon voyage au Mont Cenis, 1865 », sur le creusement spectaculaire du tunnel et la visite des chantiers.<br />
- 8 pp. « Mon voyage à Londres, 1871 », pour assister aux manœuvres militaires anglaises du camp d’Alderchott. Rentré de captivité en juin 1871, le lieutenantcolonel<br />
Mauroy reprenant le commandement du 22e de Ligne, se voit confier cette mission d’observation des armées britanniques. Sans trop de détails précis, ce<br />
rapport reste intéressant sur la tactique employée, et le matériel militaire, la rencontre amicale avec le prince de Galle et le duc de Cambridge, les acclamations des<br />
officiers français devant les observateurs allemands consternés, enfin le déroulement des différentes manifestations qui s’avère être un premier rapprochement entre<br />
l’empire britannique et la jeune république française au lendemain du désastre de 1871.<br />
Nommé colonel, le baron Musnier de Mauroy quittera le service et sera mis en retraite en 1880.<br />
Biblio. : Woelmont de Brumagne, Notice généalogique ; Révérend, Les familles titrées et annoblis aux XIXe s. (p 227).<br />
1469- [MANUSCRIT] - Mémoire sur le commencement de la dernière campagne en Catalogne, en 1808. à Valence, 3 septembre, 1818, petit<br />
in-folio, 10 pp. reliée en cahier, carte dépl. in-4 à l’encre noire et rouge (31 x 25 cm). (a). {167034} 1.800 €<br />
Souvenirs écrit sous la Restauration, du capitaine Charles-Jean-Baptiste Valery de Siriaque (1789-1867) vétéran de la campagne de Catalogne ; il faisait alors<br />
partie d’un escadron de chasseurs napolitains formant un régiment de cavalerie provisoire placé sous les ordres du Major Rambourg, dans la division du général<br />
Lechi. Cousin de René-Hyacinthe Miot de Melito, Valery de Siriaque sera avec lui, aide-de-camp du général Jamin jusqu’à Waterloo.<br />
Il s’agit d’un très intéressant témoignage du tout début de la campagne de Catalogne entre 1808 et 1809, dont l’auteur avoue manquer de précisions, ayant perdu ses<br />
notes, mais qui donne une excellente idée des difficultés qui s’annonçaient pour les armées napoléoniennes dans la lutte contre la guerilla.<br />
Le récit débute au tout début de la campagne, en janvier 1808, alors que les buts réels de l’intervention française en Espagne étaient ignoré des soldats ; pour les<br />
Catalans étonnés, les Français venaient pour assiéger Gibraltar et le rendre au Roi d’Espagne. « (…) Bientôt pourtant, il fallut lever le masque (…) »; et après la<br />
prise pacifique des points stratégiques et des forts, « (…) les esprits changèrent à notre égard (…) On ne parla plus de Gibraltar et l’on nous regarda d’un oeil moins<br />
fraternel. La nouvelle de ce qui se passait à Madrid et à Bayonne achevèrent de répandre l’allarme dans toute la Catalogne (…). »<br />
Suit l’insurrection générale de la population contre les troupes françaises, plus tard aidée par les Anglais commandé par le général Reding, la description des<br />
« miquelets », milices armées considérées comme des brigands, la « haine » des habitans accueillant les soldats à coup de pierre, et le résumé des faits d’armes des<br />
généraux Lechi, Chabran, Schwartz, Duhesme, Reille, Gouvion St-Cyr, Milosowitz, pour l’occupation du pays.<br />
L’auteur confesse son désarroi, lors d’un baptême du feu, à l’égard des excès commis par la troupe : « (…) J’avais alors dix-huit ans, c’était la première fois que<br />
j’assistais à un combat ; ces incendies précédées de pillages, ces exécutions plus que militaire me firent une pénible impression, et je trouvais que nous avions pris<br />
une étrange manière de soumettre un pays où il importait de faire aimer notre domination. Ces excès, en irritant contre nous la haine des Catalans, prêtaient<br />
trop beau jeu aux moteurs de l’insurrection ; les prêtres en étaient les plus ardents : sans doute, ils prévoyaient dans l’envahissement de l’Espagne la fin de leurs<br />
privilèges (…). » Valery de Siriaque poursuit en nous laissant ses impressions au moment de son retour en France : « Nous vîmes encore, dans cette marche pénible,<br />
un exemple de l’opiniatreté et de la haine des Catalans qui nous rendaient cette guerre si difficile et si funeste. Où n’étaient point nos armées, on ne s’appercevait<br />
en rien du succès qu’elles avaient pu avoir ailleurs ; même où elles étaient, elles n’occupaient le plus souvent qu’un pays désert et ne rencontraient pas un habitant<br />
qui ne fut un ennemi »<br />
Le manuscrit est accompagnée d’une très belle carte tracée à la plume, représantant la Catalogne depuis la frontière jusqu’à Tarragonne.<br />
1470- [MANUSCRIT] - MONTESQUIOU-FEZENSAC (Raymond-Aimery-Philippe-Joseph de). Campagne de 1808 en Espagne. Petit in-4,<br />
[8] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne et très lisible, avec de nombreuses ratures et biffures, en feuille dans double emboîtage demichagrin<br />
cerise, dos lisse orné de filets dorés (reliure moderne). Bel exemplaire. (413). {168659} 800 €<br />
Ces quelques pages manuscrites, rédigées à une date qu’il est difficile de préciser, sont l’ébauche du futur chapitre VII des Mémoires du futur duc de Fezensac<br />
(1784-1867), dont la première version complète (c’est-à-dire couvrant toutes les campagnes de l’Empire) parut en 1863, après plusieurs éditions partielles surtout<br />
consacrées à la Campagne de Russie (1849, 1858).<br />
La comparaison de notre manuscrit avec la version imprimée (édition de 1870) montre qu’il s’agit ici uniquement de matériaux qui furent très amplifiés dans<br />
la rédaction finale, tant par des considérations de politique et de stratégie générales sur la Guerre d’Espagne que par des détails personnels, mais des phrases ou<br />
des paragraphes entiers se retrouvent tels quels dans l’imprimé (par exemple, le passage qui commence par « Le soir même de notre arrivée à Alagon... ». Sinon, les<br />
feuillets couvrent la période du 10 novembre 1808 (passage de la frontière et arrivée à Irun) au 16 février 1809 (date du retour à Paris), et relatent essentiellement<br />
la mission de liaison entre Ney que Montesquiou servait comme aide-de-camp et le quartier-général de l’Empereur. Le jeune officier traversa les villes de Tolosa,<br />
Vitoria, Miranda, Burgos, Aranda, Soria, puis Alagon et Madrid. Il fut aussi envoyé à Guadalajara et à Valladolid. Son itinéraire complet, entièrement autographe,<br />
se trouve à la fin du manuscrit.<br />
Cf. Tulard 1050.<br />
123