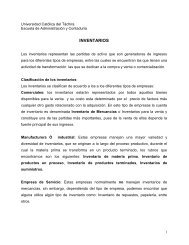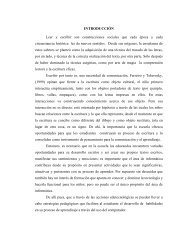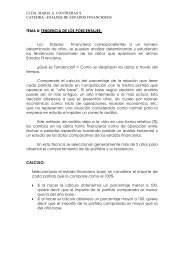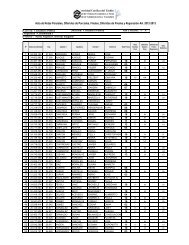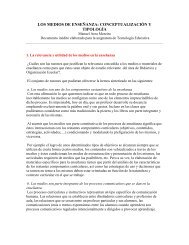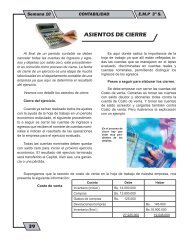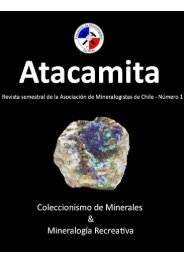Dans un essai récent , l’actuel Ministre de l’Education, 18 Luc Ferry oppose uneconception « théosophique » du savoir humain à une conception « philosophique » .Dès l’Antiquité , la pensée grecque a largement posé les bases sur lesquelles laréflexion sur la Science s’organise encore de nos jours –en particulier en économiecomme en gestion.A ) De la conception « théosophique » de la connaissance (gnosis)…L’idée fondamentale est que le Monde (la Nature) est construit selon uneharmonie universelle . L’activité d’étude va donc reposer sur une conviction a priorid’une organisation fondée sur des « lois transcendantes » , qui échappent àl’entendement humain , et relèvent de l’ « au-delà » , de la volonté des dieux, puis deDieu , pour ce qui concerne les religions monothéistes.Il va de soi que cette conception harmonieuse d’un Univers organisé par un« Grand architecte » pour le soumettre à la Raison a permis à la philosophie grecqued’évacuer les conceptions « non rationnelles» véhiculées par les mythes anciens ,comme l’a montré notamment Jean-Pierre Vernant 19 .Cette conception qualifiée d’ « absolutiste » , transcendantale, trouve sonillustration dans le fameux « mythe de la Caverne » de Platon (d’où l’expression deconception « platonicienne ») .Les hommes , dans une caverne , sont éclairés dansleur dos par une brillante lumière ( le « Réel ») : ils n’en « perçoivent » , par leurssens , que les reflets sur la paroi (les « phénomènes »). Ils n’auront donc jamaisaccès à la Vérité , au « Réel » .Tous leurs efforts consisteront à tenter de s’enapprocher en rationalisant , en ayant recours à l’abstraction et à la logique. Cefaisant , on se rapproche de la connaissance « vraie » des harmonies voulues par laPuissance Divine.La pensée pythagoricienne fonde ainsi la connaissance sur la géométrie .Onpeut imaginer que , dans l’Histoire de l’Humanité , il a fallu partager les terres , et,donc , les mesurer .Ces mesures (en grec : géo-métrie » : mesure de la terre),d’abord « artisanales », à l’échelle humaine (d’où les termes de pouce ,pied,brassée , perche, aune, etc.) ont été systématisées , puis « rationalisées » à l’aidedes « lois » de la géométrie .On a alors cherché à se rapprocher de l’ « essencedivine de toutes choses » en tentant,par exemple , de trouver le fameux « Nombre d’Or » 20 .Il n’est donc pas étonnant que les philosophes mathématiciens aient adhérépleinement à une telle vision absolutiste . Ainsi, Leibniz , prolongeant Spinoza,énonce le principe de Raison Suffisante :il y a toujours une cause pour laquelle telphénomène observé se produit, et la « cause de la cause etc. », c’est Dieu.L’ensemble de l’Univers est composé d’entités transcendantales, qui ne peuvent êtreappréhendées que sous la forme de concepts, mis en relations par des causalitéslogico-mathématiques -– les monades. Laplace , à la fois mathématicien et hommed’Etat napoléonien , énoncera l’idée selon laquelle , grâce aux lois de la statistique,l’ensemble de l’Univers est a priori prédictible.18 A la date du 18 août 2003… « Qu’est-ce qu’une vie réussie ? » Grasset 2002 ( 20 euros)19 Mythe et Religion en Grèce ancienne (Seuil Librairie du vingtième siècle) 120 pages passionnantes ( 10 euros)20 Ainsi, l’architecte contemporain Ricardo Bofill explique , dans un essai autobiographique (« Espaces d’uneVie, Editions Odile Jacob) , avoir conçu le quartier d’Antigone à Montpellier , et notamment la Place … duNombre d’Or, en fonction de ce chiffre « magique ». L’irrationnel n’est plus très loin…14
Cette vision « absolutiste » , mêlée de théosophie ,imprègne encorelargement … la Science Economique. En témoigne la « foi du charbonnier » desultra-libéraux (Ecole dite « de Chicago ») concernant l’omnipotence du Marché ,comme moteur « transcendant » de l’harmonisation des échanges économiques .Audix-neuvième siècle , Jean-Baptiste Say écrira un « catéchisme d’EconomiePolitique » et Frédéric Bastiat « Les Harmonies Economiques ». Au mythe de laCaverne, répondrait ainsi , en écho contemporain, le mythe de la Main Invisible, quiguide les actions humaines sans qu’ils en aient conscience, et, surtout, la maîtrise. 21B) … à la conception « philosophique » du savoir (logos)1°) Une conception nominaliste…L’apprenti philosophe sait au moins qu’à la démarche platonicienne, s’opposela vision d’Aristote. Alors que le rationalisme conduit à privilégier la méthodehypothético-déductive (chère à l’analyse économique dite « scientifique »), Aristotepréconise une construction du savoir depuis l’homme , à la fois nominaliste etempirique .Le nominalisme implique le classement des faits observés, la recherched’une dénomination conventionnelle , fondée sur des considérations logiques , àcaractère taxinomique. Elle implique l’observation des phénomènes , puis uneréflexion fondée sur la logique des relations .En quelque sorte , l’Homme socratique, mesure de toutes choses , reconstruitl’Univers à son image . L’édification du savoir « logique » contribue à améliorer lesort de chacun et de la Société, en l’aidant à mieux comprendre le fonctionnementde la Nature et de la Société.Par exemple, Aristote , dans l’Ethique à Nicomaque, contribue à mieuxcomprendre les problèmes de justice et d’éthique (conduite personnelle) enconvenant de nommer (nominalisme) deux types de justice : est « juste » le fait dedonner à chacun ce à quoi il a droit (justice commutative) et , mais aussi le fait deredistribuer à chacun en fonction de ses besoins (justice distributive) .Les théoriesd’économie et de gestion les plus actuelles sur l’équité et la justice renvoientinvariablement à ces deux conceptions aristotéliciennes de la Justice. On pourraitégalement évoquer ses apports à la théorie de la valeur d’un bien, liée , soit à sonutilité, soit à sa rareté.2°)… relativiste…A l’absolutisme platonicien (songeons aux modèles microéconomiques) ,s’oppose ainsi une vision relativiste de la science , laquelle évolue en fonction desbesoins, des techniques, des attentes, des résultats de recherche.Ainsi, le géocentrisme ptoléméen répondait suffisait aux besoins d’un Monde« plat » (le marin faisant du cabotage pouvait se guider sur la terre). L’héliocentrisme21 Une anecdote « théosophique » rapportée par Robin Marris dans « The Economic Theory of managerialCapitalism » .Quand, en 1966 , le groupe chimique britannique ICI réussit à contrer « miraculeusement » l’OPAlancée par le groupe Courtaulds , les administrateurs organisèrent à la Cathédrale Saint-Paul une messe d’actionsde grâce pour remercier le Seigneur … L’irrationnel est encore moins loin…Dans un autre ordre d’idées , onnotera que la valeur d’une théorie est souvent connotée à son caractère « séduisant », « esthétique » (ainsi, la« démonstration » ricardienne des avantages comparés), la formalisation mathématique contribuant fortement àrenforcer cette « beauté ». Enfin, faut-il rappeler le « In God we Trust » inscrit sur le billet vert ?15
- Page 1 and 2: Michel MARCHESNAYL’ECONOMIE ET LA
- Page 3 and 4: disciplines. Cette interdisciplinar
- Page 6 and 7: La recherche de la « vérité » r
- Page 8 and 9: 3°) Elle conduit ensuite à se pos
- Page 10 and 11: Dans les années 1860-1880 ,à l’
- Page 12 and 13: dix-neuvième siècle , illustré p
- Page 16 and 17: galiléen (eppur, se mueve) répond
- Page 18 and 19: Industrielle (au sens de Raymond Ar
- Page 20 and 21: Par exemple, les décisions pratiqu
- Page 22 and 23: « moment » où chaque homme sera
- Page 24 and 25: Dès la fin du dix-neuvième siècl
- Page 26 and 27: L’Ecole institutionnaliste - dont
- Page 28 and 29: La conséquence essentielle est que
- Page 30 and 31: Ainsi, le manager cherchera le poin
- Page 32 and 33: On a déjà évoqué les travaux au
- Page 34 and 35: compte, c’est le résultat visé
- Page 36 and 37: Le chercheur vise des fins personne
- Page 38 and 39: celle-ci connaissait une baisse his
- Page 40 and 41: Locke et Rousseau, elle postule que
- Page 42 and 43: de B, ou A entraîne logiquement B)
- Page 44 and 45: 5°) Cette question du « réalisme
- Page 48 and 49: fonction de trois types idéaux (le
- Page 50 and 51: Le recours à de telles sources ent
- Page 52 and 53: Dans les recherches de l’ERFI sur
- Page 54 and 55: (économie) , et l’impact des pra
- Page 56 and 57: apparaître de nouveaux problèmes,
- Page 58 and 59: CHAPITRE 3 : ECONOMIE ET GESTION. E
- Page 60 and 61: objectivité du chercheur par rappo
- Page 62 and 63: Un bon exemple est constitué par l
- Page 64 and 65:
Ce type d’ouvrages et de producti
- Page 66 and 67:
expérimentales , alors que les sec
- Page 68 and 69:
trop élevé .A l’inverse , on pe
- Page 70 and 71:
En d’autres termes , on pourrait
- Page 72 and 73:
La complexité est la source majeur
- Page 74 and 75:
dans un monde complexe , ajustant l
- Page 76 and 77:
echerche , ces connaissances contri
- Page 78:
PISTES BIBLIOGRAPHIQUES EN EPISTEMO