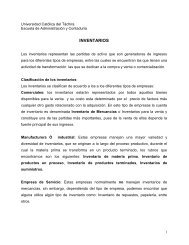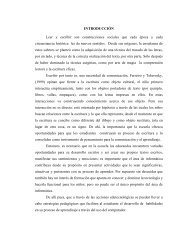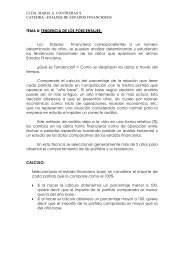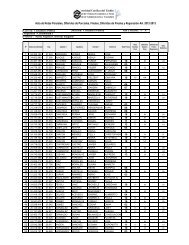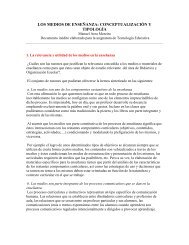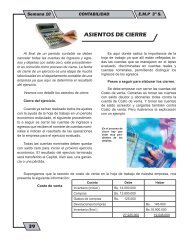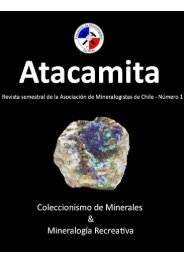fonction de trois types idéaux (le paysan, le chevalier, le prêtre). L’écolemarxiste 92 retient , on le sait une classification entre « prolétaires » et « capitalistes » .A côté de l’ « idealtypisation » (terme rencontré chez certains sociologues…) ,l’économie , et surtout la gestion (plus proche des pratiques observées « live ») , lechercheur peut suggérer un modèle explicatif général , inspiré d’observations deterrain, modèle censé avoir une valeur universelle.Typique de cette méthode est le modèle de cycle de vie , appliqué àl’entreprise (Marshall) ou au produit (Kotler et Leavitt). On part de l’hypothèse selonlaquelle , comme tout organisme vivant ( on parle d’ « analogie biologique »)l’entitéobservée passe par plusieurs phases : gestation , création , développement ,maturité, déclin). Le modèle de cycle de vie est d’une application d’autant plusgénéralisée qu’il est accepté tel quel (par exemple, dans les matrices de portefeuillesd’activité) : or, comme le montre Hervé Fenneteau , 93 ce modèle est totalementinvérifiable empiriquement, pour une multitude de raisons qu’il énonce dans sonouvrage ! Il en va de même de modèles analogues, comme celui des « étapes decroissance » d’une entreprise (les étapes, selon les modèles , vont de trois à onze !).2°) Induction ET déduction ?Compte- tenu de ces biais et limites , les chercheurs recourent à desméthodes « mixtes » (les pires à l’exception des autres…), s’efforçant de concilierinduction et déduction , les fameuses « deux jambes pour marcher » de laMethodenstreit. C’est que le bon sens, autant que « l’esprit scientifique » (Bachelard)commandent de retenir les points suivants :a) Les « faits » n’existent pas .Ils sont en réalité construits par le chercheur .Celui-ci se « représente » le réelen fonction de ce qu’il cherche , de ce qui l’intéresse . Il est donc conduit à éliminertous les « faits » qui n’entrent pas dans ses objectifs de recherche , au traversnotamment des hypothèses de travail.Si je veux étudier les choix financiers des chefs d’entreprise, j’élimine de monchamp d’observation tous les faits qui n’entrent pas dans cette problématique . Tropsouvent, l’apprenti chercheur introduit dans les questionnaires une quantité dequestions qui ne présentent qu’un rapport lointain avec le sujet traité .Enl’occurrence, il faut se demander ce que la réponse apporte à la compréhension desmobiles et des modalités en matière de pratiques financières.b)L’ observation des faits est inséparable de la formulation d’hypothèses.L’empirisme est donc indissolublement lié à la théorisation : ce que l’onappelle l’ « empirisme logique ». 94 Mais, réciproquement, une théorie ne peut êtreque soumise au « test acide » de la soumission aux faits – du moins si l’on accepte92 Et marxienne , selon l’expression de Mrs Robinson , c’est-à-dire qui reprend la division de la Société entre lesapporteurs de travail et les détenteurs de capital (théorie néoricardienne de Cambridge)93 Professeur à l’Université de Montpellier 3 ( « Le Cycle de Vie » Economica-Poche )94 Le manuel d’épistémologie de Hempel est particulièrement représentatif de ce courant .48
de se ranger aux critères de définition d’une théorie « scientifique » héritée de laphilosophie moderne des sciences. Une « théorie » qui refuse la vérificationempirique est donc une théorie (en fait , une thèse) qui refuse la réfutation autre quelogique : elle relève donc, non de la science, mais de l’ « idéologie », voire del’ « idéocratie » .Un courant de recherche en gestion préconise une démarche abductive,censée dépasser dialectiquement le clivage entre induction et déduction .Ditsimplement, la démarche consiste à progresser dans la recherche 95 , en procédantpar allers et retours entre la formulation des hypothèses et l’observation du terrain.On ne sera pas étonné que cette démarche soit considérée comme « hérétique » parles divers courants positivistes , lesquels considèrent que la recherche« scientifique » est avant tout axée sur la vérification des hypothèses fixées audépart. Cependant , cette démarche semble appropriée aux pratiques de rechercheintervention,et, surtout, à la prise en compte de la complexité .En effet, si l’ondépasse la relation asymétrique entre deux variables (de type si…alors) , pourprendre en compte toutes celles que l’on observe ou que l’on juge pertinentes,l’irruption d’une variable non incluse dans les assertions initiales conduit le chercheurà modifier celles-ci , établissant une relation dialogique entre les hypothèses et lesobservations.Ces méthodes « mixtes » reposent finalement sur l’efficacité des outils dontdispose désormais le chercheur .Elles ont ainsi acquis une légitimité avec le développement de laTechnoscience , dont il a été traité supra .En particulier , les systèmes de traitementde l’information (STI) et les progrès dans l’analyse statistique encouragent le recoursà de telles méthodes .Un rapide examen suffit à s’en convaincre .c)La méthode que nous proposons de qualifier d’ « herméneutique » repose ,comme on l’a dit précédemment , sur le traitement de sources documentaires –comme le font les historiens 96 .La recherche économique se fonde dans une large mesure sur la vérificationstatistique de modèles ou de théories , en s’appuyant sur des données disponibles,le plus souvent officielles : il suffit pour s’en convaincre de consulter les grandesrevues académiques, considérées comme ayant un haut niveau « scientifique » .Mais, au même titre que l’historien, l’économiste est , comme le« gestionnaire »,alors prisonnier de ses sources . Celles-ci reposent sur des critèresde collecte et de classement qui constituent autant de biais .Par ailleurs, la diversitédes sources contribue à multiplier les modes de classement , sans que la cohérencesoit assurée entre elles .Les exemples abondent : ainsi, la définition du « chômeur » varie selon lespays et les organisations . Les définitions de la PME sont d’une étonnante variété ,non seulement au plan international, mais selon les Administrations françaises.95 « Chemin Faisant », pour reprendre le titre d’un ouvrage coordonné par Marie-José Avenier (Economicaéditeur)96« La » référence sur l’herméneutique , définie comme les discours sur l’Histoire ,est le philosophe PaulRicoeur, notamment dans ses rapports avec la psychanalyse.49
- Page 1 and 2: Michel MARCHESNAYL’ECONOMIE ET LA
- Page 3 and 4: disciplines. Cette interdisciplinar
- Page 6 and 7: La recherche de la « vérité » r
- Page 8 and 9: 3°) Elle conduit ensuite à se pos
- Page 10 and 11: Dans les années 1860-1880 ,à l’
- Page 12 and 13: dix-neuvième siècle , illustré p
- Page 14 and 15: Dans un essai récent , l’actuel
- Page 16 and 17: galiléen (eppur, se mueve) répond
- Page 18 and 19: Industrielle (au sens de Raymond Ar
- Page 20 and 21: Par exemple, les décisions pratiqu
- Page 22 and 23: « moment » où chaque homme sera
- Page 24 and 25: Dès la fin du dix-neuvième siècl
- Page 26 and 27: L’Ecole institutionnaliste - dont
- Page 28 and 29: La conséquence essentielle est que
- Page 30 and 31: Ainsi, le manager cherchera le poin
- Page 32 and 33: On a déjà évoqué les travaux au
- Page 34 and 35: compte, c’est le résultat visé
- Page 36 and 37: Le chercheur vise des fins personne
- Page 38 and 39: celle-ci connaissait une baisse his
- Page 40 and 41: Locke et Rousseau, elle postule que
- Page 42 and 43: de B, ou A entraîne logiquement B)
- Page 44 and 45: 5°) Cette question du « réalisme
- Page 50 and 51: Le recours à de telles sources ent
- Page 52 and 53: Dans les recherches de l’ERFI sur
- Page 54 and 55: (économie) , et l’impact des pra
- Page 56 and 57: apparaître de nouveaux problèmes,
- Page 58 and 59: CHAPITRE 3 : ECONOMIE ET GESTION. E
- Page 60 and 61: objectivité du chercheur par rappo
- Page 62 and 63: Un bon exemple est constitué par l
- Page 64 and 65: Ce type d’ouvrages et de producti
- Page 66 and 67: expérimentales , alors que les sec
- Page 68 and 69: trop élevé .A l’inverse , on pe
- Page 70 and 71: En d’autres termes , on pourrait
- Page 72 and 73: La complexité est la source majeur
- Page 74 and 75: dans un monde complexe , ajustant l
- Page 76 and 77: echerche , ces connaissances contri
- Page 78: PISTES BIBLIOGRAPHIQUES EN EPISTEMO