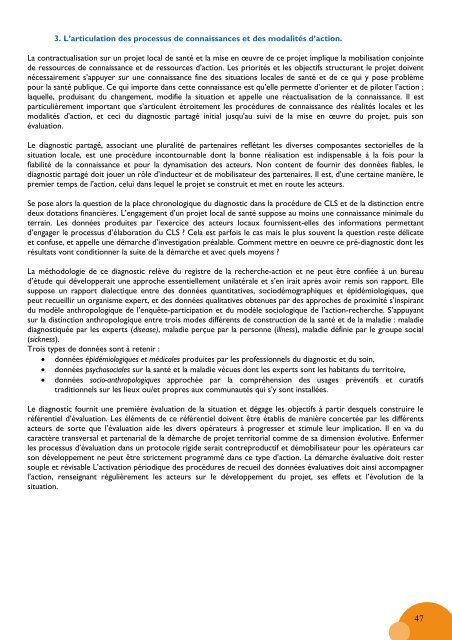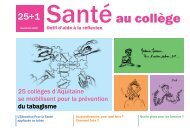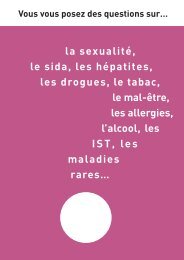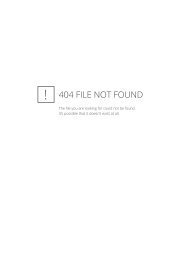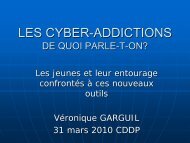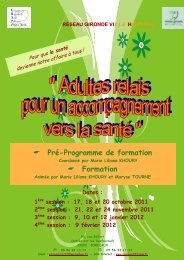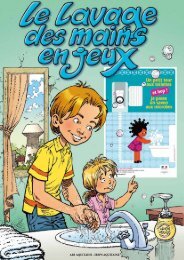Rapport final - Comité régional d'éducation pour la santé en Aquitaine
Rapport final - Comité régional d'éducation pour la santé en Aquitaine
Rapport final - Comité régional d'éducation pour la santé en Aquitaine
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
3. L’articu<strong>la</strong>tion des processus de connaissances et des modalités d’action.<br />
La contractualisation sur un projet local de <strong>santé</strong> et <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre de ce projet implique <strong>la</strong> mobilisation conjointe<br />
de ressources de connaissance et de ressources d’action. Les priorités et les objectifs structurant le projet doiv<strong>en</strong>t<br />
nécessairem<strong>en</strong>t s’appuyer sur une connaissance fine des situations locales de <strong>santé</strong> et de ce qui y pose problème<br />
<strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>santé</strong> publique. Ce qui importe dans cette connaissance est qu’elle permette d’ori<strong>en</strong>ter et de piloter l’action ;<br />
<strong>la</strong>quelle, produisant du changem<strong>en</strong>t, modifie <strong>la</strong> situation et appelle une réactualisation de <strong>la</strong> connaissance. Il est<br />
particulièrem<strong>en</strong>t important que s’articul<strong>en</strong>t étroitem<strong>en</strong>t les procédures de connaissance des réalités locales et les<br />
modalités d’action, et ceci du diagnostic partagé initial jusqu'au suivi de <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre du projet, puis son<br />
évaluation.<br />
Le diagnostic partagé, associant une pluralité de part<strong>en</strong>aires reflétant les diverses composantes sectorielles de <strong>la</strong><br />
situation locale, est une procédure incontournable dont <strong>la</strong> bonne réalisation est indisp<strong>en</strong>sable à <strong>la</strong> fois <strong>pour</strong> <strong>la</strong><br />
fiabilité de <strong>la</strong> connaissance et <strong>pour</strong> <strong>la</strong> dynamisation des acteurs. Non cont<strong>en</strong>t de fournir des données fiables, le<br />
diagnostic partagé doit jouer un rôle d’inducteur et de mobilisateur des part<strong>en</strong>aires. Il est, d’une certaine manière, le<br />
premier temps de l’action, celui dans lequel le projet se construit et met <strong>en</strong> route les acteurs.<br />
Se pose alors <strong>la</strong> question de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce chronologique du diagnostic dans <strong>la</strong> procédure de CLS et de <strong>la</strong> distinction <strong>en</strong>tre<br />
deux dotations financières. L’<strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t d’un projet local de <strong>santé</strong> suppose au moins une connaissance minimale du<br />
terrain. Les données produites par l’exercice des acteurs locaux fourniss<strong>en</strong>t-elles des informations permettant<br />
d’<strong>en</strong>gager le processus d’é<strong>la</strong>boration du CLS ? Ce<strong>la</strong> est parfois le cas mais le plus souv<strong>en</strong>t <strong>la</strong> question reste délicate<br />
et confuse, et appelle une démarche d’investigation préa<strong>la</strong>ble. Comm<strong>en</strong>t mettre <strong>en</strong> oeuvre ce pré-diagnostic dont les<br />
résultats vont conditionner <strong>la</strong> suite de <strong>la</strong> démarche et avec quels moy<strong>en</strong>s ?<br />
La méthodologie de ce diagnostic relève du registre de <strong>la</strong> recherche-action et ne peut être confiée à un bureau<br />
d’étude qui développerait une approche ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t uni<strong>la</strong>térale et s’<strong>en</strong> irait après avoir remis son rapport. Elle<br />
suppose un rapport dialectique <strong>en</strong>tre des données quantitatives, sociodémographiques et épidémiologiques, que<br />
peut recueillir un organisme expert, et des données qualitatives obt<strong>en</strong>ues par des approches de proximité s’inspirant<br />
du modèle anthropologique de l’<strong>en</strong>quête-participation et du modèle sociologique de l’action-recherche. S’appuyant<br />
sur <strong>la</strong> distinction anthropologique <strong>en</strong>tre trois modes différ<strong>en</strong>ts de construction de <strong>la</strong> <strong>santé</strong> et de <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die : ma<strong>la</strong>die<br />
diagnostiquée par les experts (disease), ma<strong>la</strong>die perçue par <strong>la</strong> personne (illness), ma<strong>la</strong>die définie par le groupe social<br />
(sickness).<br />
Trois types de données sont à ret<strong>en</strong>ir :<br />
• données épidémiologiques et médicales produites par les professionnels du diagnostic et du soin,<br />
• données psychosociales sur <strong>la</strong> <strong>santé</strong> et <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die vécues dont les experts sont les habitants du territoire,<br />
• données socio-anthropologiques approchée par <strong>la</strong> compréh<strong>en</strong>sion des usages prév<strong>en</strong>tifs et curatifs<br />
traditionnels sur les lieux ou/et propres aux communautés qui s’y sont installées.<br />
Le diagnostic fournit une première évaluation de <strong>la</strong> situation et dégage les objectifs à partir desquels construire le<br />
référ<strong>en</strong>tiel d’évaluation. Les élém<strong>en</strong>ts de ce référ<strong>en</strong>tiel doiv<strong>en</strong>t être établis de manière concertée par les différ<strong>en</strong>ts<br />
acteurs de sorte que l’évaluation aide les divers opérateurs à progresser et stimule leur implication. Il <strong>en</strong> va du<br />
caractère transversal et part<strong>en</strong>arial de <strong>la</strong> démarche de projet territorial comme de sa dim<strong>en</strong>sion évolutive. Enfermer<br />
les processus d’évaluation dans un protocole rigide serait contreproductif et démobilisateur <strong>pour</strong> les opérateurs car<br />
son développem<strong>en</strong>t ne peut être strictem<strong>en</strong>t programmé dans ce type d’action. La démarche évaluative doit rester<br />
souple et révisable L’activation périodique des procédures de recueil des données évaluatives doit ainsi accompagner<br />
l’action, r<strong>en</strong>seignant régulièrem<strong>en</strong>t les acteurs sur le développem<strong>en</strong>t du projet, ses effets et l’évolution de <strong>la</strong><br />
situation.<br />
47