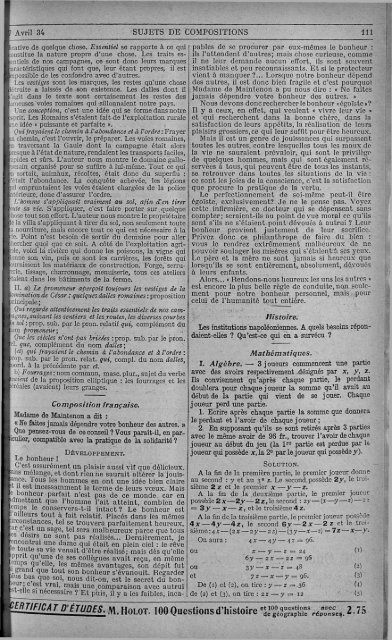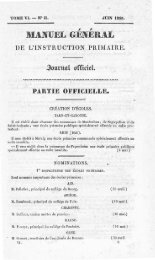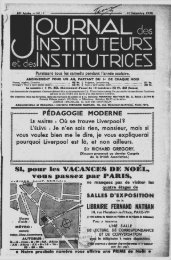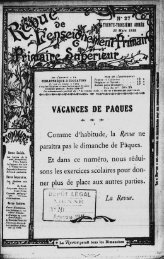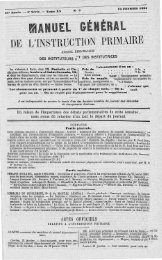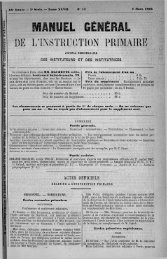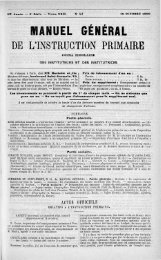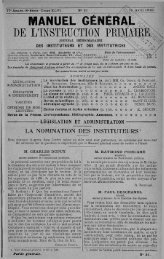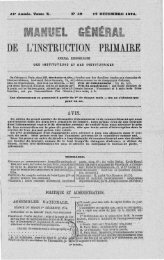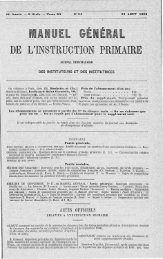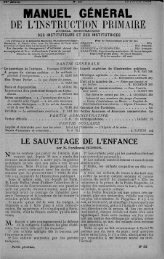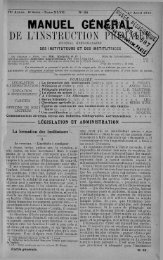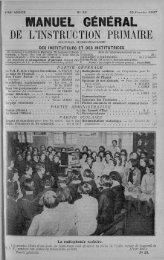MANUEL GÉNÉRAL DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE - INRP
MANUEL GÉNÉRAL DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE - INRP
MANUEL GÉNÉRAL DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE - INRP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Avril 34 SUJETS <strong>DE</strong> COMPOSITIONS 111<br />
icative de quelque chose. Essentiel se rapporte à ce qui<br />
institue la nature propre d'une chose. Les traits es-<br />
;cntiels de nos campagnes, ce sont donc leurs marques<br />
laràctéristiques qui font que, leur étant propres, il est<br />
mpossible de les confondre avec d'autres.<br />
Les vestiges sont les' marques, les restes qu'une chose<br />
létruite a laissés de son existence. Les dalles dont il<br />
i'agit dans le texte sont certainement les restes des<br />
ameuses voies romaines qui sillonnaient notre pays.<br />
Une conception, c'est une idée qui se forme dans notre<br />
isprit. Les Romains s'étaient fait de l'exploitation rurale<br />
ine idée « puissante et parfaite ».<br />
Qui frayaient le chemin à l'abondance et à l'ordre: Frayer<br />
m chemin, c'est l'ouvrir, le préparer. Les voies romaines,<br />
in traversant la Gaule dont la campagne était alors<br />
>resque à l'état de nature, rendaient les transports faciles,<br />
apides et sûrs. L'auteur nous montre le domaine galloomain<br />
organisé pour se suffire à lui-même. Tout ce qui<br />
:n sortait, animaux, récoltes, était donc du superflu :<br />
:'était l'abondance. La conquête achevée, les légions<br />
lui empruntaient les voies étaient chargées de la police<br />
Intérieure, donc d'assurer l'ordre.<br />
I L'homme s'appliquait vraiment au sol, afin d'en tirer<br />
loitte sa vie. S'appliquer, c'est faire porter sur,quelque<br />
Ihose tout son effort. L'auteur nous montre le propriétaire<br />
Ee la villa s'appliquant à tirer du sol, non seulement toute<br />
la nourriture, mais encore tout ce qui est nécessaire à la<br />
|'ie. Point n'est besoin dé sortir du domaine pour aller<br />
Ihercher quoi que ce soit. A côté de l'exploitation agricole,<br />
voici là rivière qui donne les poissons,' la vigne qui<br />
Bonne son vin, puis ce sont les carrières, les forêts qui<br />
fournissent les matériaux de construction. Forge, serrurerie,<br />
tissage, charronnage, menuiserie, tous ces ateliers<br />
Itaient dans les bâtiments de la ferme.<br />
I II. a) Le promeneur aperçoit toujours les vestiges de la<br />
nomination de César : quelques dalles romaines : proposition<br />
principale ;<br />
I Qui regarde attentivement- les traits essentiels de nos camwagnes,<br />
suivant les sentiers et les routes, les diverses courbes<br />
I" sol : prop. sub. par le pron. relatif qui, complément du<br />
«om promeneur-,<br />
I Que les siècles n'ont pas brisées :prop. sub. par le pron.<br />
[cl. que, complément du nom dalles ;<br />
I (et) qui frayaient le chemin à l'abondance et à l'ordre :<br />
wrop. sub. par le pron. relat. qui, compl. du nom dalles,<br />
loord. à la précédente par et.<br />
I b) F outrages : nom commun, masc. plur., sujet du verbe<br />
tmicnt de la proposition elliptique : les fourrages et les<br />
lércales (avaient) leurs granges.<br />
Composition française.<br />
I Madame de Mamtenon a dit :<br />
| « Ne faites jamais dépendre votre bonheur des autres. »<br />
I Que psnsez-vous de ce conseil ? Vous paraît-il, en particulier,<br />
compatible avec la pratique de la solidarité ?<br />
S T DÉVELOPPEMENT.<br />
| Le honheur 1<br />
I C'est assurément un plaisir aussi vit que délicieux.<br />
|ans mélange, et dont rien ne saurait altérer ia 'jouisiance.<br />
Tous les hommes en ont une idée bien claire<br />
| '1 est incessamment le terme de leurs vœux. Mais<br />
|e bonheur parfait n'est pas de ce monde, car en<br />
Bumettant que l'homme l'ait atteint, combien de<br />
lemps le conservera-t-il intact ? Le bonheur est<br />
|i ailleurs tout à fait relatif. Placés dans les mêmes<br />
[îrconstances, tel se trouvera parfaitement heureux,<br />
r'J c .® s . u n sa ge, tel sera malheureux parce que tous<br />
• désirs ne sont pas réalisés... Dernièrement, je<br />
Rencontrai une dame qui était en plein ciel : le rêve<br />
f e toute sa vie venait d'être réalise; mais dès qu'elle<br />
jppnt qu une de ses collègues avait reçu, en même<br />
' mps qu elle, les mêmes avantages, son dépit fut<br />
ï!i,?,!' a l ncl 1 ue son bonheur s'évanouit. Regarder<br />
Ko, . v "i! 116 s ? 1 ' no . us dit-on, est le secret du bon-<br />
Ict In?<br />
es / Vra '' F 113 ' 3 un e comparaison avec autrui<br />
|<br />
S1 nécessaire ? Et puis, il y a les faibles, inca<br />
pables de se procurer par eux-mêmes le bonheur :<br />
ils l'attendent d'autres; mais chose curieuse, comme<br />
il ne leur demande aucun effort, ils sont souvent<br />
insatiables et peu reconnaissants. Et si le protecteur<br />
vient à manquer ?... Lorsque notre bonheur dépend<br />
des autres, il est donc bien fragile et c'est pourquoi<br />
Madame de Maintenon a pu nous dire : « Ne faites<br />
jamais dépendre votre bonheur des autres. »<br />
Nous devons donc rechercher le bonheur «égoïste»?<br />
Il y a ceux, en effet, qui veulent « vivre leur vie »<br />
et qui recherchent dans la bonne chère, dans la<br />
satisfaction de leurs appétits, la réalisation de leurs<br />
plaisirs grossiers, ce qui leur suffit pour êLre heureux.<br />
Mais il est un genre de jouissances qui surpassent<br />
toutes les autres, contre lesquelles tous les maux de<br />
la vie ne sauraient prévaloir, qui sont le privilège<br />
de quelques hommes, mais qui sont également réservées<br />
à tous, qui peuvent être de tous les instants,<br />
se retrouver dans toutes les situations de la vie :<br />
ce sont les joies de la conscience, c'est la satisfaction<br />
que procure la pratique de la vertu.<br />
Le perfectionnement de soi-même peut-il être<br />
égoïste, exclusivement? Je ne le pense pas. Voyez<br />
cette infirmière, ce docteur qui se dépensent sans<br />
compter; seraient-ils au point de vue moral ce qu'ils<br />
sont s'ils ne s'étaient point dévoués à autrui ? Leur<br />
bonheur provient justement de leur sacrifice.<br />
Privez donc ce philanthrope de faire du bien :<br />
vous le rendrez extrêmement malheureux de ne<br />
pouvoir soulager les misères qui s'étalent ii ses yeux.<br />
Le père et la mère no sont jamais si heureux que<br />
lorsqu'ils se sont entièrement, absolument, dévoués<br />
à leurs enfants.<br />
Alors... c Rendons-nous heureux les uns les autres »<br />
est encore la plus belle règle de conduite, non seulement<br />
pour notre bonheur personnel, mais pour<br />
celui de l'humanité tout entière.<br />
Histoire.<br />
Les institutions napoléoniennes. A quels besoins répondaient-elles<br />
? Qu'est-ce qui en a survécu ?<br />
Mathématiques.<br />
I. Algèbre.— 3 joueurs commencent une partie<br />
avec des avoirs respectivement désignés par x, y, z.<br />
Ils conviennent qu'après chaque partie, le perdant<br />
doublera pour chaque joueur la somme qu'il avait au<br />
début de la partie qui vient de se jouer. Chaque<br />
j oueur perd une partie.<br />
1. Ecrire après chaque partie la somme que donnera<br />
le perdant et l'avoir de chaque j oueur ;<br />
2 En supposant qu'ils se sont retirés après 3 parties<br />
avec le même avoir de 96 fr., trouver l'avoir de chaque<br />
joueur au début du jeu (la l re partie est perdue par le<br />
joueur qui possède x, la 2° par le joueur qui possède y).<br />
SOLUTION.<br />
A la fin de la première partie, le premier joueur donne<br />
au second : y et au 3 8 z. Le second possède 2y, le troisième<br />
2 z et le premier x — y — z.<br />
A la fin de la deuxième partie, le premier joueur<br />
possède2x—2y—2z,le second : 2y—[x—y—2)—<br />
•= 3 y — x— z, et le troisième4z.<br />
A la fin de la troisième partie, le premier joueur possède<br />
4x — 4y—4z, le second 6 y—2 x — 2 z et le troisième^—<br />
(2X—2 y — 2 2) -— (3 y—*—*) — 7z—*—y.<br />
On aura : 4 * — 4y — 4; = 96.<br />
ou x — y — 2 = 2+ (0<br />
6 y — 2X — 22 = 96<br />
ou 3 y — x — z = 48 (-)<br />
et 72 — x — y = 96. (3)<br />
De (r) et (2), on tire : y — z = .36 (4)<br />
de (2) et (3}, on tire : 2z — y = 12 (5)<br />
'ER TIF ICA T D'ÉTunFS. M. Holot. 10o Questions d'histoire ré*£s%. 2.75<br />
21