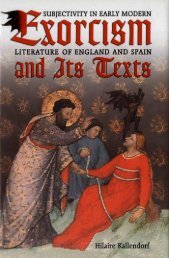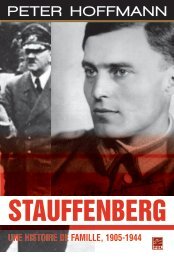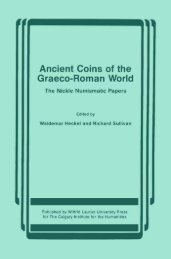La présence des Métis dans les pensionnats
La présence des Métis dans les pensionnats
La présence des Métis dans les pensionnats
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>La</strong> <strong>présence</strong> <strong>des</strong> <strong>Métis</strong> <strong>dans</strong> <strong>les</strong> <strong>pensionnats</strong> : Analyse de la recherche<br />
peu disposée à envoyer plus de travailleurs parmi <strong>les</strong> <strong>Métis</strong>, et Mgr P<strong>les</strong>sis suggéra de prendre <strong>des</strong> mesures<br />
pour préparer <strong>les</strong> Autochtones de la région à effectuer le travail de l’Église pour <strong>les</strong> générations à venir.<br />
Le gouverneur estima également que l’école devait être à Saint-Boniface.<br />
Les missionnaires décrivirent souvent en termes élogieux le potentiel <strong>des</strong> Autochtones. Monsieur Selkirk<br />
écrivait à Mgr P<strong>les</strong>sis : « Monsieur de Lorimier m’informe que <strong>les</strong> habitants et, particulièrement, <strong>les</strong> vieux<br />
voyageurs canadiens et leurs famil<strong>les</strong> métisses sont <strong>dans</strong> une excellente disposition pour profiter <strong>des</strong><br />
enseignements <strong>des</strong> missionnaires et que <strong>les</strong> Indiens ont également fait preuve d’un respect ce qui nous<br />
permet de supposer qu’ils seront également disposés à écouter » (Rempel, 1973:107).<br />
Mgr Provencher était convaincu que l’éducation pourrait profiter aux Autochtones; il écrit : « Si nous<br />
avions quelques religieuses pour l’instruction <strong>des</strong> fil<strong>les</strong>, el<strong>les</strong> auraient déjà du travail » (1973:108). Les<br />
deux premiers élèves à étudier à l’école Saint-Boniface, devenue plus tard le Collège de Saint-Boniface,<br />
étaient un <strong>Métis</strong> (Chénier) et un Canadien-français (Sénécal). Le programme d’étu<strong>des</strong> était ainsi décrit :<br />
« Ils ont déjà étudié tout l’épitome, De Viris Illustibus, Cornelius Nepas, <strong>les</strong> quatre Évangi<strong>les</strong> et <strong>les</strong> Actes<br />
<strong>des</strong> Apôtres, ainsi que la moitié de l’Imitation; ils ont aussi couvert quelque peu la géographie et copient<br />
maintenant <strong>des</strong> bel<strong>les</strong>-lettres » (1973:111). Ces mots nous indiquent que l’éducation offerte était plutôt<br />
limitée et qu’il faut continuer pour assurer l’avenir <strong>des</strong> enfants autochtones. En général, l’échec <strong>des</strong> étu<strong>des</strong><br />
<strong>dans</strong> la première partie du XIXe siècle chez <strong>les</strong> catholiques est dû au fait que l’éducation et le programme<br />
d’étu<strong>des</strong> offerts par <strong>les</strong> prêtres et <strong>les</strong> religieuses étaient incompatib<strong>les</strong> avec le mode de vie <strong>des</strong> <strong>Métis</strong> et que<br />
le programme n’était pas réellement pertinent.<br />
Au début <strong>des</strong> années 1830, on s’éloigna clairement de l’approche traditionnelle de l’enseignement aux<br />
Autochtones, avec la venue du père Belcourt et de l’institutrice, Mademoiselle Nolin, qui était métisse. À<br />
Baie Saint-Paul, situé à environ trente mil<strong>les</strong> de <strong>La</strong> Fourche (à la jonction <strong>des</strong> rivières Assiniboine et Rouge),<br />
le père Belcourt commença son travail de missionnaire en soulignant l’importance de l’enseignement de<br />
l’agriculture et de la création de lots agrico<strong>les</strong> pour <strong>les</strong> Ojibways et <strong>les</strong> <strong>Métis</strong>. Il croyait fermement qu’il<br />
était nécessaire d’aider <strong>les</strong> Autochtones à mener une vie sédentaire avant qu’on ne puisse <strong>les</strong> évangéliser.<br />
Mgr Provencher, son supérieur, avait un point de vue diamétralement opposé à cet égard. Le père Belcourt<br />
apprit la langue ojibway et enseigna aux gens <strong>dans</strong> leur propre langue, contrairement à l’approche catholique<br />
de l’éducation autochtone qu’ont connue <strong>les</strong> générations suivantes. En 1834, le père Belcourt prétendit que<br />
son expérience avait été couronnée de succès et affirma que <strong>les</strong> Indiens pouvaient semer et moissonner.<br />
Mademoiselle Nolin accomplissait un bon travail auprès <strong>des</strong> Autochtones et parlait couramment leur<br />
langue. Cependant, ce genre d’éducation offert par le père Belcourt ne devint pas une norme parmi <strong>les</strong><br />
missionnaires catholiques qui travaillaient avec <strong>les</strong> <strong>Métis</strong> <strong>des</strong> Gran<strong>des</strong> Plaines du Nord.<br />
En 1843, <strong>les</strong> Sœurs Grises ont été <strong>les</strong> premières religieuses catholiques à Rivière-Rouge à travailler auprès<br />
<strong>des</strong> <strong>Métis</strong>. Plusieurs autres ordres <strong>les</strong> suivirent <strong>dans</strong> l’Ouest canadien. Un <strong>des</strong> plus célèbre était <strong>les</strong> Sœurs de<br />
Notre-Dame <strong>des</strong> Missions. Lorsqu’elle établit <strong>des</strong> éco<strong>les</strong> de missionnaires <strong>dans</strong> <strong>les</strong> communautés métisses,<br />
l’Église catholique enleva aux parents métis le rôle significatif qu’ils pouvaient jouer <strong>dans</strong> l’éducation de<br />
leurs enfants. Le contrôle demeurait ainsi entre <strong>les</strong> mains de l’Église. Les parents n’avaient pas leur mot à<br />
dire sur la façon dont <strong>les</strong> éco<strong>les</strong> étaient administrées ni sur le contenu du programme d’étu<strong>des</strong>. Une <strong>des</strong><br />
pratiques <strong>les</strong> plus controversées de l’Église au sein <strong>des</strong> éco<strong>les</strong> qu’elle administrait était la tentative d’éliminer<br />
la culture métisse en substituant leur langue mechif pour la langue canadienne-française. Ils jugeaient la<br />
langue mechif inférieure au français universel que l’on retrouvait <strong>dans</strong> <strong>les</strong> livres et qui était enseigné <strong>dans</strong><br />
15