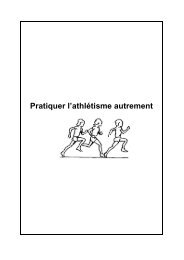Séminaire des Entretiens de l'INSEP
Séminaire des Entretiens de l'INSEP
Séminaire des Entretiens de l'INSEP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Les motivations profon<strong><strong>de</strong>s</strong> et intermédiaires sont indispensables à la préparation et à la construction <strong>de</strong> la<br />
performance, mais elles sont en même temps, et paradoxalement, à l’origine <strong><strong>de</strong>s</strong> phénomènes inhibiteurs<br />
(schéma 4.1) : Loin <strong>de</strong> l’action, les inhibitions n’ont pas d’effet direct sur la qualité du geste. A<br />
l’approche, à l’imminence <strong>de</strong> l’action, elles peuvent être directement <strong><strong>de</strong>s</strong>tructrices. La façon la plus<br />
efficace <strong>de</strong> les désactiver est, en fait, d’activer fortement, à leur place, les motivations immédiates<br />
productrices <strong>de</strong> qualité gestuelle. Le meilleur moyen <strong>de</strong> faciliter ce type motivation est <strong>de</strong> mettre en place<br />
une organisation <strong>de</strong> la pensée appliquée à réaliser, réactiver, puis renforcer un objet mental parfaitement<br />
i<strong>de</strong>ntifié, issu du savoir même <strong>de</strong> l’athlète. Ce modèle <strong>de</strong> préparation se divise en <strong>de</strong>ux phases :<br />
- une phase d’i<strong>de</strong>ntification / création / stockage.<br />
- une phase d’utilisation (réactivation/renforcement)<br />
I<strong>de</strong>ntifier / créer / stocker :<br />
A/ un geste <strong>de</strong> référence (schéma 1) : A partir <strong>de</strong> l’ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong> composantes techniques fondamentales<br />
acquises, sélectionner (par les choix techniques stratégiques) celles qui constitueront le geste technique<br />
<strong>de</strong> référence. Il se présente sous la forme d’une séquence d’opérations, et <strong>de</strong> leurs liaisons. C’est tout<br />
l’objet <strong>de</strong> l’apprentissage technique. Cette séquence est ensuite « traduite » en termes <strong>de</strong> sensations<br />
correspondant à chaque opération. Cette séquence <strong><strong>de</strong>s</strong> sensations constitue le geste mental <strong>de</strong> référence .<br />
Lorsqu’il est fixé comme but à la création mentale, il <strong>de</strong>vient l’objet mental à l’activation duquel doit<br />
s’appliquer la volonté du moment. L’entraînement consiste ensuite à stocker en mémoire la séquence<br />
mentale (mise en œuvre <strong><strong>de</strong>s</strong> processus habituels d’apprentissage). L’i<strong>de</strong>ntification et la traduction <strong>de</strong> ce<br />
geste <strong>de</strong> référence en termes <strong>de</strong> sensations sont réalisées par visualisation mentale . Nous savons que la<br />
visualisation mentale peut prendre diverses formes (Globalement : Associée : travail sur les sensations<br />
kinesthésiques. Dissociée : travail sur l’auto-image <strong>de</strong> l’athlète en action). Personnellement, j’ai opté<br />
pour une visualisation mentale associée, assortie d’ancrages temporels (rythmes) : Les athlètes i<strong>de</strong>ntifient<br />
les sensations kinesthésiques vécues dans la production du geste <strong>de</strong> référence et le rythme dans lequel<br />
elles sont assemblées. Ils travaillent à préciser, et en même temps à simplifier ce contenu. Puis à le<br />
stocker et enfin à le restituer. L’essentiel <strong>de</strong> leur entraînement mental est axé :<br />
- sur le vécu conscient <strong>de</strong> sensations simples, et peu nombreuses, mais assurant la production <strong>de</strong><br />
l’ensemble du geste complexe. Certains athlètes sont parvenus à i<strong>de</strong>ntifier leur geste <strong>de</strong> référence par une<br />
ou <strong>de</strong>ux sensations kinesthésiques puissantes, qui suffisent à le caractériser et qui entraînent la chaîne <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
automatisés <strong>de</strong> façon sûre<br />
- sur le stockage <strong>de</strong> cette « signature kinesthésique » , par activation <strong>de</strong> la volonté <strong>de</strong> mémoire.<br />
Dans cette phase, l’essentiel <strong>de</strong> l’énergie mentale, et <strong>de</strong> l’activité cérébrale <strong>de</strong> l’athlète, est appliquée à<br />
fixer la conscience sur l’existence et le contenu concret, palpable, <strong>de</strong> cet objet mental. (Il est d’ailleurs<br />
intéressant <strong>de</strong> noter que cette tâche préfigure celle qui lui sera <strong>de</strong>mandée en compétition. Ainsi,<br />
entraînement et compétition ne sont plus considérés comme <strong>de</strong>ux mon<strong><strong>de</strong>s</strong> séparés, <strong>de</strong>ux environnements<br />
différents nécessitant <strong><strong>de</strong>s</strong> conduites différentes).<br />
La visualisation mentale (en particulier associée) met en œuvre <strong><strong>de</strong>s</strong> processus d’activité cérébrale<br />
extrêmement proches <strong>de</strong> l’activité motrice : siège i<strong>de</strong>ntique <strong>de</strong> l’activité (cortex pré-moteur notamment),<br />
intensité, et durée. Je renvoie pour cela aux récents et nombreux travaux <strong><strong>de</strong>s</strong> chercheurs en neurosciences<br />
sur ce sujet. Pourquoi avoir fait le choix préférentiel <strong>de</strong> sensations kinesthésiques dans la construction <strong>de</strong><br />
la séquence mentale ? J’ai pu observer en particulier chez les athlètes plus exposés à une trop forte<br />
pression <strong>de</strong> l’image et <strong>de</strong> l’estime <strong>de</strong> soi, que l’utilisation <strong>de</strong> sensations kinesthésiques leur permettait <strong>de</strong><br />
« débrancher » plus sûrement et plus facilement leurs tendances à valoriser (ou à dévaloriser) leur ego. Je<br />
rappelle aussi que ce choix s’inscrit dans un contexte gestuel bien caractérisé : l’activité corporelle d’un<br />
tireur, d’un tireur à l’arc, voire d’un golfeur n’est en rien comparable à celle d’un sauteur en hauteur,<br />
d’un perchiste ou d’un gymnaste : leur « géométrie gestuelle » n’est pas aussi extériorisée, ni donc aussi<br />
évi<strong>de</strong>nte à appréhen<strong>de</strong>r. La nécessité et les moyens <strong>de</strong> l’évaluation sont également différents.<br />
27