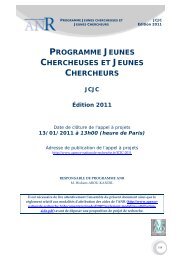Bulletin num. 33 du 25-03-2011 - Institut des Amériques
Bulletin num. 33 du 25-03-2011 - Institut des Amériques
Bulletin num. 33 du 25-03-2011 - Institut des Amériques
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Transaméricaines65 sur 111 <strong>25</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2011</strong> 10:44Ce colloque s’attachera à examiner le regard porté sur la France et les Français par lepublic anglo-américain <strong>des</strong> XVIIe et XVIIIe siècles. Il permettra une réflexion sur laperception d'une réalité étrangère, sur la notion de stéréotype ou d'« écran culturel »,sur tous ces aprioris et systèmes appris ou pré-construits qui pré-structurent notreperception de l'autre et de l'étranger, aboutissant à ce que Husserl et Merleau-Ponty ontthéorisé en évoquant la notion <strong>du</strong> jugement antéprédicatif. De la francophobiesystématique à la francophilie fantasmée, amenées par une connaissance réelle issue del'expérience et de l'observation ou bien au contraire véhiculées par la diffusiond'ouïe-dires ou de préjug&ea! cute;s arbitraires, tous les jugements ou attitu<strong>des</strong> face àl'ennemi ou à l'ami français jalonnent et façonnent deux nations elles-mêmes en quête,à <strong>des</strong> degrés divers, d'une véritable identité nationale. Dans tous les cas, la réflexionpermettra de vérifier ou d’infirmer le principe selon lequel : « esse est percipi »(« être,c’est être perçu »). Dans le domaine anglais, les premiers mots qui viendront àl’espritseront vraisemblablement ceux de « rivalité », d'« incompréhension » ou d'«étrangeté », tant les rapports entre les deux nations étaient ten<strong>du</strong>s à une époqueparticulièrement complexe sur le plan politique, que l’historien John Robert Seeleyn'hésita pas au XIXe siècle à appeler « la seconde Guerre de Cent Ans ». Pourtant, leconflit dépassait largement la simple rivalité commerciale ou stratégique, car il s’agissaitbien plus d’une opposition entre deux systèmes, voire entre deux visions <strong>du</strong> monde quel’on pourra décliner par exemple selon les paradigmes suivants : la « tyrannie »française contre la « liberté » anglaise ; le catholicisme contre le protestantisme ; ! lethéisme contre le déisme ; le mercantilisme contre le libre échange ; le cartésianismecontre l’empirisme, /etc/. Des deux côtés de la Manche, philosophes, religieux etpolitiques discutaient sans relâche <strong>des</strong> avantages et <strong>des</strong> inconvénients <strong>des</strong> deuxsystèmes, non sans contresens, aprioris ou malhonnêtetés d’une part ou de l’autre.Dans le monde américain, les Français sont également vus comme ces voisins papistes etenvahissants, alliés <strong>des</strong> nations indiennes, contre lesquels les colonies luttent tout aulong <strong>du</strong> XVIIIe siècle. On pourra ainsi s’interroger sur les formes que prirent, dans lesécrits puritains ou les premiers journaux <strong>des</strong> colonies, la défiance et l'hostilité envers lescolons français d'Amérique <strong>du</strong> nord et leurs valeurs, ou supposées valeurs. Après ladéfaite française en Amérique <strong>du</strong> nord en 1763, et le soutien de la France aux coloniesrebelles entre 1778 et 1781, la France et les Français ont-ils été immédiatement perçusdifféremment, et si oui par qui ?Cependant, ce qu’on a appelé la deuxième « République <strong>des</strong> Lettres », laquelleévidemment n’exclut en rien l’univers américain, était également un centre d’influencesmutuelles détaché <strong>des</strong> antagonismes politiques, religieux ou économiques, et leséchanges multiples entre les nations, qu’ils fussent teintés de méfiance, de scepticisme,d’admiration ou de fascination, focalisent l’intérêt et l’attention <strong>du</strong> monde angloaméricainsur la culture de ce dérangeant « voisin » d’outre-Manche ou d’outre-Atlantique.Dans le domaine américain, où peu de Fondateurs sont au final de réels francophiles(pas même peut-être Jefferson…), on pourra ainsi se demander quel rôle jouavéritablement l'expérience française dans la carrière politique ultérieure <strong>des</strong> diplomatesaméricains qui ont séjourné en France entre 1776 et 1789, sans parler de ceux qui leursuccédèrent. Tout comme en Angleterre, la Révolution française joue un rôle majeur auxÉtats-Unis après 1789, passionnant le pays, <strong>des</strong> gouvernants au peuple. La perception etla représentation de la France et <strong>des</strong> Français sont au cœur <strong>du</strong> débat politique national,à travers caricatures, toasts et articles de journaux, d'autant que les rues <strong>des</strong> villesaméricaines s'emplissent d'émigrés, de réfugiés de Saint-Domingu! e et autresboulangers ou maîtres de danse français, avant que les armées victorieuses de laRévolution n'impriment une image martiale, et menaçante, sur la psyché d'un paysattaché à la démocratie et au libre commerce. On pourra donc s'interroger sur les formesvariées et toujours en évolution que prirent ces représentations de la France dans lajeune Amérique de la deuxième moitié <strong>du</strong> XVIIIe siècle, à travers correspondancesprivées, journaux et illustrations.L’Angleterre avait, elle aussi, besoin de son ennemie intime, ne serait-ce que pour se