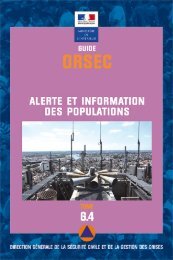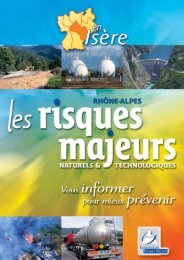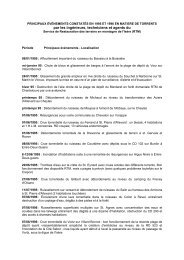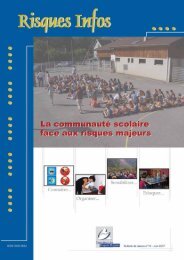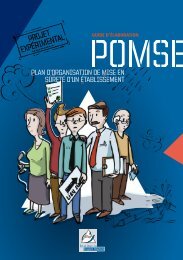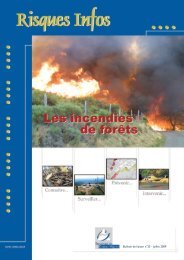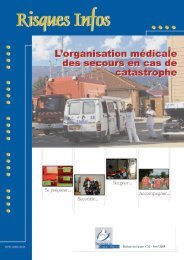Adeline MARCHISIO
Adeline MARCHISIO - Institut des risques majeurs
Adeline MARCHISIO - Institut des risques majeurs
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
En terme de communication, on peut qualifier ce principe de "B to C" (Business to Consumer).Ce type de communication est caractérisé par un émetteur spécialiste du sujet (Business)s'adressant à un récepteur "non scientifique" (Consumer). L'information communiquée estvulgarisée par l'émetteur savant qui s'adapte à son public. Cette méthode est souvent employéepour élaborer des documents "grand public", de vulgarisation et d'information générale tels que lesDICRIM par exemple.Toutefois, prise dans ce contexte, l'information n'est en rien de la communication. Lespécialiste se contente de transmettre une information vulgarisée sans attendre de son récepteurune réaction ou une rétroaction. De plus, en général, la vulgarisation de l'information n'est pas uneadaptation qualitative du message pour le public néophyte mais plutôt une réduction quantitative dela masse d'information pour donner au public seulement l'essentiel. Cette méthode ne permet doncpas à la population d'être en possession de tous les éléments pour comprendre et participer audébat avec les professionnels des risques et les administrateurs.Pour une meilleure efficacité de cette information vulgarisée, il est intéressant de prendre encompte la perception du public visé. « Si l'on interroge un habitant en recourant explicitement auxcatégories habituellement utilisées par les gestionnaires du risque, c'est-à-dire en utilisant lesnotions de risque, de prévention, de zonage, etc., il est probable qu'on ne recueillera, dans denombreux cas, qu'une information pauvre. […] Il est alors facile de conclure, souvent à tort, à unefaible perception du danger ou à l'indifférence de certains riverains. […] Par contre, c'est en prenantle temps de comprendre ce qui organise le quotidien que l'on accède aux mécanismes quistructurent les représentations du danger. […] » 22 En se mettant à portée de son interlocuteur,l'information préventive est mieux adaptée aux sensibilités des habitants, et permet de passer de lasimple information à une meilleure communication entre le spécialiste et le public.Nous noterons donc qu'il est en effet prioritaire d'ajuster le message du spécialiste pourfaciliter la compréhension du grand public. Malgré cela, pour que l'information soit tout à faitadaptée à son récepteur, il est indispensable d'évaluer et de cibler précisément quelle catégorie dela population est visée.2.1.2 Le "grand public", une entité hétérogène et variéeAujourd'hui, l'information ne peut plus concerner un public cible unique. En effet, la populationn'est pas un groupe uniforme et homogène. Elle est constituée de classes d'âges différentes et decatégories socioprofessionnelles plus ou moins attentives à ces préoccupations, d'implantationsgéographiques plus ou moins menacées. Selon l'histoire et les antécédents de leur territoire, lespopulations sont aussi plus ou moins réceptives à une information sur les risques majeurs. Lesrisques touchent des populations extrêmement variées ce qui pose un certain nombre de problèmeslorsque l'on s'intéresse à l'information et à la communication dans ce domaine. « En effet, commedans toute démarche de communication, on ne s'adresse pas de la même manière envers tous les22 COANNUS Thierry, DUCHENE François, MARTINAIS Emmanuel, Démocratisation de la culture du risque, Prendre en comptela perception des non-spécialistes, pages 98 à 101, in DUBOIS-MAURY Jocelyne, Les risques industriels et technologiques, Ladocumentation française, 2002, 120 p. (Problèmes politiques et sociaux ; 882)<strong>MARCHISIO</strong> <strong>Adeline</strong> MASTER 2 Recherche "Sciences du Territoire" 17