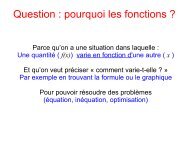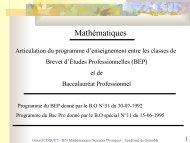You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CLASSE TERMINALE : LA PERSPECTIVE CENTRALEL’enseignement de l’option de la classe de première a muni les élèves d’un certain nombre de résultats de géométrie de l’espace, et enparticulier des théorèmes régissant les positions relatives des droites et des plans. Ils disposent également d’un moyen commode dereprésentation de l’espace, utilisé non seulement en géométrie mais également dans certaines professions : la perspective parallèle. Les élèvesvont maintenant aborder un autre mode de représentation, qui fait son apparition au 15 e siècle en Italie (Brunelleschi, Alberti…) puis dans lespays du Nord (Albrecht Dürer, Jean Pélerin dit Viator, Abraham Bosse…), et qui a régi les arts graphiques pendant près de cinq cents ans : laperspective centrale, encore appelée perspective artificielle, ou perspective linéaire, ou perspective à point de fuite, ou perspective vraie, ouperspective des peintres…. N’oublions pas non plus les progrès que cette perspective a fait réaliser à la géométrie, en particulier avec les travauxde Girard Desargues, disciple du graveur Abraham Bosse qui est à l’origine de la géométrie projective.L’étude peut se décomposer en plusieurs temps :1° étude expérimentale de l’ombre dite « au flambeau »2° étude de la « fenêtre de Dürer »3° étude géométrique de la projection centrale sur un plan4° mise en œuvre de la perspective centrale.Dans l’option de la classe de première, la perspective parallèle a été introduite comme une modélisation géométrique du phénomène de l’ombreportée par le soleil sur un plan. Nous allons cette fois, tout en suivant la même démarche, remplacer le soleil (que nous avions supposé « àl’infini ») par une source lumineuse, supposée ponctuelle, située à distance finie, afin d’étudier l’ombre qu’elle porte sur un plan donné (c’est cequ’on appelle l’ombre « au flambeau ») ; pour fixer les idées et par analogie avec ce qui a été fait pour l’ombre au soleil, nous supposerons icique ce plan est le sol (horizontal). Dans un premier temps, les élèves pourront, en travail personnel, s’intéresser aux principales propriétés del’ombre portée sur le sol par une source lumineuse unique (lampe, lampadaire…), et en particulier chercher à savoir si les propriétés déjàrencontrées pour l’ombre au soleil sont encore vérifiées par l’ombre au flambeau. Une synthèse faite en classe pourra ensuite permettre derésumer les principales observations. Pour justifier les propriétés conjecturées, on réalise des dessins dans des plans qui seront précisés, dessinsqui conduiront à un modèle géométrique et permettront, le cas échéant, d’effectuer des démonstrations de géométrie plane.1. L’ombre au flambeau (synthèse des observations personnelles faites par les élèves)On opère ici le passage de l’ombre au dessin et on poursuit l’étude des propriétés, que l’on applique à la résolution de problèmes de dessin.La lumière émise par la source lumineuse (notée O) se propage en ligne droite. L’observation permet aussi de poser que :- Les rayons lumineux divergent à partir de la source. Ceci est également vrai dans le cas du soleil mais, étant donné son éloignement, nousavons alors admis leur parallélisme.- L’ombre d’un segment est un segment.Soit [AB] un segment et [ab] son ombre.Le schéma réalisé dans le plan du triangle OAB (schéma qu’on pourra compareravec celui réalisé dans le cas de l’ombre au soleil), est du type ci-contre.Les proportions sont-elles conservées sur l’ombre du segment ? On peut certesvérifier (par mesure) que cela ne semble pas être le cas sur le dessin ci-contre,mais on peut également le démontrer, par exemple de la façon suivante.Soit un piquet [AB] planté verticalement dans le sol(horizontal) au point A. Son ombre portée par la source O estle segment [ab] (avec a = A). Soit M le milieu de [AB], et mson ombre.Si m est le milieu de [ab], on est dans la configuration de ladroite des milieux, et on en déduit que (Mm) est parallèle à(Bb), ce qui est contraire à l’hypothèse que ces deux droitesse coupent en O.LOGIQUELa conservation des milieux étant mise en défaut sur ce contre-exemple, on peut conclure qu’elle n’est pas réalisée pour l’ombreau flambeau, et donc qu’il n’y a pas, généralement, conservation du rapport dans une direction donnée (contrairement à ce qui sepasse pour l’ombre au soleil), ni conservation du parallélisme.L’utilisation d’un dispositif simulant le phénomène de l’ombre au flambeau s’avère fort utile comme support matériel pour les conjectures et lesdémonstrations des propriétés de la perspective centrale (voir Annexe).Série L– mathématiques – projet de document d’accompagnement – géométrie – page 11Direction de l’enseignement scolaire – bureau du contenu des enseignements