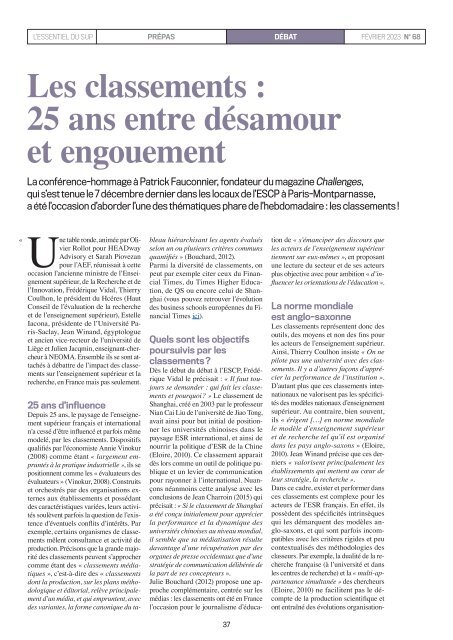L'Essentiel Prépas n°68 - Février 2023
L'Essentiel du Sup Prépas est le magazine numérique dédié aux professeurs des classes préparatoires, aux étudiants et à leurs parents. Chaque mois, retrouvez toute l'actualité des classes préparatoires économiques et commerciales et des Grandes Ecoles. Ce magazine vous est proposé par HEADway Advisory, cabinet de conseil en stratégie dédié à l'enseignement supérieur.
L'Essentiel du Sup Prépas est le magazine numérique dédié aux professeurs des classes préparatoires, aux étudiants et à leurs parents. Chaque mois, retrouvez toute l'actualité des classes préparatoires économiques et commerciales et des Grandes Ecoles. Ce magazine vous est proposé par HEADway Advisory, cabinet de conseil en stratégie dédié à l'enseignement supérieur.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’ESSENTIEL DU SUP PRÉPAS DÉBAT<br />
FÉVRIER <strong>2023</strong> N° 68<br />
Les classements :<br />
25 ans entre désamour<br />
et engouement<br />
La conférence-hommage à Patrick Fauconnier, fondateur du magazine Challenges,<br />
qui s’est tenue le 7 décembre dernier dans les locaux de l’ESCP à Paris-Montparnasse,<br />
a été l’occasion d’aborder l’une des thématiques phare de l’hebdomadaire : les classements !<br />
« Une table ronde, animée par Olivier<br />
Rollot pour HEADway<br />
Advisory et Sarah Piovezan<br />
pour l’AEF, réunissait à cette<br />
occasion l’ancienne ministre de l’Enseignement<br />
supérieur, de la Recherche et de<br />
l’Innovation, Frédérique Vidal, Thierry<br />
Coulhon, le président du Hcéres (Haut<br />
Conseil de l’évaluation de la recherche<br />
et de l’enseignement supérieur), Estelle<br />
Iacona, présidente de l’Université Paris-Saclay,<br />
Jean Winand, égyptologue<br />
et ancien vice-recteur de l’université de<br />
Liège et Julien Jacqmin, enseignant-chercheur<br />
à NEOMA. Ensemble ils se sont attachés<br />
à débattre de l’impact des classements<br />
sur l’enseignement supérieur et la<br />
recherche, en France mais pas seulement.<br />
25 ans d’influence<br />
Depuis 25 ans, le paysage de l’enseignement<br />
supérieur français et international<br />
n’a cessé d’être influencé et parfois même<br />
modelé, par les classements. Dispositifs<br />
qualifiés par l’économiste Annie Vinokur<br />
(2008) comme étant « largement empruntés<br />
à la pratique industrielle », ils se<br />
positionnent comme les « évaluateurs des<br />
évaluateurs » (Vinokur, 2008). Construits<br />
et orchestrés par des organisations externes<br />
aux établissements et possédant<br />
des caractéristiques variées, leurs activités<br />
soulèvent parfois la question de l’existence<br />
d’éventuels conflits d’intérêts. Par<br />
exemple, certains organismes de classements<br />
mêlent consultance et activité de<br />
production. Précisons que la grande majorité<br />
des classements peuvent s’approcher<br />
comme étant des « classements médiatiques<br />
», c’est-à-dire des « classements<br />
dont la production, sur les plans méthodologique<br />
et éditorial, relève principalement<br />
d’un média, et qui empruntent, avec<br />
des variantes, la forme canonique du tableau<br />
hiérarchisant les agents évalués<br />
selon un ou plusieurs critères communs<br />
quantifiés » (Bouchard, 2012).<br />
Parmi la diversité de classements, on<br />
peut par exemple citer ceux du Financial<br />
Times, du Times Higher Education,<br />
de QS ou encore celui de Shanghai<br />
(vous pouvez retrouver l’évolution<br />
des business schools européennes du Financial<br />
Times ici).<br />
37<br />
Quels sont les objectifs<br />
poursuivis par les<br />
classements ?<br />
Dès le début du débat à l’ESCP, Frédérique<br />
Vidal le précisait : « Il faut toujours<br />
se demander : qui fait les classements<br />
et pourquoi ? » Le classement de<br />
Shanghai, créé en 2003 par le professeur<br />
Nian Cai Liu de l’université de Jiao Tong,<br />
avait ainsi pour but initial de positionner<br />
les universités chinoises dans le<br />
paysage ESR international, et ainsi de<br />
nourrir la politique d’ESR de la Chine<br />
(Eloire, 2010). Ce classement apparait<br />
dès lors comme un outil de politique publique<br />
et un levier de communication<br />
pour rayonner à l’international. Nuançons<br />
néanmoins cette analyse avec les<br />
conclusions de Jean Charroin (2015) qui<br />
précisait : « Si le classement de Shanghai<br />
a été conçu initialement pour apprécier<br />
la performance et la dynamique des<br />
universités chinoises au niveau mondial,<br />
il semble que sa médiatisation résulte<br />
davantage d’une récupération par des<br />
organes de presse occidentaux que d’une<br />
stratégie de communication délibérée de<br />
la part de ses concepteurs ».<br />
Julie Bouchard (2012) propose une approche<br />
complémentaire, centrée sur les<br />
médias : les classements ont été en France<br />
l’occasion pour le journalisme d’éducation<br />
de « s’émanciper des discours que<br />
les acteurs de l’enseignement supérieur<br />
tiennent sur eux-mêmes », en proposant<br />
une lecture du secteur et de ses acteurs<br />
plus objective avec pour ambition « d’influencer<br />
les orientations de l’éducation ».<br />
La norme mondiale<br />
est anglo-saxonne<br />
Les classements représentent donc des<br />
outils, des moyens et non des fins pour<br />
les acteurs de l’enseignement supérieur.<br />
Ainsi, Thierry Coulhon insiste « On ne<br />
pilote pas une université avec des classements.<br />
Il y a d’autres façons d’apprécier<br />
la performance de l’institution ».<br />
D’autant plus que ces classements internationaux<br />
ne valorisent pas les spécificités<br />
des modèles nationaux d’enseignement<br />
supérieur. Au contraire, bien souvent,<br />
ils « érigent […] en norme mondiale<br />
le modèle d’enseignement supérieur<br />
et de recherche tel qu’il est organisé<br />
dans les pays anglo-saxons » (Eloire,<br />
2010). Jean Winand précise que ces derniers<br />
« valorisent principalement les<br />
établissements qui mettent au cœur de<br />
leur stratégie, la recherche ».<br />
Dans ce cadre, exister et performer dans<br />
ces classements est complexe pour les<br />
acteurs de l’ESR français. En effet, ils<br />
possèdent des spécificités intrinsèques<br />
qui les démarquent des modèles anglo-saxons,<br />
et qui sont parfois incompatibles<br />
avec les critères rigides et peu<br />
contextualisés des méthodologies des<br />
classeurs. Par exemple, la dualité de la recherche<br />
française (à l’université et dans<br />
les centres de recherche) et la « multi-appartenance<br />
simultanée » des chercheurs<br />
(Eloire, 2010) ne facilitent pas le décompte<br />
de la production scientifique et<br />
ont entraîné des évolutions organisation-