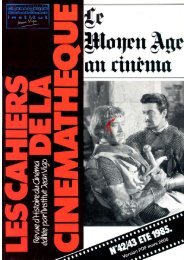LES CAHIERS DE LA CINEMATHEQUE n°1.pdf - Institut Jean Vigo
LES CAHIERS DE LA CINEMATHEQUE n°1.pdf - Institut Jean Vigo
LES CAHIERS DE LA CINEMATHEQUE n°1.pdf - Institut Jean Vigo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
A la vue de certaines images, il manifestait sa joie, au détour de l’intrigue il se taisait, ému et,<br />
haletant, tandis que retombait le silence dans la salle, où ne bourdonnait plus, entre chaque morceau de<br />
l’orchestre, que le chuchotement de ceux qui avaient pris l’habitude de lire les sous-titres à mi-voix.<br />
Il fallait d’ailleurs que « l’intérêt de ce spectacle à la mode ne faiblisse pas et que la curiosité des amateurs<br />
de films soit sans cesse tenue en éveil, puisque partout des foules de plus en plus alléchées restent fidèles<br />
à ce genre de représentation (1). Cette foule résistait difficilement à l’attirance des lumières électriques qui<br />
brillaient sur les façades des deux cinémas et des nombreuses « affiches qui hurlaient sur les murs de la<br />
ville ». Elle venait prendre sa part de rêve et laissait au dehors ses soucis et ses problèmes quotidiens. C’est<br />
de quoi se plaignait, en 1913, le rédacteur de « l’Action syndicale des Pyrénées Orientales », en donnant le<br />
compte-rendu d’une réunion contre la guerre, à laquelle avaient assisté plusieurs délégations de femmes de<br />
la campagne : « j’aurais souhaité, écrivait-il, que celles de Perpignan, qui brillaient par leur absence, se<br />
soient trouvées nombreuses à ce meeting, au lieu de s’intéresser aux séances de cinéma ».<br />
Mais la majorité des gens ne pensaient pas à la guerre. Le soir venu, de longues files de spectateurs se<br />
formaient devant les deux établissements de projections, poussées par une publicité qui n’avait pas encore<br />
l’image à sa disposition dans les journaux (2), et par des communiqués de presse qui choisissaient un style<br />
lyrique et passionné, aux adjectifs rares et percutants pour décrire les drames mondains et les histoires de<br />
mœurs qui proliféraient. La vogue du « sérial », qui allait de plus en plus s’intensifier sur les écrans, pendant<br />
la guerre, avec les film à épisodes, dont chaque partie se terminait par une question angoissante, mobilisa<br />
dans les salles obscures des cohortes de spectateurs avides de connaître « la suite » de ces aventures, la<br />
plupart du temps policières.<br />
Cette floraison d’intrigues se développa entre 1912 et 1914, dans les publications populaires et sur la<br />
pellicule. C’était aussi l’époque de la bande à Bonnot et des « bandits tragiques », dont la presse décrivait<br />
chaque jour les exploits (3). Conscient de l’intérêt que les lecteurs portaient à ce genre de faits-divers, le<br />
cinéma s’empressa de « traduire en image le roman feuilleton, de faire mimer du Rocambole, de rechercher<br />
les incidents les plus émouvants et les plus sensationnels, dans la rubrique des crimes, des rapts, des vols<br />
et des sinistres (4) ». Après les tribulations de « Nick Carter » et de « Zigomar », les péripéties des « Horsla-loi<br />
» et de « la Bande de l’auto grise », on célébra les exploits du maître de l’effroi « Fantomas » et de son<br />
homologue, le bandit femelle « Protea ».<br />
Devant l’engouement du public pour cette apologie du meurtre, cette peinture de milieux parfois<br />
sordides et cette prolifération « d’amours coupables » (5), un mouvement se dessina qui accusa le cinéma<br />
de « tristes agissements de plusieurs bandes de malfaiteurs », « de saper les bases de la société » et<br />
surtout, d’être « une école de perversion » pour la jeunesse. Ce dernier argument servit de thème de<br />
réflexion à deux journalistes locaux : César BOYER et Horace CHAUVET. Ce dernier remarquait que, s’il<br />
n’y avait aucun danger, pour les adultes, à être mis en présence de ce que Baudelaire appelait « la<br />
ménagerie infâme de nos vices », il n’en était pas de même en qui concernait les enfants. A cette époque, le<br />
public se déplaçait par familles entières. Le jeudi après-midi, grâce au demi-tarif, les cinémas étaient pris<br />
d’assaut par les jeunes spectateurs qui descendaient de tous les quartiers populaires, et il était « indécent<br />
de faire passer sous leurs yeux » des scènes de meurtre, « d’adultère et des vues d’orgies scandaleuses ».<br />
(1) Déjà en Décembre 1911, les limonadiers éloignés du centre de la ville étaient unanimes à déclarer<br />
que les représentations cinématographiques leur causaient un préjudice considérable.<br />
(2) Si la publicité cinématographique illustrée apparut à Perpignan à partir de 1924, ainsi que nous le<br />
verrons dans la 3 ème partie, le premier pavé non illustré fut publié dans « L’Indépendant » en Janvier<br />
1914.<br />
(3) CALLEMIN, MONNIER et SOUDY, dont les méfaits défrayèrent la chronique.<br />
(4) Horace CHAUVET ( in « L’Indépendant » du 23 Septembre 1913).<br />
(5) « Peut-être ce succès (celui du cinéma) ne serait-il pas aussi grand si les programmes ne<br />
contenaient parfois des exhibitions que la morale réprouve, des scènes réalisées en des bouges<br />
infects, ou des idylles qui ont cessé d’être platoniques ». (In « L’Indépendant du 23 Septembre<br />
1913).<br />
© Cinémathèque euro-régionale <strong>Institut</strong> <strong>Jean</strong> <strong>Vigo</strong> <strong>LES</strong> <strong>CAHIERS</strong> <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> <strong>CINEMATHEQUE</strong> N° 1 janvier 1971<br />
Arsenal espace des cultures populaires – 1 rue <strong>Jean</strong> Vielledent, 66000 PERPIGNAN Tél. 04.68.34.09.39 Fax. 04.68.35.41.20<br />
courriel : contact@inst-jeanvigo.com site internet : www.inst-jeanvigo.asso.fr<br />
39