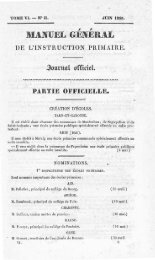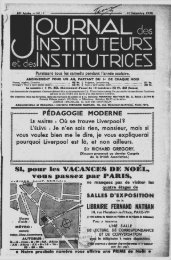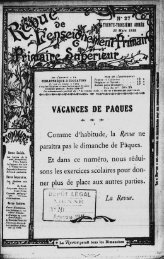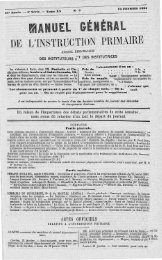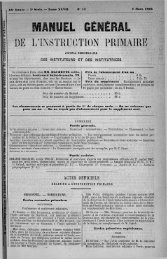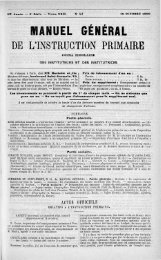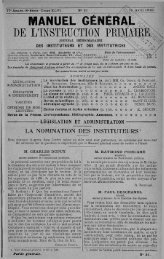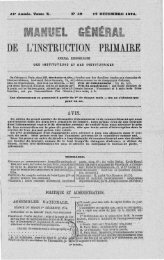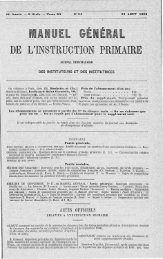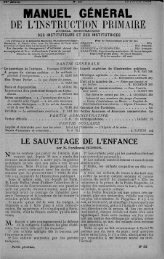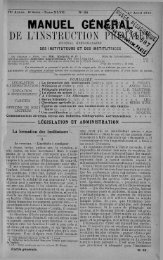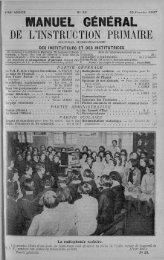MANUEL GÉNÉRAL DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE - INRP
MANUEL GÉNÉRAL DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE - INRP
MANUEL GÉNÉRAL DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE - INRP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES<br />
: COURS ÉLÉMENTAIRE '<br />
Expériences et observations à propos de<br />
quelques instruments de musique.<br />
Matériel de la leçon : violon, diapason, caisse ou<br />
boîte cordes en boyau ou ficelles de fouet, cornet à<br />
pistons, série de bouteilles.<br />
1. — On décrira par l'observati >n minutieuse un<br />
violon ordinaire : cordes, chevilles, caiste, archet. Insister<br />
sur la légèreté de l'ense uble — la caisse est<br />
creuse — si'r la tension des cordes métalliques ou en<br />
boyau, sur la disposiiion pratique de l'instrument. Le<br />
violoniste joue : observer l'archet appuyant sur les<br />
corles, les doig s de l'instrumentiste pressant les<br />
cordes sur le bois du violon.<br />
2. — Quelques expériences exolicatives : Entre<br />
deux clous tendre une corde de violon mise au rebut<br />
ou, à défaut, une ficelle de fouet; noter la situation<br />
identique des cordes de l'instrument. Pincer ou froHer<br />
avec l'archet, observer les mouveme ts de la corde<br />
repérer le son. — Tendre des cor tes de longueurs<br />
très inégales, les faire vibrer et donner l'ilée du son<br />
plus grave et du son plus aigu : q land le violoniste<br />
pince la corde, il en raccourcit la pariie vibrant-- et<br />
obtient ainsi les notes élevées.<br />
Donner le la avec le diapason ; seuls les élèves<br />
à, l'oreille desquels on appliqua l'instrument perçoivent<br />
le son ; faire vibrer à nouveau les tiges, placer<br />
le diapason sur une boîte vide, la classe entend distinctement<br />
le la.<br />
D'ailleurs, placer à l'oreille un bol, un coquillage,<br />
impression proluite... Donc, la caisse du violon renforce<br />
les sons produits par les cordes vibrant sous<br />
l'archet.<br />
3. — Le cornet à pistons est le plus banal des instruments<br />
à vent, en enivre. Pour en expliquer le<br />
mécanisme, on rappellera aux enfan's ce qui arrive<br />
lorsque, s ius un viaduc, un tunnel, ils Hncent un cri<br />
sonore. Ici, phénomène identique : de l'embouchure<br />
au pavillon, le cornet est un tuvau d'air que les<br />
lèvres de l'instrumentiste ''ont vibrer. Sur le cornet,<br />
jouer la gamme de do maieur : do, sol, à vide ; ré,<br />
baisser 1 er , 3 e pistons ; mi, la, 1 er , 2 e ; fa, 1 er ;<br />
si, 2 e .<br />
4. Expériences explicatives. Frapper sur une plaque<br />
de cuivre : el'e résonne, le métal vibre, c'est ce qui<br />
justifie la substance employée. Aligner huit bouieilles<br />
sur la table, les choisir, autant que possible, en verre<br />
mince; remplir d'eau la première sans la bou lier et<br />
la frap,er avec une tige métallique : noter le son<br />
obtenu, c'est la 1 note de la gamm-. Verser de l'eau<br />
dans la 2 e bouteille jusqu'à ce qu'elle donne la<br />
2 e note, etc... Constater que le son varie suivant le<br />
volume d'air qui vibre : les pistons du cornet ont.<br />
justement pour rôle de modifier le volume de l'air<br />
que comporte l'instrument.<br />
= COURS MOYEN ET SUPÉRIEUR ••=<br />
Le son.<br />
I. Références. — 1° Programme de la semaine :<br />
Le son Vibrations des corps; transmi sion du son<br />
Echo Caractères du son ; hauteur, intens'té, timbre.<br />
— 2° Consulter : LEROUX, cours supérieur, 64 e leçon.<br />
Pourètude complète de l'acoustique, voir CIIASSAGNY<br />
et CARUB. 2 e année, pp. 223 à 241. - 3° Se procurer<br />
: diapason, plaque le verre recouverte de noir<br />
de fumée, vrrre en cristal, cuvette, plusieurs sons,<br />
pincettes, biïte cylinirique de carton, entonnoir, tubes<br />
de caoutchouc.<br />
II. Expériences fit observations. — 1° Le son<br />
est un mouvement vibratoire : a) Armons l'une des<br />
bran lies tu diapa-on d'un crin Cnllé à la cire que<br />
nous appliquons 1 gèrement. sur une plaque de verre<br />
recouverte de noir de fumée Faisons vibrer le diapason,<br />
puis déplaçons-le rapidement dans une direction<br />
perpen liculaire à celle de ses vibrations : on<br />
obtiendra une courbe festonnée qui, mieux que le<br />
PARTIE SCOLAIRE 28S<br />
frémissenunt de l'objet tenu en main, révélera la<br />
cause du son. — b) Se procurer un verre à pied en<br />
ristal ; attacher un fil au pied du verre et à l'endroit<br />
où le fil atteint le bord du verre renversé, couper et<br />
coller avec de la cire à cacheter une bille d'agate ou<br />
un petit caillou ; faire tinter le verre, noter la série<br />
de choc de la bille et du cristal vibrant.<br />
2° Transmission du son : rappeler ce qui a été dit<br />
précé lemment au sujet des corps élastiques : l'élasticité<br />
de l'air est certaine. — a) Dans un seau d'eau ou une<br />
large cuvette, laisser tomber un petit caillou ; observer<br />
les ondes qui propagent lé mouvement. — 6) Expliquer<br />
l'analogie de ce phénomène avec la transmission<br />
du son dans l'air. c) Les «oli tes transmettent mieux<br />
le son que les gaz ainsi que le prouvent les expériences<br />
suivantes : suspendre 1-s pincettes à un fil et faire tenir<br />
le fil par des élèves différents, frapper les pincettes<br />
et noter l'intensité du son reçu; placer les doigts tenant<br />
l«s extrémités du fil à 1 oreille, frapper de nouveau<br />
et 'Onsiater l'amplification du son. — Couper en<br />
leux une boîte cylinirique en carton, remplacer le<br />
fond par du papier mince collé, fortement tendu;<br />
percer les deux feuilles par dp faibles trous où passe<br />
un fil, faire éloigner deux élèves de la longueur<br />
de la ficelle: l'un paile et l'autre entend.<br />
3° Applications pratiques. — Avec un entonnoir<br />
auquel ou adapte un tuyau de caoutchouc assez long,<br />
on réalise un 'ube acoustique ; le même ohjet<br />
isolé peut représenter un cornet acoustique. -Si l'entonnoir<br />
est assez volumineux, il servira de portevoix<br />
; s'il est de faibles dimensions, on n'y parlera<br />
pas ; mais on y .silflera.<br />
III. Documents. — C'est en 1822 qu'une série<br />
d'e> périences réalisées entre Villejuif et Montlhéry<br />
— pièces de canon installées à ces deux points et<br />
tirant alternativement — ont déterminé la vitesse du<br />
son dans l'air elle varie de 331 m. à 3i0 m à la<br />
seconde. Plus tard Stourm etCidladononlexp»rimentè<br />
sur le lac de Genève pour déterminer la vitesse de<br />
435 m. par seconde qui est celle du son dans l'eau:<br />
à borl du bateau, choc à double effet : inflammation<br />
de poudre dans l'atmosphère et marteau frappait un<br />
timhre, sous l'eau ; sur le rivage, cornet acous ique<br />
plongeant dans l'eau. Quant à la vitesse dans les solides,<br />
elle varie avec la nature du solide lui même.<br />
Sur des tuyaux de fonte, elle a été trouvée de 5 000 m.<br />
environ.<br />
IV. Exercices d'application. — 1° Questions d'intelligence<br />
: Expliquez les sons produits par la lanière<br />
du fouet, la baguetle flexible qui frappe l'air. —<br />
Même question pour le bourdonnement de certains<br />
insectes. — Pourquoi les pêcheurs sont-ils gens<br />
silencieux ? — On recommande aux troupes envoyées<br />
en reconnaissance de mettre de temps à autre l'oreille<br />
!i terre; pourquoi? Quel avamase y a-t-il, en ce cas,<br />
à mettre l'oreille au-dessus d'un tambour? — Comment<br />
expliquez vous que le tonnerre, les coups de canon<br />
fassent vibrer les vitrfs sans produire de. vent? —<br />
Les expériences relatives b. la vitesse du son dans<br />
l'air et dans l'eau relatées plus haut, ont-elles eu lieu<br />
le jour ou la nui' ? — Un orchestre éloigné jore :<br />
vous distinguez l'ordre et le rythme des sons. Qu'en<br />
concluez-vous? (Que tous les sons se propagent avec<br />
la même vinsse.)<br />
2° Problèmes : a) Un observatoire perçoit l'éclair<br />
10 secondes avant le tonnerre. A quelle distance<br />
est-il de l'orage? — R. : 3 400 m.<br />
b) Un observateur est à 1700 m. d'une batterie<br />
d'ar illerie qui tire; il voit, aussitôt après le coup,<br />
la fumée des canons: au bout de combien de temps<br />
entendra-t il le son? — R. : 5 sec.<br />
3° Devoir écrit: Qu'appelle-t-on .vibrations ? Expliquez<br />
c mment. elles parviennent à notre oreille. Dites<br />
quelques mots sur la transmission du son et sur les<br />
instruments de musique. (C. E. P., Orne.)<br />
A. AYMARD,<br />
Instituteur chargé de cours complémentaire.<br />
SCIENCES : P LEDOUX, Leçons sciences pbys. et nat., Cours saper, et compl. Brevel élém- L.bO