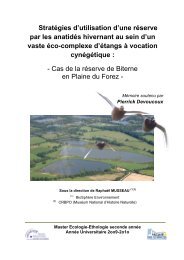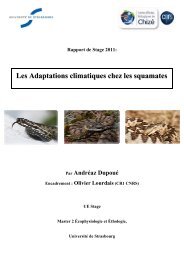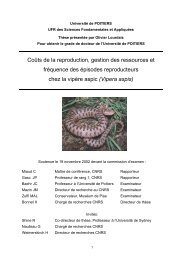Forçage environnemental et prédateurs marins ... - Cebc - CNRS
Forçage environnemental et prédateurs marins ... - Cebc - CNRS
Forçage environnemental et prédateurs marins ... - Cebc - CNRS
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Jusqu’à maintenant, la plupart des modèles développés dans le but de prédire les conséquences<br />
écologiques des changements globaux ont été basés sur la théorie de niche écologique. La répartition d’une<br />
espèce est modélisée en fonction de variables climatiques <strong>et</strong> écologiques <strong>et</strong> est ensuite proj<strong>et</strong>ée en utilisant<br />
les conditions climatiques futures estimées par les modèles climatiques (Beaumont <strong>et</strong> Hughes 2002,<br />
P<strong>et</strong>erson <strong>et</strong> al. 2002, Thomas <strong>et</strong> al. 2004, Thuiller <strong>et</strong> al. 2005). Dans certains cas les modèles de niche sont<br />
explicitement couplés à des modèles climatiques, mais la modélisation des processus écologiques est<br />
généralement trop simpliste (Cramer <strong>et</strong> al. 2001, B<strong>et</strong>ts 2005). De plus, ces modèles souffrent de plusieurs<br />
limitations (Guisan <strong>et</strong> Thuiller 2005). Les modèles phénoménologiques (modèles matriciels, comportement-<br />
individus centrés) intégrant explicitement les processus à travers lesquels les changements globaux<br />
affectent la dynamique des populations offrent une approche plus mécanistique (Sa<strong>et</strong>her <strong>et</strong> al. 2004, Hulme<br />
2005, Sutherland 2006, Botkin <strong>et</strong> al. 2007). Ces modèles n’ont été que très peu utilisés dans des buts<br />
prédictifs <strong>et</strong> essentiellement chez des espèces végétales (Kleidon <strong>et</strong> aMooney 2000, Chuine <strong>et</strong> Beaubien<br />
2001, Guisan <strong>et</strong> Thuiller 2005, Moorcroft 2006). Le développement des modèles phénoménologiques<br />
requiert la compréhension <strong>et</strong> la quantification de l’influence des facteurs climatiques <strong>et</strong> anthropiques sur les<br />
paramètres démographiques <strong>et</strong> comportementaux sous jacents à la dynamique des populations (Sutherland<br />
2006). C’est dans ce cadre que j’ai développé une majeure partie de mes recherches depuis mon entrée au<br />
<strong>CNRS</strong> en me focalisant principalement sur les <strong>prédateurs</strong> <strong>marins</strong> endothermes de l’Océan Austral.<br />
4<br />
Les Les <strong>prédateurs</strong> <strong>prédateurs</strong> comme comme intégrateurs intégrateurs de de variabilité<br />
variabilité<br />
L’utilisation des <strong>prédateurs</strong> <strong>marins</strong> comme indicateurs de changements environnementaux a reçu un intérêt<br />
croissant au cours des vingt dernières années (Furness <strong>et</strong> Ainley 1984, Cairns 1987, Croxall <strong>et</strong> al. 1988,<br />
Montevecchi 1993, Piatt <strong>et</strong> al. 2007, Einoder 2009). Les hypothèses sous-jacentes sont d’une part que les<br />
populations de <strong>prédateurs</strong> <strong>marins</strong> endothermes sont largement contrôlées par les ressources alimentaires<br />
(processus « bottom-up »), ce qui est appuyé par plusieurs études (Aebischer <strong>et</strong> al. 1990, Speckman <strong>et</strong> al.<br />
2005, Fredericksen <strong>et</strong> al. 2006), <strong>et</strong> que de par leur position dans les réseaux trophiques associée à leur<br />
vaste aire de prospection alimentaire, ces <strong>prédateurs</strong> intègrent les variations de l’environnement. Par<br />
conséquent, leurs traits physiologiques, comportementaux <strong>et</strong> démographiques constituent des indicateurs<br />
fiables du statut <strong>et</strong> du changement de l’écosystème (Figure 12). Cependant, des études théoriques (Cairns<br />
1987, Laakso <strong>et</strong> al. 2001) <strong>et</strong> empiriques (Burger <strong>et</strong> Piatt 1990, Piatt <strong>et</strong> al. 2007) montrent que c<strong>et</strong>te<br />
intégration peut se révéler complexe.<br />
29