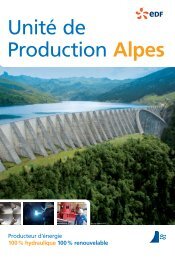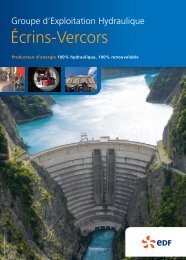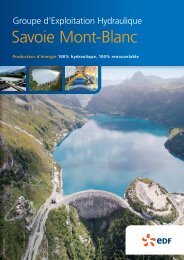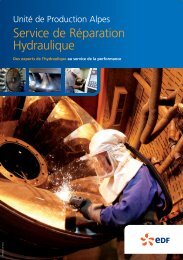Sûreté hydrAuLIque - Energie EDF
Sûreté hydrAuLIque - Energie EDF
Sûreté hydrAuLIque - Energie EDF
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
vies dès la conception. La surveillance des équipements,<br />
la fiabilisation et la rénovation des automatismes, la<br />
standardisation des méthodes d’exploitation et de<br />
maintenance (gMAo) sont des chantiers destinés à<br />
améliorer la sûreté hydraulique de la dPIh, de façon<br />
continue et pérenne.<br />
En 2011, le projet a sollicité les instances nationales de sûreté<br />
(CNSH, CTSH, gASH) pour valider des livrables importants :<br />
détection des précurseurs, méthodologie et analyse des<br />
actions à distance, Cahier d’expression des besoins des DMP<br />
(dispositifs et moyens particuliers), référentiel traçabilité. Une<br />
méthodologie a permis au management d’analyser la multiplicité<br />
des actions à distance et des risques associés et a<br />
abouti à en proscrire une centaine.<br />
Le référentiel de pilotage des arrêts intègre la prise en compte<br />
de la sûreté à chaque étape.<br />
La sûreté a fait l’objet de plusieurs actions de communication<br />
dans les unités : mercredi RenouvEau, insertion de RenouvEau<br />
dans le Mémento sûreté DPIH, accompagnement de la feuille<br />
de route sûreté DPIH et présentation de la feuille de route<br />
RenouvEau dans les pôles.<br />
Le projet intègre mieux la maîtrise des risques opérationnels.<br />
Les recommandations des inspections sûreté 2011 réalisées<br />
dans les UP pilotes sont prises en compte dans le plan d’actions<br />
du comité Maîtrise des risques opérationnels.<br />
Le chANtIer MAINteNIr<br />
une grande dynamique de déploiement à l’up est<br />
Les équipes chargées du déploiement (projet et terrain) font<br />
preuve d’un grand dynamisme. Le management est engagé<br />
dans la réussite du projet, tout en continuant à maîtriser les<br />
enjeux et les risques liés à l’exploitation pendant son déploiement,<br />
avec un niveau d’exigences élevé.<br />
À l’été 2011, j’ai constaté les apports concrets du modèle<br />
Maintenir, bien perceptibles au niveau des états-majors d’unités<br />
et de sous-unités, mais un peu moins au niveau du terrain.<br />
Il existe cependant une conviction partagée d’aller dans le bon<br />
sens avec des retombées très positives à moyen terme (plans<br />
de maintenance revisités et standards PMPS, partage des informations<br />
entre acteurs, capitalisation du REX, outils puissants).<br />
La formalisation et l’optimisation des pratiques et méthodes<br />
sont engagées. La conduite du changement est maîtrisée,<br />
avec un appui significatif apporté aux équipes (exploitants et<br />
RAPPORT DE L’INSPECTEUR<br />
DE LA SÛRETÉ HYDRAULIQUE<br />
LeS PoINtS cLéS<br />
DU MODèLE MAINTENIR<br />
Pour les équipements, la finalité est de gagner en fiabilité<br />
et en disponibilité par la refonte des processus techniques,<br />
la standardisation de plans de maintenance préventive, la<br />
surveillance à distance des équipements critiques, la mise à<br />
disposition d’outils SI pour la traçabilité et le portage d’informations.<br />
L’intégration des OMISH (54) est prévue dans le modèle.<br />
n un pilotage d’affaires et d’arrêt en construction.<br />
La prise en compte de la sûreté est prévue dans les phases<br />
amont des affaires. Le périmètre des missions de pilotage national<br />
et régional d’activités est en cours de définition. La DPIH a<br />
sélectionné plusieurs chantiers à piloter selon une organisation<br />
de type « arrêt de chute » ou « arrêt de file » (55) . Sur ces choix<br />
d’arrêts, la place de la sûreté est à rendre un peu plus explicite.<br />
n une identification nationale des équipements.<br />
Le modèle Maintenir intègre une approche de codification<br />
pour une identification nationale unique des équipements<br />
qui limite le risque d’erreur de repérage. Les sous-ensembles<br />
fonctionnels permettent de retrouver des équipements à<br />
enjeu sûreté, donc les OMISH.<br />
n un référentiel solide de maintenance préventive pMps (56) .<br />
Le PMPS, défini par famille de matériels, est fondé sur les<br />
doctrines, et les pratiques du terrain. Il est prescriptif et<br />
décliné en Plan de maintenance local (PML) pour intégrer des<br />
spécificités d’exploitation ou un état dégradé de matériel.<br />
Le PML, décliné dans l’outil de GMAO, déclenche les actions<br />
de maintenance d’un équipement et trace toutes les étapes<br />
de réalisation. Pour chaque demande de travail, l’analyse de<br />
risque et la requalification sont obligatoires.<br />
Des prescriptions propres aux OMISH sont intégrées dans les<br />
PMPS et les PML.<br />
mainteneurs) par une équipe projet bien dimensionnée. Tous<br />
les acteurs, y compris les pôles Performance production des<br />
gEH, participent. La communication est réactive et répond aux<br />
questions du terrain via une « main-courante ».<br />
Les pratiques sûreté du gMH Est (revue des exigences, profondeur<br />
des analyses de risque sur les OMISH, requalification, PV<br />
de recollement, CR d’intervention) sont progressivement intégrées<br />
dans le modèle (pratiques métiers). Les projets de site,<br />
progressivement améliorés, ont permis d’expliciter concrètement<br />
des exemples d’arbitrages sur la sécurité et sur la sûreté.<br />
(54) Ouvrages et matériels importants pour la sûreté hydraulique. (55) En s’inspirant de l’organisation des arrêts de tranche des unités de production thermique ou nucléaire.<br />
(56) Plan de maintenance préventive standard.<br />
— 53 —