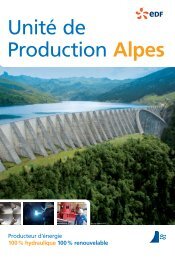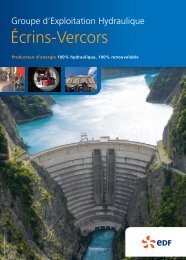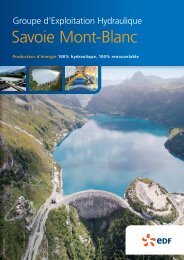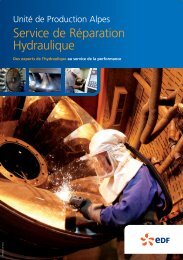Sûreté hydrAuLIque - Energie EDF
Sûreté hydrAuLIque - Energie EDF
Sûreté hydrAuLIque - Energie EDF
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Le CIH n’est pas encore embarqué dans le déploiement du<br />
modèle. Cet aspect structurel conduit à ne pas pouvoir le tester<br />
(affaires CIH souvent dimensionnantes dans les indisponibilités).<br />
Certains impacts sur les équipes sont à bien prendre en compte :<br />
• nécessité de bien intégrer le risque important à déployer le<br />
modèle dans un gU en même temps que la réalisation de<br />
grands chantiers, et de construire les parades adéquates,<br />
• les nouveaux plans de maintenance génèrent une activité plus<br />
importante que les anciens (5 à 10 % de volume en hommejours<br />
sur un gEH), avec des pointes cycliques d’activité à lisser.<br />
Le déploiement du modèle a un effet loupe qui peut mettre<br />
en évidence quelques manquements dans l’application rigoureuse<br />
des prescriptions DPIH pour la maintenance,<br />
• l’impact du modèle Maintenir est plus fort dans les gU que<br />
dans les EIM (60) (où des préparateurs existent déjà) et le sera<br />
aussi dans les équipes de mesure. Dans les gU, les planificateurs<br />
et les responsables de la maintenance portent la<br />
sûreté (et la sécurité) dans les équipes opérationnelles : une<br />
attention spécifique méritera d’être consacrée à la répartition<br />
de leurs activités et de leur présence sur le terrain,<br />
• le modèle structure la préparation de l’activité : c’est un<br />
changement culturel majeur à la DPIH au regard de la disparité<br />
et de la profondeur des pratiques existantes.<br />
les pistes d’amélioration du modèle Maintenir<br />
Je formule quatre axes de progrès pour améliorer le modèle<br />
Maintenir.<br />
Appuyer la place et la gestion de la sûreté dans l’organisation<br />
renouveau<br />
• Préciser les attendus du rôle de la filière sûreté dans le<br />
déploiement et à la cible.<br />
• Intégrer explicitement les conclusions de la réflexion sur<br />
les OMISH.<br />
• Rendre plus efficace la mesure (indicateurs) d’avancement<br />
du plan de maintenance-OMISH pour permettre à l’exploitant<br />
d’en maîtriser les dérives.<br />
Analyser la profondeur des écarts constatés pour appliquer<br />
la directive OMISH avec davantage de profondeur et sur<br />
un périmètre élargi.<br />
Analyser l’impact du modèle sur les ressources et les<br />
compétences<br />
• Engager une réflexion sur le dimensionnement des équipes<br />
(gU, EIM, EM, CIH) pour répondre aux exigences liées aux<br />
PMPS et aux nouveaux rôles métiers.<br />
(60) Équipe d’intervention et de maintenance.<br />
RAPPORT DE L’INSPECTEUR<br />
DE LA SÛRETÉ HYDRAULIQUE<br />
LeS PoINtS cLéS<br />
DU MODèLE PRODUIRE<br />
RenouvEau vise à rendre plus performante et plus sûre l’exploitation<br />
hydraulique, par la création d’une ingénierie de production<br />
(IPR) constituée d’un centre régional d’e-exploitation (CREEX)<br />
focalisé sur le quotidien, et d’une fonction d’appui à l’exploitant<br />
pour prendre du recul. Le CREEX a un rôle opérationnel :<br />
il surveille le process et les matériels pour mieux anticiper les<br />
dérives et anomalies, il traite les alarmes. En appui, l’IPR garantit<br />
le recul nécessaire, notamment pour analyser les paramètres de<br />
surveillance du process et des équipements, détecter les signaux<br />
précurseurs de défaillance, piloter les analyses d’écart, établir des<br />
bilans et des plans d’amélioration.<br />
n un process d’exploitation mieux surveillé : RenouvEau<br />
rend plus robuste le process d’exploitation en diversifiant les<br />
paramètres et seuils d’exploitation, en approfondissant le suivi<br />
de certains paramètres et en renforçant la détection des anomalies.<br />
Le traitement des informations d’exploitation reposera<br />
sur des niveaux redondants de surveillance et d’intervention<br />
(exploitant local et régional, experts). L’objectif est de disposer<br />
de seuils et de paramètres diversifiés permettant plusieurs<br />
niveaux d’actions : prévention, veille, protection.<br />
Autre intérêt majeur pour la sûreté : l’amélioration portera sur la<br />
profondeur de la surveillance, sur la capacité à mieux analyser les<br />
paramètres et à mieux anticiper les dérives d’exploitation.<br />
Le renforcement de la surveillance conduira à améliorer les performances<br />
et la sûreté : réduction d’incidents, meilleur suivi des<br />
OMISH, meilleure connaissance des points zéro des machines<br />
bénéfique aux requalifications, détection de nouveaux précurseurs<br />
sûreté, appui supplémentaire aux GU. Davantage de paramètres<br />
à enjeu sûreté seront surveillés.<br />
n le développement de plusieurs outils performants : L’équipe<br />
du modèle Produire améliore plusieurs outils dédiés à la surveillance<br />
des matériels. C’est le cas d’un outil permettant l’analyse<br />
de paramètres de machines pour visualiser les données<br />
en temps réel et pour faire émerger des alarmes en fonction<br />
des écarts constatés. Autre expérimentation : la surveillance<br />
de matériels pour mieux décliner/valider le référentiel de surveillance<br />
des matériels et régler les alarmes.<br />
n l’amélioration des actions à distance : Pour améliorer la<br />
per formance de production et de maintenance ainsi que la maîtrise<br />
des risques, une centaine d’actions à distance a été retenue.<br />
Chaque action à distance est cotée avant d’être autorisée.<br />
n Vers une préparation de la conduite : Plusieurs orientations<br />
sont retenues, en particulier systématiser l’activité de préparation<br />
coordonnée et centralisée pour fiabiliser les programmes<br />
et mieux maîtriser la sûreté, prévoir et téléprogrammer la<br />
production, séparer les rôles distincts du CCH et du CREEX.<br />
Des procédures ont été décrites pour préparer le dossier de<br />
conduite à long terme afin de mieux anticiper (gain sûreté) et<br />
le dossier à court terme (analyse des situations à risques).<br />
— 55 —