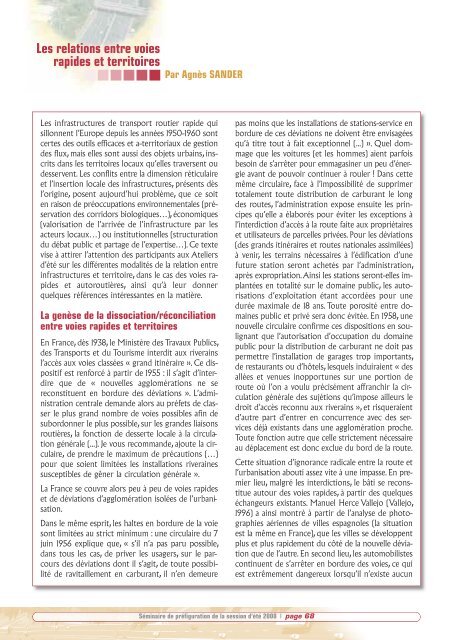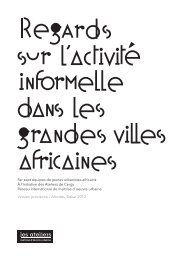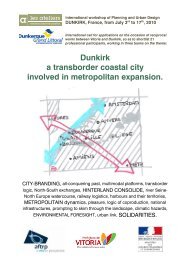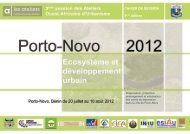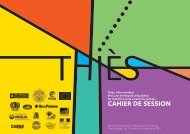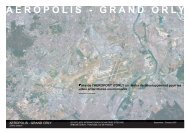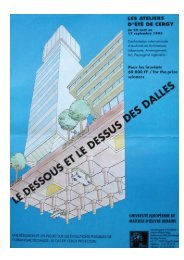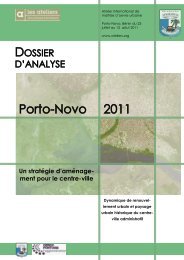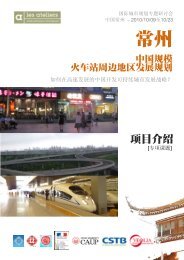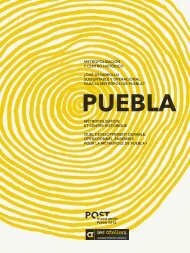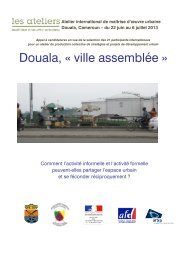actes colloque 2007 - Les Ateliers
actes colloque 2007 - Les Ateliers
actes colloque 2007 - Les Ateliers
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Les</strong> relations entre voies<br />
rapides et territoires<br />
Par Agnès SANDER<br />
<strong>Les</strong> infrastructures de transport routier rapide qui<br />
sillonnent l’Europe depuis les années 1950-1960 sont<br />
certes des outils efficaces et a-territoriaux de gestion<br />
des flux, mais elles sont aussi des objets urbains, inscrits<br />
dans les territoires locaux qu’elles traversent ou<br />
desservent. <strong>Les</strong> conflits entre la dimension réticulaire<br />
et l’insertion locale des infrastructures, présents dès<br />
l’origine, posent aujourd’hui problème, que ce soit<br />
en raison de préoccupations environnementales (préservation<br />
des corridors biologiques…), économiques<br />
(valorisation de l’arrivée de l’infrastructure par les<br />
acteurs locaux…) ou institutionnelles (structuration<br />
du débat public et partage de l’expertise…). Ce texte<br />
vise à attirer l’attention des participants aux <strong>Ateliers</strong><br />
d’été sur les différentes modalités de la relation entre<br />
infrastructures et territoire, dans le cas des voies rapides<br />
et autoroutières, ainsi qu’à leur donner<br />
quelques références intéressantes en la matière.<br />
La genèse de la dissociation/réconciliation<br />
entre voies rapides et territoires<br />
En France, dès 1938, le Ministère des Travaux Publics,<br />
des Transports et du Tourisme interdit aux riverains<br />
l’accès aux voies classées « grand itinéraire ». Ce dispositif<br />
est renforcé à partir de 1955 : il s’agit d’interdire<br />
que de « nouvelles agglomérations ne se<br />
reconstituent en bordure des déviations ». L’administration<br />
centrale demande alors au préfets de classer<br />
le plus grand nombre de voies possibles afin de<br />
subordonner le plus possible, sur les grandes liaisons<br />
routières, la fonction de desserte locale à la circulation<br />
générale (...). Je vous recommande, ajoute la circulaire,<br />
de prendre le maximum de précautions (…)<br />
pour que soient limitées les installations riveraines<br />
susceptibles de gêner la circulation générale ».<br />
La France se couvre alors peu à peu de voies rapides<br />
et de déviations d’agglomération isolées de l’urbanisation.<br />
Dans le même esprit, les haltes en bordure de la voie<br />
sont limitées au strict minimum : une circulaire du 7<br />
juin 1956 explique que, « s’il n’a pas paru possible,<br />
dans tous les cas, de priver les usagers, sur le parcours<br />
des déviations dont il s’agit, de toute possibilité<br />
de ravitaillement en carburant, il n’en demeure<br />
pas moins que les installations de stations-service en<br />
bordure de ces déviations ne doivent être envisagées<br />
qu’à titre tout à fait exceptionnel (...) ». Quel dommage<br />
que les voitures (et les hommes) aient parfois<br />
besoin de s’arrêter pour emmagasiner un peu d’énergie<br />
avant de pouvoir continuer à rouler ! Dans cette<br />
même circulaire, face à l’impossibilité de supprimer<br />
totalement toute distribution de carburant le long<br />
des routes, l’administration expose ensuite les principes<br />
qu’elle a élaborés pour éviter les exceptions à<br />
l’interdiction d’accès à la route faite aux propriétaires<br />
et utilisateurs de parcelles privées. Pour les déviations<br />
(des grands itinéraires et routes nationales assimilées)<br />
à venir, les terrains nécessaires à l’édification d’une<br />
future station seront achetés par l’administration,<br />
après expropriation. Ainsi les stations seront-elles implantées<br />
en totalité sur le domaine public, les autorisations<br />
d’exploitation étant accordées pour une<br />
durée maximale de 18 ans. Toute porosité entre domaines<br />
public et privé sera donc évitée. En 1958, une<br />
nouvelle circulaire confirme ces dispositions en soulignant<br />
que l’autorisation d’occupation du domaine<br />
public pour la distribution de carburant ne doit pas<br />
permettre l’installation de garages trop importants,<br />
de restaurants ou d’hôtels, lesquels induiraient « des<br />
allées et venues inopportunes sur une portion de<br />
route où l’on a voulu précisément affranchir la circulation<br />
générale des sujétions qu’impose ailleurs le<br />
droit d’accès reconnu aux riverains », et risqueraient<br />
d’autre part d’entrer en concurrence avec des services<br />
déjà existants dans une agglomération proche.<br />
Toute fonction autre que celle strictement nécessaire<br />
au déplacement est donc exclue du bord de la route.<br />
Cette situation d’ignorance radicale entre la route et<br />
l’urbanisation abouti assez vite à une impasse. En premier<br />
lieu, malgré les interdictions, le bâti se reconstitue<br />
autour des voies rapides, à partir des quelques<br />
échangeurs existants. Manuel Herce Vallejo (Vallejo,<br />
1996) a ainsi montré à partir de l’analyse de photographies<br />
aériennes de villes espagnoles (la situation<br />
est la même en France), que les villes se développent<br />
plus et plus rapidement du côté de la nouvelle déviation<br />
que de l’autre. En second lieu, les automobilistes<br />
continuent de s’arrêter en bordure des voies, ce qui<br />
est extrêmement dangereux lorsqu’il n’existe aucun<br />
Séminaire de préfiguration de la session d’été 2008 | page 68