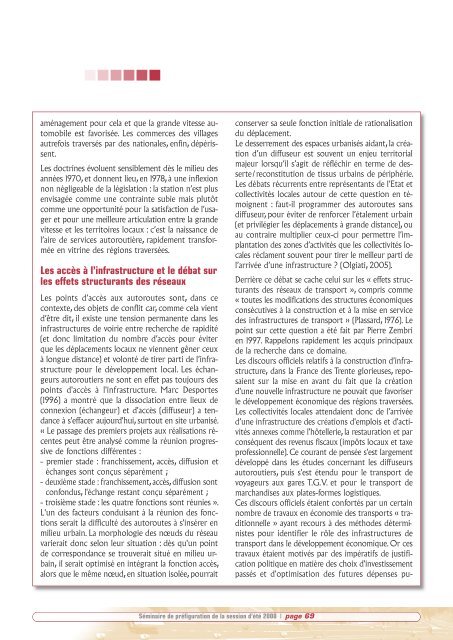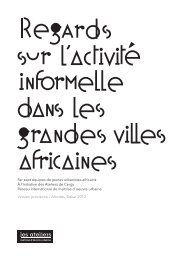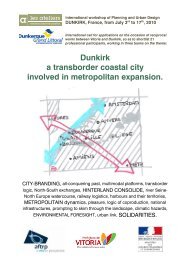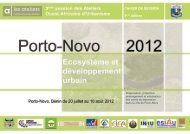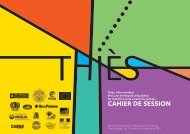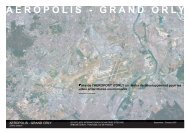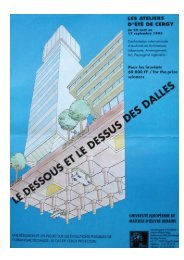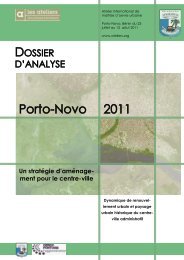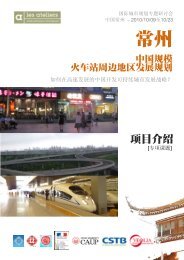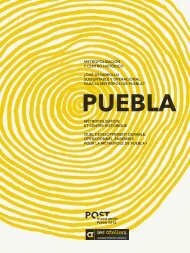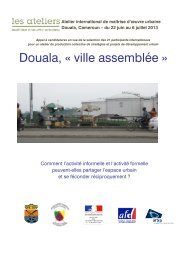actes colloque 2007 - Les Ateliers
actes colloque 2007 - Les Ateliers
actes colloque 2007 - Les Ateliers
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
aménagement pour cela et que la grande vitesse automobile<br />
est favorisée. <strong>Les</strong> commerces des villages<br />
autrefois traversés par des nationales, enfin, dépérissent.<br />
<strong>Les</strong> doctrines évoluent sensiblement dès le milieu des<br />
années 1970, et donnent lieu, en 1978, à une inflexion<br />
non négligeable de la législation : la station n’est plus<br />
envisagée comme une contrainte subie mais plutôt<br />
comme une opportunité pour la satisfaction de l’usager<br />
et pour une meilleure articulation entre la grande<br />
vitesse et les territoires locaux : c’est la naissance de<br />
l’aire de services autoroutière, rapidement transformée<br />
en vitrine des régions traversées.<br />
<strong>Les</strong> accès à l’infrastructure et le débat sur<br />
les effets structurants des réseaux<br />
<strong>Les</strong> points d’accès aux autoroutes sont, dans ce<br />
contexte, des objets de conflit car, comme cela vient<br />
d’être dit, il existe une tension permanente dans les<br />
infrastructures de voirie entre recherche de rapidité<br />
(et donc limitation du nombre d’accès pour éviter<br />
que les déplacements locaux ne viennent gêner ceux<br />
à longue distance) et volonté de tirer parti de l’infrastructure<br />
pour le développement local. <strong>Les</strong> échangeurs<br />
autoroutiers ne sont en effet pas toujours des<br />
points d'accès à l'infrastructure. Marc Desportes<br />
(1996) a montré que la dissociation entre lieux de<br />
connexion (échangeur) et d'accès (diffuseur) a tendance<br />
à s'effacer aujourd'hui, surtout en site urbanisé.<br />
« Le passage des premiers projets aux réalisations récentes<br />
peut être analysé comme la réunion progressive<br />
de fonctions différentes :<br />
- premier stade : franchissement, accès, diffusion et<br />
échanges sont conçus séparément ;<br />
- deuxième stade : franchissement, accès, diffusion sont<br />
confondus, l'échange restant conçu séparément ;<br />
- troisième stade : les quatre fonctions sont réunies ».<br />
L'un des facteurs conduisant à la réunion des fonctions<br />
serait la difficulté des autoroutes à s'insérer en<br />
milieu urbain. La morphologie des nœuds du réseau<br />
varierait donc selon leur situation : dès qu'un point<br />
de correspondance se trouverait situé en milieu urbain,<br />
il serait optimisé en intégrant la fonction accès,<br />
alors que le même nœud, en situation isolée, pourrait<br />
conserver sa seule fonction initiale de rationalisation<br />
du déplacement.<br />
Le desserrement des espaces urbanisés aidant, la création<br />
d’un diffuseur est souvent un enjeu territorial<br />
majeur lorsqu’il s’agit de réfléchir en terme de desserte/reconstitution<br />
de tissus urbains de périphérie.<br />
<strong>Les</strong> débats récurrents entre représentants de l’Etat et<br />
collectivités locales autour de cette question en témoignent<br />
: faut-il programmer des autoroutes sans<br />
diffuseur, pour éviter de renforcer l’étalement urbain<br />
(et privilégier les déplacements à grande distance), ou<br />
au contraire multiplier ceux-ci pour permettre l’implantation<br />
des zones d’activités que les collectivités locales<br />
réclament souvent pour tirer le meilleur parti de<br />
l’arrivée d’une infrastructure (Olgiati, 2005).<br />
Derrière ce débat se cache celui sur les « effets structurants<br />
des réseaux de transport », compris comme<br />
« toutes les modifications des structures économiques<br />
consécutives à la construction et à la mise en service<br />
des infrastructures de transport » (Plassard, 1976). Le<br />
point sur cette question a été fait par Pierre Zembri<br />
en 1997. Rappelons rapidement les acquis principaux<br />
de la recherche dans ce domaine.<br />
<strong>Les</strong> discours officiels relatifs à la construction d’infrastructure,<br />
dans la France des Trente glorieuses, reposaient<br />
sur la mise en avant du fait que la création<br />
d'une nouvelle infrastructure ne pouvait que favoriser<br />
le développement économique des régions traversées.<br />
<strong>Les</strong> collectivités locales attendaient donc de l’arrivée<br />
d’une infrastructure des créations d'emplois et d'activités<br />
annexes comme l'hôtellerie, la restauration et par<br />
conséquent des revenus fiscaux (impôts locaux et taxe<br />
professionnelle). Ce courant de pensée s'est largement<br />
développé dans les études concernant les diffuseurs<br />
autoroutiers, puis s'est étendu pour le transport de<br />
voyageurs aux gares T.G.V. et pour le transport de<br />
marchandises aux plates-formes logistiques.<br />
Ces discours officiels étaient confortés par un certain<br />
nombre de travaux en économie des transports « traditionnelle<br />
» ayant recours à des méthodes déterministes<br />
pour identifier le rôle des infrastructures de<br />
transport dans le développement économique. Or ces<br />
travaux étaient motivés par des impératifs de justification<br />
politique en matière des choix d'investissement<br />
passés et d'optimisation des futures dépenses pu-<br />
Séminaire de préfiguration de la session d’été 2008 | page 69