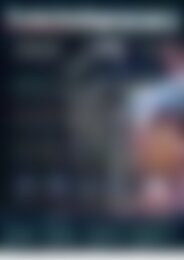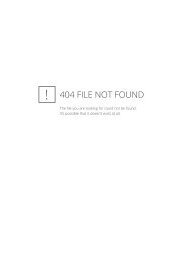Essais & Simulations n°133
Spécial Eurosatory : Quels moyens d’essais pour la défense ?
Spécial Eurosatory :
Quels moyens d’essais pour la défense ?
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
dossier<br />
En application<br />
Simulation des chocs<br />
pyrotechniques en laboratoire :<br />
comparatif entre deux moyens<br />
différents<br />
Créé en 2005 et implanté à Saint-Etienne, Adetests a rejoint le groupe Emitech en 2010. Ses moyens permettent<br />
de réaliser des tests mécaniques (vibrations, chocs), climatiques (chaud, froid, humidité, VRT) ou encore<br />
des chutes d’emballages, ceci dans tous les domaines, et tout particulièrement dans la défense et le militaire,<br />
comme l’illustrent ces travaux menés sur la simulation des chocs pyrotechniques.<br />
Les chocs sont des phénomènes physiques de courtes<br />
durées par rapport à la constante de temps d’un<br />
système. Il est nécessaire de connaitre l’impact qu’ils<br />
peuvent avoir sur un équipement. On peut distinguer<br />
plusieurs catégories de chocs : les chocs « classiques » (chocs<br />
terrains, chocs de manutention…) et les chocs dits « pyrotechniques<br />
» (tirs d’armes, départ missile, séparation de coiffe<br />
d’un lanceur spatial…).<br />
Les chocs « pyrotechniques » sont de forme d’onde complexe,<br />
la reproductibilité en laboratoire ne permet pas d’utiliser le<br />
signal temporel comme spécification seule. Une représentation<br />
dans le domaine fréquentiel est utilisée afin de pouvoir<br />
comparer les mesures réelles avec les essais réalisés, ainsi<br />
que deux essais entre eux. Il s’agit du spectre de réponses<br />
aux chocs (SRC), modèle mathématique initialement développé<br />
pour caractériser les séismes (1932). Le laboratoire<br />
Adetests propose de répondre au besoin de simulation de<br />
ces derniers par des moyens d’impact métal-métal : types<br />
pendule ou chute libre guidée.<br />
l’EST est fixé sur la partie recevant l’impulsion et sa vitesse<br />
est donc nulle au moment de celle-ci. En réalité, les équipements<br />
sont la plupart du temps soumis à un choc « pyrotechnique<br />
» avec une vitesse initiale nulle, la simulation par le<br />
biais d’un pendule se rapproche donc plus de la réalité. Les<br />
essais par chute libre guidée sont à utiliser avec précaution<br />
pour les équipements suspendus car les suspensions n’auront<br />
pas les mêmes précontraintes que dans le cas réel et la<br />
filtration du choc ne sera donc pas la même.<br />
Afin de comparer et vérifier la répétabilité des essais, une<br />
étude sur 50 chocs par type de banc dans une configuration<br />
donnée a été réalisée. Les écarts en dB entre la valeur<br />
moyenne et les enveloppes minimum et maximum des<br />
50 SRC sont ensuite calculés.<br />
Une comparaison des moyens d’essais pour<br />
choisir le plus à-même de répondre au besoin<br />
Pour un choc équivalent sur les deux types de banc, la<br />
première différence notable vient de la technique de simulation<br />
utilisée : avec un banc chute libre guidée, l’équipement<br />
sous test (EST) étant fixé sur le plateau qui chute : la<br />
vitesse de l’EST est non nulle au moment de l’impact générant<br />
l’onde de choc. Dans le cas de l’utilisation du pendule,<br />
Comparaison de la répétabilité sur 50 chocs pour les deux types<br />
de banc<br />
ESSAIS & SIMULATIONS • N°133 • mai-juin 2018 I59