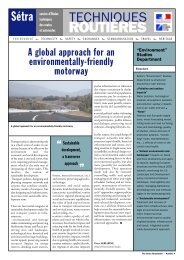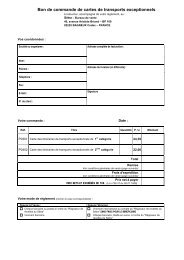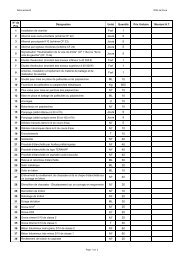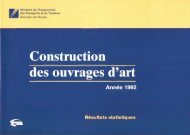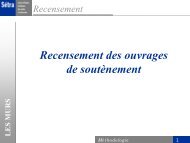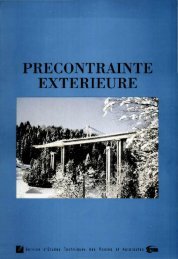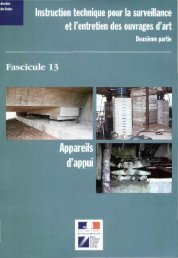<strong>Transports</strong> <strong>intellig<strong>en</strong>ts</strong><strong>Mise</strong> <strong>en</strong> œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>directive</strong> <strong>2010</strong>/40 pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2012 - 2017 – Rapport d'étu<strong>de</strong>sgestionnaires et maîtres d’ouvrages <strong>en</strong> termes d’évaluation et d’ingénierie <strong>de</strong> projets STI. Cette démarche vis<strong>en</strong>otamm<strong>en</strong>t à produire un socle <strong>de</strong> doctrine d’évaluation <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> trafic, qui abor<strong>de</strong> notamm<strong>en</strong>tles points les plus s<strong>en</strong>sibles du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’évaluation cités ci-<strong>de</strong>ssus. Divers travaux ont dores et déjà été<strong>en</strong>gagés pour alim<strong>en</strong>ter ainsi « par briques » l’é<strong>la</strong>boration d’une telle doctrine d’évaluation :• un état <strong>de</strong> l’art <strong>de</strong>s mesures, fondés sur les retours d’expéri<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s systèmes déjà <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce : c’est l’approcheinitialem<strong>en</strong>t ret<strong>en</strong>ue dans le domaine routier dans le projet EasyWay <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission Europé<strong>en</strong>ne ; cetteapproche sera prolongée par <strong>de</strong>s docum<strong>en</strong>ts prés<strong>en</strong>tant <strong>de</strong> façon synthétique les domaines <strong>de</strong> pertin<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>sdiffér<strong>en</strong>ts types <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong> gestion dynamique <strong>de</strong>s trafics et d’information <strong>de</strong>s usagers ; ces travauxport<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t sur les équipem<strong>en</strong>ts : fonctionnalités, coûts, <strong>en</strong>jeux <strong>de</strong> maint<strong>en</strong>ance ; li<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> d<strong>en</strong>sitéd’équipem<strong>en</strong>ts et les niveaux <strong>de</strong> services att<strong>en</strong>dus ;• <strong>de</strong>s travaux portant sur l’évaluation <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> trafic et d’information <strong>de</strong>s usagers, qui sedécompos<strong>en</strong>t selon les principaux <strong>en</strong>jeux <strong>de</strong> connaissance m<strong>en</strong>tionnés ci-<strong>de</strong>ssus.L’objectif est que le résultat <strong>de</strong> ces travaux soit mis à disposition <strong>de</strong>s gestionnaires dès mi-2012, puis donn<strong>en</strong>tlieu à l’établissem<strong>en</strong>t d’un docum<strong>en</strong>t <strong>de</strong> doctrine (gui<strong>de</strong>) pour le Réseau routier national à l’horizon <strong>de</strong> fin 2013.Cette doctrine pourra <strong>en</strong>suite être adaptée <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong>s besoins exprimés par les autres gestionnaires etmaîtres d’ouvrage pour certains types <strong>de</strong> mesures, par exemple <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> gestion multimodale <strong>de</strong>s réseaux.Cette doctrine pourra égalem<strong>en</strong>t être déclinée sous forme d’outils pédagogiques et <strong>de</strong> modules <strong>de</strong> formation.9 - E<strong>la</strong>boration d'architectures9.1 - Définition <strong>de</strong> l'architectureAu fur et à mesure que les nouvelles technologies pénètr<strong>en</strong>t le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s transports, <strong>la</strong> complexité <strong>de</strong>sdispositifs techniques et <strong>de</strong>s organisations <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t pour les acteurs (à tout niveau et qu'ils soi<strong>en</strong>t à l'intérieur ou àl'extérieur <strong>de</strong>s métiers du transport) un obstacle qui leur cache <strong>la</strong> vue du fonctionnem<strong>en</strong>t d'<strong>en</strong>semble, <strong>de</strong> leur rôleexact et <strong>de</strong>s moy<strong>en</strong>s dont ils dispos<strong>en</strong>t.Les architectures sont <strong>de</strong>s outils pour maîtriser cette complexité. Le terme architecture se r<strong>en</strong>contrefréquemm<strong>en</strong>t <strong>en</strong> informatique, <strong>en</strong> ingénierie, ou <strong>en</strong>core <strong>en</strong> productique. Il est utilisé à <strong>la</strong> fois pour construire etpour décrire un système, une application, ou une organisation généralem<strong>en</strong>t complexe. Dans sa premièreacception, l'architecture est synonyme d'armature ou <strong>de</strong> squelette. Elle sert à construire l'objet 11 . La constructiond'une architecture est, à ce titre, ess<strong>en</strong>tielle, car <strong>de</strong> là découle bi<strong>en</strong> souv<strong>en</strong>t, <strong>la</strong> réussite du projet 12 . L'utilisationdu terme "architecture" pour décrire <strong>de</strong>s interactions procè<strong>de</strong> d'une volonté <strong>de</strong> mettre <strong>en</strong> avant le caractèrepér<strong>en</strong>ne <strong>de</strong> celles ci. L'architecture r<strong>en</strong>voie à l'idée d'une construction réfléchie, d'une structure soli<strong>de</strong> où chaqueélém<strong>en</strong>t est défini par ses fonctions au sein d'un système stable.Plusieurs "niveaux" d'architectures exist<strong>en</strong>t. Ils répond<strong>en</strong>t à <strong>de</strong>s objectifs différ<strong>en</strong>ts.• l'architecture technique 13 peut être considérée comme <strong>la</strong> plus "basique". Elle ne se préoccupe <strong>de</strong>s acteurs qu'àtravers le prisme <strong>de</strong>s équipem<strong>en</strong>ts ou <strong>de</strong>s technologies ;• l'architecture cadre 14 s'intéresse plutôt aux li<strong>en</strong>s <strong>en</strong>tre les acteurs et les équipem<strong>en</strong>ts : on y détermine lesprocédures <strong>de</strong> validation et <strong>de</strong> qualification <strong>de</strong> l'information ;11C'est-à-dire définir un projet, lui associer <strong>de</strong>s objectifs (créer un service, lui donner un niveau <strong>de</strong> qualité…), et sélectionner les acteurs,les normes ou <strong>en</strong>core les technologies et les équipem<strong>en</strong>ts qui contribueront à atteindre ces objectifs L'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s acteurs, normes, ettechnologies sont organisés ; leurs interactions sont définies <strong>de</strong> façon a remplir les objectifs dans <strong>de</strong>s conditions jugées optimales.12 L'architecture est créée <strong>en</strong> trois temps :- <strong>la</strong> réflexion préa<strong>la</strong>ble qui consiste à formuler le projet le plus c<strong>la</strong>irem<strong>en</strong>t possible,- <strong>la</strong> sélection <strong>de</strong>s élém<strong>en</strong>ts constitutifs du projet (acteurs, normes, technologies, équipem<strong>en</strong>ts…),- l'optimisation <strong>de</strong>s interactions <strong>en</strong>tre ces élém<strong>en</strong>ts constitutifs.13 On peut considérer que l'architecture technique et l'architecture applicative sont synonymes.14On peut considérer que l'architecture cadre et l'architecture métier sont synonymes.Collection « Les rapports » – Sétra – 24 – août 2012
<strong>Transports</strong> <strong>intellig<strong>en</strong>ts</strong><strong>Mise</strong> <strong>en</strong> œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>directive</strong> <strong>2010</strong>/40 pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2012 - 2017 – Rapport d'étu<strong>de</strong>s• <strong>la</strong> troisième : l'architecture décisionnelle détermine <strong>la</strong> stratégie, <strong>la</strong> "politique" voulue pour le service :l'architecture procè<strong>de</strong>, ici, davantage du choix que <strong>de</strong> <strong>la</strong> maximisation <strong>de</strong> l'efficacité. L'architecturedécisionnelle hiérarchise les acteurs.Pour résumer, l'architecture décisionnelle répond à <strong>la</strong> question "que veut-on faire ?", l'architecture cadre"comm<strong>en</strong>t faire ?" et l'architecture technique "que faut-il faire ?".L'architecture fonctionnelle peut être considérée comme étant <strong>la</strong> plus générique, <strong>la</strong> plus <strong>en</strong>globante. Elle décrit lefonctionnem<strong>en</strong>t général <strong>de</strong> l'objet (service, mesure, échange d'information…). A ce titre, elle offre une vision à<strong>la</strong> fois <strong>de</strong> <strong>la</strong> stratégie, <strong>de</strong> l'organisation et <strong>de</strong>s techniques et répond à <strong>la</strong> question "que fait-on ?".9.2 - Besoins d’architecture et démarche proposéeLa concertation et l’analyse <strong>de</strong>s expéri<strong>en</strong>ces étrangères ont fait émerger un souhait, partagé par l'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>sacteurs, <strong>de</strong> développer <strong>de</strong>s structures permettant aux STI <strong>de</strong> se développer dans <strong>de</strong>s conditions optimales. Cesstructures peuv<strong>en</strong>t pr<strong>en</strong>dre <strong>la</strong> forme d'architectures plus où moins détaillées selon <strong>la</strong> nature du besoin <strong>de</strong>structure.Les architectures se matérialis<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t par <strong>de</strong>s schémas ou <strong>de</strong>s « cartes » id<strong>en</strong>tifiant <strong>de</strong>s fonctions et <strong>de</strong>sre<strong>la</strong>tions <strong>en</strong>tre ces fonctions. En géographie, <strong>la</strong> bonne échelle pour une carte est celle qui permet <strong>de</strong> représ<strong>en</strong>tersimultaném<strong>en</strong>t un nombre raisonnable d'objets et les re<strong>la</strong>tions <strong>en</strong>tre eux avec une précision homogène. Pour lessystèmes STI, chaque type d'acteurs a besoin d'un type d'architecture adapté à son point <strong>de</strong> vue :• créer un vocabu<strong>la</strong>ire commun <strong>en</strong>tre les acteurs et c<strong>la</strong>rifier leurs <strong>en</strong>jeux pour faciliter <strong>la</strong> gouvernance,• id<strong>en</strong>tifier le fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s systèmes existants et évaluer les évolutions nécessaires pour répondre à <strong>de</strong>sbesoins nouveaux, notamm<strong>en</strong>t d'interopérabilité,• organiser les échanges <strong>en</strong>tre les systèmes sur <strong>de</strong>s bases pér<strong>en</strong>nes, <strong>en</strong> particulier <strong>de</strong>s définitions <strong>de</strong>s donnéesqui soi<strong>en</strong>t partagées <strong>en</strong>tre tous les acteurs,• réaliser <strong>de</strong>s interfaces réutilisables d'un projet à un autre,• analyser les risques <strong>de</strong>s systèmes et pr<strong>en</strong>dre les mesures <strong>de</strong> sécurité adaptées.Ces différ<strong>en</strong>ts points <strong>de</strong> vue sont complém<strong>en</strong>taires : le premier concerne les déci<strong>de</strong>urs qui ont à pr<strong>en</strong>drel'<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s décisions qui amèneront à ce que les systèmes d'information qui sont sous leur responsabilité<strong>de</strong>vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t interopérables : ces décisions ont <strong>de</strong>s aspects « politiques », <strong>en</strong> particulier sur l'image <strong>de</strong> leursorganisations (publiques ou privées) pour les usagers et pour le public, mais aussi juridiques, techniques etfinancières.Collection « Les rapports » – Sétra – 25 – août 2012