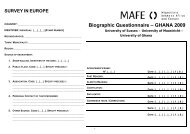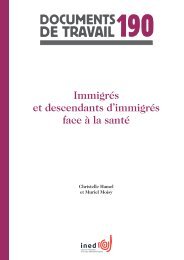Trajectoires et Origines - Ined
Trajectoires et Origines - Ined
Trajectoires et Origines - Ined
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ou un diplôme du supérieur, toutes choses égales par ailleurs. Pour les hommes, c<strong>et</strong>te<br />
probabilité s’établit à 1,6. Par ailleurs, être bénéficiaire de la CMU ou de l’AME<br />
accroît la probabilité des femmes de se déclarer en plus mauvaise santé (OR=1,6),<br />
un constat qui n’est pas observé pour les hommes.<br />
3 W Les hommes <strong>et</strong> les femmes originaires de Turquie<br />
sont les immigrés qui se déclarent le plus fréquemment<br />
en mauvaise santé à âge <strong>et</strong> caractéristiques sociales identiques<br />
Contrairement aux modèles 1 <strong>et</strong> 2, les modèles 3 <strong>et</strong> 4 présentés dans le tableau 3<br />
distinguent les immigrés <strong>et</strong> les natifs d’un DOM selon leurs pays ou départements<br />
de naissance pour les hommes d’une part, <strong>et</strong> pour les femmes d’autre part. Dans le<br />
modèle 3, seuls les critères de l’âge <strong>et</strong> de l’origine sont pris en compte. Comparés<br />
aux hommes quadragénaires, originaires d’Espagne ou d’Italie, les hommes immigrés<br />
originaires de Turquie ont un risque près de trois fois plus élevé (OR=2,8) de<br />
se percevoir en mauvaise santé à âge identique. Chez les femmes de Turquie, c<strong>et</strong>te<br />
probabilité est multipliée par 2,5. Parmi les autres populations qui se distinguent par<br />
une plus mauvaise santé perçue figurent les hommes immigrés d’Asie du Sud-Est<br />
(OR=2,1) <strong>et</strong> du Portugal (OR=2,0) <strong>et</strong> les femmes originaires du Maghreb (OR=2,2<br />
pour les femmes immigrées du Maroc ou de la Tunisie <strong>et</strong> OR=1,9 pour les femmes<br />
immigrées d’Algérie). À noter la situation particulière des hommes natifs des départements<br />
d’outre mer qui se déclarent deux fois plus souvent en mauvaise santé, à âge<br />
équivalent, que les immigrés d’Espagne ou d’Italie qui constituent la population de<br />
référence, un résultat qui n’apparaît pas pour les femmes.<br />
Une fois prise en compte leur situation sociale <strong>et</strong> économique en France mais<br />
aussi les caractéristiques de leur parcours migratoire (modèle 4), des différences de<br />
perception de la santé selon l’origine persistent pour les hommes immigrés de Turquie,<br />
d’Asie du Sud-Est, du Portugal <strong>et</strong> les natifs d’un DOM. Chez les femmes, les<br />
différences ne persistent que pour les originaires du Portugal <strong>et</strong> d’Asie du Sud-Est.<br />
Par ailleurs, les résultats de l’analyse multivariée m<strong>et</strong>tent en évidence l’eff<strong>et</strong> de l’âge<br />
à l’arrivée en métropole <strong>et</strong> de l’ancienn<strong>et</strong>é de la migration, deux déterminants généralement<br />
absents des enquêtes santé disponibles en France. La probabilité de se<br />
déclarer en mauvaise santé est significativement plus faible pour les femmes immigrées<br />
ou les natives d’un DOM arrivées en métropole lorsqu’elles étaient enfants<br />
(OR=0,6) ou adolescentes (OR=0,8), un constat que l’on observe également chez<br />
les hommes mais dans une moindre mesure.<br />
Toutefois, ce constat est nuancé par la durée de séjour en France métropolitaine.<br />
Toutes choses égales par ailleurs, ceux arrivés dans les cinq dernières années ont une<br />
probabilité n<strong>et</strong>tement plus faible de se déclarer en mauvaise santé : – 60 % pour les<br />
hommes <strong>et</strong> – 30 % pour les femmes. Ce résultat rend compte du caractère sélectif de<br />
la migration : ce sont les immigrés en meilleure santé dans leur pays d’origine qui<br />
se lancent dans un parcours migratoire. À l’inverse, le fait d’être en France métropolitaine<br />
depuis plus de trente ans accroît la perception d’un état de santé altéré de<br />
près de 60 % pour les hommes <strong>et</strong> 40 % pour les femmes toutes choses égales par<br />
ailleurs, ce qui conforte l’hypothèse d’une dégradation de l’état de santé liée notamment<br />
à des conditions de vie plus difficiles en France métropolitaine que pour la<br />
population majoritaire (4) .<br />
(4) Fassin, D., 1998, « Peut-on étudier la santé des étrangers <strong>et</strong> des immigrés ? », Plein droit, 38 • Jusot, Fl. <strong>et</strong> al., 2008, « La santé<br />
perçue des immigrés en France », Document de travail, n° 14, IRDES, p. 1-22, www.irdes.fr. • Dourgnon <strong>et</strong> al., 2008, « La santé perçue<br />
des immigrés en France. Une exploitation de l’enquête décennale santé 2002-2003 », Questions d’économie de la santé, n°133, p.1-6.<br />
Chapitre 10<br />
W W W<br />
81