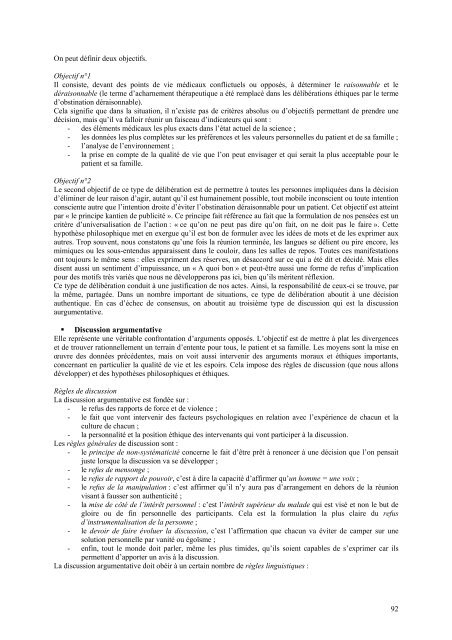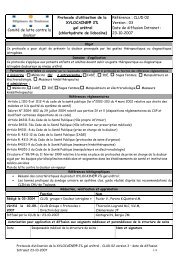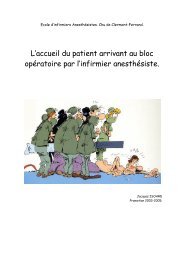Les soins palliatifs en service de réanimation médicale - Infirmiers.com
Les soins palliatifs en service de réanimation médicale - Infirmiers.com
Les soins palliatifs en service de réanimation médicale - Infirmiers.com
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
On peut définir <strong>de</strong>ux objectifs.<br />
Objectif n°1<br />
Il consiste, <strong>de</strong>vant <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> vie médicaux conflictuels ou opposés, à déterminer le raisonnable et le<br />
déraisonnable (le terme d’acharnem<strong>en</strong>t thérapeutique a été remplacé dans les délibérations éthiques par le terme<br />
d’obstination déraisonnable).<br />
Cela signifie que dans la situation, il n’existe pas <strong>de</strong> critères absolus ou d’objectifs permettant <strong>de</strong> pr<strong>en</strong>dre une<br />
décision, mais qu’il va falloir réunir un faisceau d’indicateurs qui sont :<br />
- <strong>de</strong>s élém<strong>en</strong>ts médicaux les plus exacts dans l’état actuel <strong>de</strong> la sci<strong>en</strong>ce ;<br />
- les données les plus <strong>com</strong>plètes sur les préfér<strong>en</strong>ces et les valeurs personnelles du pati<strong>en</strong>t et <strong>de</strong> sa famille ;<br />
- l’analyse <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t ;<br />
- la prise <strong>en</strong> <strong>com</strong>pte <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> vie que l’on peut <strong>en</strong>visager et qui serait la plus acceptable pour le<br />
pati<strong>en</strong>t et sa famille.<br />
Objectif n°2<br />
Le second objectif <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> délibération est <strong>de</strong> permettre à toutes les personnes impliquées dans la décision<br />
d’éliminer <strong>de</strong> leur raison d’agir, autant qu’il est humainem<strong>en</strong>t possible, tout mobile inconsci<strong>en</strong>t ou toute int<strong>en</strong>tion<br />
consci<strong>en</strong>te autre que l’int<strong>en</strong>tion droite d’éviter l’obstination déraisonnable pour un pati<strong>en</strong>t. Cet objectif est atteint<br />
par « le principe kanti<strong>en</strong> <strong>de</strong> publicité ». Ce principe fait référ<strong>en</strong>ce au fait que la formulation <strong>de</strong> nos p<strong>en</strong>sées est un<br />
critère d’universalisation <strong>de</strong> l’action : « ce qu’on ne peut pas dire qu’on fait, on ne doit pas le faire ». Cette<br />
hypothèse philosophique met <strong>en</strong> exergue qu’il est bon <strong>de</strong> formuler avec les idées <strong>de</strong> mots et <strong>de</strong> les exprimer aux<br />
autres. Trop souv<strong>en</strong>t, nous constatons qu’une fois la réunion terminée, les langues se déli<strong>en</strong>t ou pire <strong>en</strong>core, les<br />
mimiques ou les sous-<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dus apparaiss<strong>en</strong>t dans le couloir, dans les salles <strong>de</strong> repos. Toutes ces manifestations<br />
ont toujours le même s<strong>en</strong>s : elles exprim<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s réserves, un désaccord sur ce qui a été dit et décidé. Mais elles<br />
dis<strong>en</strong>t aussi un s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t d’impuissance, un « A quoi bon » et peut-être aussi une forme <strong>de</strong> refus d’implication<br />
pour <strong>de</strong>s motifs très variés que nous ne développerons pas ici, bi<strong>en</strong> qu’ils mérit<strong>en</strong>t réflexion.<br />
Ce type <strong>de</strong> délibération conduit à une justification <strong>de</strong> nos actes. Ainsi, la responsabilité <strong>de</strong> ceux-ci se trouve, par<br />
la même, partagée. Dans un nombre important <strong>de</strong> situations, ce type <strong>de</strong> délibération aboutit à une décision<br />
auth<strong>en</strong>tique. En cas d’échec <strong>de</strong> cons<strong>en</strong>sus, on aboutit au troisième type <strong>de</strong> discussion qui est la discussion<br />
aurgum<strong>en</strong>tative.<br />
• Discussion argum<strong>en</strong>tative<br />
Elle représ<strong>en</strong>te une véritable confrontation d’argum<strong>en</strong>ts opposés. L’objectif est <strong>de</strong> mettre à plat les diverg<strong>en</strong>ces<br />
et <strong>de</strong> trouver rationnellem<strong>en</strong>t un terrain d’<strong>en</strong>t<strong>en</strong>te pour tous, le pati<strong>en</strong>t et sa famille. <strong>Les</strong> moy<strong>en</strong>s sont la mise <strong>en</strong><br />
œuvre <strong>de</strong>s données précéd<strong>en</strong>tes, mais on voit aussi interv<strong>en</strong>ir <strong>de</strong>s argum<strong>en</strong>ts moraux et éthiques importants,<br />
concernant <strong>en</strong> particulier la qualité <strong>de</strong> vie et les espoirs. Cela impose <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> discussion (que nous allons<br />
développer) et <strong>de</strong>s hypothèses philosophiques et éthiques.<br />
Règles <strong>de</strong> discussion<br />
La discussion argum<strong>en</strong>tative est fondée sur :<br />
- le refus <strong>de</strong>s rapports <strong>de</strong> force et <strong>de</strong> viol<strong>en</strong>ce ;<br />
- le fait que vont interv<strong>en</strong>ir <strong>de</strong>s facteurs psychologiques <strong>en</strong> relation avec l’expéri<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> chacun et la<br />
culture <strong>de</strong> chacun ;<br />
- la personnalité et la position éthique <strong>de</strong>s interv<strong>en</strong>ants qui vont participer à la discussion.<br />
<strong>Les</strong> règles générales <strong>de</strong> discussion sont :<br />
- le principe <strong>de</strong> non-systématicité concerne le fait d’être prêt à r<strong>en</strong>oncer à une décision que l’on p<strong>en</strong>sait<br />
juste lorsque la discussion va se développer ;<br />
- le refus <strong>de</strong> m<strong>en</strong>songe ;<br />
- le refus <strong>de</strong> rapport <strong>de</strong> pouvoir, c’est à dire la capacité d’affirmer qu’un homme = une voix ;<br />
- le refus <strong>de</strong> la manipulation : c’est affirmer qu’il n’y aura pas d’arrangem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> la réunion<br />
visant à fausser son auth<strong>en</strong>ticité ;<br />
- la mise <strong>de</strong> côté <strong>de</strong> l’intérêt personnel : c’est l’intérêt supérieur du mala<strong>de</strong> qui est visé et non le but <strong>de</strong><br />
gloire ou <strong>de</strong> fin personnelle <strong>de</strong>s participants. Cela est la formulation la plus claire du refus<br />
d’instrum<strong>en</strong>talisation <strong>de</strong> la personne ;<br />
- le <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> faire évoluer la discussion, c’est l’affirmation que chacun va éviter <strong>de</strong> camper sur une<br />
solution personnelle par vanité ou égoïsme ;<br />
- <strong>en</strong>fin, tout le mon<strong>de</strong> doit parler, même les plus timi<strong>de</strong>s, qu’ils soi<strong>en</strong>t capables <strong>de</strong> s’exprimer car ils<br />
permett<strong>en</strong>t d’apporter un avis à la discussion.<br />
La discussion argum<strong>en</strong>tative doit obéir à un certain nombre <strong>de</strong> règles linguistiques :<br />
92