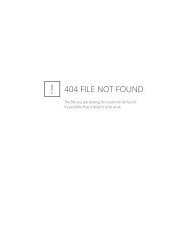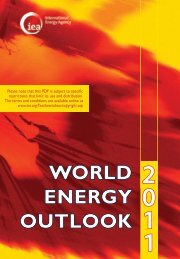702 Annexes Le revenu fiscal total indiqué sur le tableau G-2 pour l’année 1943 a donc été obtenu en appliquant aux estimations de Mitzakis les mêmes coefficients que ceux que nous avons appliqués aux estimations de Dugé de Bernonville, puis nous avons supposé pour les années 1939-1942 que le ratio (revenu moyen)/(salaire ouvrier moyen) avait évolué linéairement entre 1938 et 1943 (cf. colonne (10) du tableau G-2). Pour les années 1944-1948, une telle hypothèse n’est pas envisageable. Certes, le ratio (revenu moyen)/(salaire ouvrier moyen) obtenu pour 1943 (1,20) est relativement proche du ratio obtenu pour 1949 (1,26), et on pourrait donc supposer que l’évolution linéaire retenue pour les années 1938-1943 s’est poursuivie au cours des années 1943-1949. Mais la comparaison des taux de croissance du PIB, des taux de croissance des salaires et des taux de croissance obtenus à partir des statistiques fiscales issues de l’impôt cédulaire sur les BIC suggère que le ratio (revenu moyen)/(salaire ouvrier moyen) a suivi une évolution non monotone au cours de la période 1943-1949, avec une forte baisse en 1944, une légère remontée en 1945, une hausse significative en 1946, une légère baisse en 1947, puis une nouvelle hausse en 1948-1949. A partir de ces informations, nous avons donc calculé le revenu fiscal total pour les années 1944-1948 en supposant un ratio (revenu moyen)/(salaire ouvrier moyen) de 1,02 en 1944, 1,05 en 1945, 1,15 en 1946, 1,10 en 1947 et 1,15 en 1948 (cf. colonne (10) du tableau G-2). Ces estimations sont évidemment relativement imprécises, mais elles sont cohérentes avec toutes les informations dont nous disposons. En particulier, elles sont nettement plus satisfaisantes que les estimations du revenu fiscal total que l’on pourrait obtenir en utilisant les estimations de Froment et Gavanier (1947, p. 921 ; 1948, p. 738), selon lesquelles le revenu des ménages serait passé de 371 milliards de francs courants en 1938 à 2 300 milliards en 1946 et 3 148 milliards en 1947 (il s’agit à notre connaissance des seules estimations du revenu des ménages au sens de la comptabilité nationale qui aient été tentées pour les années 1939-1948) : en appliquant ces taux de progression 1946/1938 et 1947/1938 au revenu fiscal total que nous avons retenu pour 1938, on obtiendrait un revenu moyen de 1946 à peine plus élevé que le salaire ouvrier moyen, ce qui semble trop faible, compte tenu de la très forte reprise économique de 1946 (la comparaison des taux de croissance des salaires, du PIB et des BIC suggère que le ratio (revenu moyen)/(salaire ouvrier moyen) est au minimum de l’ordre de 1,10- 1,15 en 1946, et la valeur de 1,15 que nous avons retenue est plutôt une valeur « moyenne »), et ce qui conduirait à une remontée de la part des hauts revenus en 1946 beaucoup trop forte pour ne pas être suspecte, alors que nos estimations conduisent à des fluctuations « raisonnables » de la part des hauts revenus (il est possible cependant que nous ayons légèrement surestimé la chute du ratio (revenu moyen)/(salaire ouvrier moyen) en 1944 : avec un ratio légèrement plus élevé, la baisse de la part des hauts revenus observée en 1944 serait encore plus forte que celle que nous avons diagnostiquée). Pour les années 1914-1919, les estimations du revenu des ménages sont encore plus rares que pour la période 1939-1948 (ce qui s’explique notamment par le fait que les statistiques issues des impôts cédulaires, et en particulier de l’impôt cédulaire sur les BIC, ne débutent qu’en 1919). La seule estimation dont nous ayons connaissance est due à Lecaillon (1948), qui raccorde les estimations des « revenus privés » effectuées par Dugé de Bernonville pour les années 1913 et 1920 en utilisant des indices de la production industrielle et agricole 1 . Une telle méthode, relativement imprécise en temps de paix, est totalement inacceptable en temps de guerre, compte tenu du fait que les revenus des ménages baissent généralement sensiblement moins vite et moins fortement que la production en temps de guerre (du fait notamment de l’endettement public et des transferts internationaux), et en tout état cause que les chronologies peuvent varier de façon importante (ce qui explique également pourquoi il est impossible d’utiliser la série de PIB estimée par Villa par la production pour estimer l’évolution du revenu des ménages durant les années de guerre). De fait, l’utilisation des estimations de Lecaillon pour les années 1914-1919 conduirait à des incohérences importantes, et nous ne les avons donc pas utilisées 2 . Compte tenu du fait que les estimations retenues pour 1913 et 1920 conduisent à des ratios (revenu moyen)/(salaire ouvrier moyen) très proches pour ces deux années (1,27 en 1913, 1,25 en 1920), l’hypothèse la plus naturelle consiste à supposer que ce ratio a évolué linéairement entre 1913 et 1920 (cf. colonne (10) du tableau G-2). Le fait que le ratio (revenu moyen)/(salaire ouvrier moyen) n’ait pas connu au cours de la Première Guerre mondiale le même type d’effondrement qu’en 1944-1945 semble cohérent avec le fait que le premier conflit mondial n’a pas conduit au même type de grande revalorisation salariale (dans un contexte d’effondrement de la production) gressé légèrement plus vite que les salaires jusqu’en 1943, alors que les « gros » BIC (et en particulier les bénéfices des sociétés) ont commencé à baisser (non seulement en termes relatifs, mais également en francs courants) dès le début du conflit. 1. Lecaillon obtient ainsi des estimations de 36,3-29,0-28,7-35,8-41,6-57,9-70,8-82,9 pour le total des « revenus privés » (en milliards de francs courants) pour les années 1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920. 2. Par exemple, la série Lecaillon conduirait à conclure à une baisse du pouvoir d’achat des ménages entre 1918 et 1919, ce qui semble fortement incohérent avec la forte croissance du PIB et surtout avec la croissance sensible du pouvoir d’achat des salaires (qui montre que les ménages ont profité de la reprise). Inversement, la série Lecaillon conduirait à conclure à une progression spectaculaire du pouvoir d’achat des ménages entre 1919 et 1920, ce qui conduirait à une baisse vertigineuse de la part des hauts revenus, beaucoup trop forte pour ne pas être suspecte (par exemple, la part de P90-100 passerait de 49,57 % en 1919 à 39,60 % en 1920...).
Annexe G 703 que lors de la Libération. En fait, si l’on supposait que les hausses de prix et l’indexation insuffisante des salaires ont conduit à une progression de la part du capital dans la valeur ajoutée lors de la Première Guerre mondiale, alors on pourrait même être conduit à conclure à une hausse du ratio (revenu moyen)/(salaire ouvrier moyen) au cours des années 1914-1918, qui n’aurait retrouvé son niveau de l’ordre de 1,25-1,27 qu’en 1919-1920. Cependant, les rares estimations dont nous disposons suggère plutôt une relative stabilité du partage capital/travail au cours de la Première Guerre mondiale 1 . Dans ces conditions, l’hypothèse la plus raisonnable consiste à supposer que le ratio (revenu moyen)/(salaire ouvrier moyen) a évolué linéairement entre 1913 et 1920, et c’est ainsi que nous avons procédé. 2. ESTIMATION DE SÉRIES HOMOGÈNES PERMETTANT DE DÉCOMPOSER DE LA VALEUR AJOUTÉE ENTRE TRA- VAIL ET CAPITAL DE 1900 À 1998 Les tableaux G-3 et G-4 indiquent comment nous avons procédé pour obtenir des séries annuelles homogènes permettant de décomposer la valeur ajoutée des entreprises entre travail et capital de 1900 à 1998. Là encore, toutes les sources utilisés et tous les calculs effectués sont indiqués précisément sur les tableaux, et nous nous contentons de préciser ici les points essentiels. Tableau G-3: Décomposition de la valeur ajoutée entre travail et capital, 1900-1949 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) PIBE MSE PSE CSE EBE IDVE RBEI RBM TAXE TAXIM SUBE DOME %EI %Tr. %K %Tr. %K 1900 34,9 13,2 0,1 0,0 1,6 1,6 12,9 3,2 2,3 0,5 0,5 0,0 44,0 80,8 19,2 76,7 23,3 1901 32,9 13,1 0,1 0,0 1,0 1,5 12,1 3,0 2,3 0,4 0,5 0,0 43,5 84,1 15,9 80,0 20,0 1902 32,1 12,8 0,1 0,0 1,3 1,4 11,5 2,8 2,3 0,4 0,6 0,0 42,4 82,5 17,5 78,4 21,6 1903 33,7 13,2 0,1 0,0 1,4 1,5 12,4 3,0 2,3 0,4 0,6 0,0 43,4 82,3 17,7 78,2 21,8 1904 34,3 13,1 0,1 0,0 1,4 1,5 12,9 3,2 2,3 0,4 0,6 0,0 44,7 82,2 17,8 78,1 21,9 1905 34,5 12,9 0,1 0,0 1,9 1,5 12,8 3,1 2,3 0,4 0,6 0,0 43,9 79,2 20,8 75,1 24,9 1906 34,1 13,3 0,1 0,0 1,3 1,7 12,4 3,0 2,4 0,4 0,6 0,0 43,1 81,9 18,1 77,8 22,2 1907 38,0 13,6 0,1 0,0 2,4 1,9 14,0 3,5 2,5 0,4 0,5 0,0 43,8 76,1 23,9 72,0 28,0 1908 37,8 14,2 0,1 0,0 1,8 1,9 13,9 3,4 2,5 0,4 0,5 0,0 43,7 79,7 20,3 75,6 24,4 1909 39,3 14,5 0,1 0,0 2,3 2,0 14,3 3,5 2,7 0,4 0,6 0,0 43,2 77,5 22,5 73,4 26,6 1910 39,2 14,9 0,1 0,0 1,7 2,3 14,0 3,4 2,9 0,5 0,6 0,0 42,3 78,9 21,1 74,8 25,2 1911 43,6 15,2 0,1 0,0 2,8 2,5 16,0 3,9 3,1 0,5 0,6 0,0 43,7 74,5 25,5 70,4 29,6 1912 47,3 15,3 0,1 0,0 4,5 2,7 17,6 4,3 3,1 0,5 0,7 0,0 43,8 68,2 31,8 64,1 35,9 1913 46,7 15,3 0,1 0,0 4,2 2,8 17,1 4,2 3,3 0,5 0,8 0,0 43,3 68,8 31,2 64,7 35,3 1914 0,0 2,8 2,6 0,4 0,9 0,0 1915 0,0 2,5 2,7 0,4 0,9 0,0 1916 0,0 5,6 3,4 0,4 0,8 0,0 1917 0,0 7,7 4,3 0,5 1,1 0,0 1918 0,0 7,7 4,0 0,6 1,2 0,0 1919 38,1 0,2 0,1 11,9 4,7 7,8 0,8 2,0 0,9 69,9 30,1 65,8 34,2 1920 162,6 59,1 0,4 0,4 20,0 5,3 61,5 5,5 13,3 1,6 2,8 1,8 41,9 70,3 29,7 66,2 33,8 1921 162,6 60,5 0,3 0,2 18,4 5,1 59,7 6,6 13,9 1,7 3,3 0,6 41,4 72,1 27,9 68,0 32,0 1922 174,4 59,7 0,2 0,3 20,8 4,9 65,8 9,2 15,5 1,7 1,7 2,0 43,4 70,1 29,9 66,0 34,0 1923 195,7 64,8 0,3 0,3 22,8 5,7 76,6 9,6 17,2 1,6 1,7 1,5 44,9 69,7 30,3 65,6 34,4 1924 226,3 76,2 0,3 0,3 26,1 7,8 86,5 11,0 20,1 1,9 2,3 1,5 43,8 69,4 30,6 65,3 34,7 1925 250,6 81,9 0,4 0,3 27,4 9,7 97,6 12,3 22,5 2,0 2,4 1,1 44,9 69,0 31,0 64,9 35,1 1926 312,5 95,8 0,5 0,4 34,1 11,3 123,6 14,1 33,3 3,5 3,4 0,7 46,5 68,1 31,9 64,0 36,0 1927 322,4 98,0 0,7 0,5 34,8 11,6 123,1 15,7 37,4 4,9 3,2 1,0 45,8 68,1 31,9 64,0 36,0 1928 346,4 106,0 0,8 0,7 35,8 12,8 132,8 17,3 40,1 5,0 3,5 1,2 46,0 68,9 31,1 64,8 35,2 1929 371,0 119,0 0,9 0,9 37,5 14,8 134,8 18,9 45,0 4,9 4,3 1,4 43,8 69,8 30,2 65,7 34,3 1930 361,7 127,4 2,2 1,9 38,2 14,0 116,4 20,9 42,6 5,2 5,6 1,4 38,8 71,6 28,4 67,5 32,5 1931 338,6 122,0 3,6 3,1 37,5 10,9 98,7 22,0 42,2 4,7 5,5 0,6 35,8 72,7 27,3 68,6 31,4 1932 300,1 110,6 3,3 2,9 29,0 7,0 86,3 22,0 38,4 6,0 5,3 0,0 36,1 76,4 23,6 72,3 27,7 1933 292,0 105,6 3,1 2,7 31,3 7,7 83,5 21,2 37,7 4,9 5,4 0,3 35,7 74,1 25,9 70,0 30,0 1934 264,7 96,6 3,2 2,9 26,1 8,6 72,6 20,4 34,9 5,1 5,7 0,0 34,6 74,7 25,3 70,6 29,4 1935 256,5 90,0 3,4 3,0 25,7 8,3 73,6 19,6 34,5 4,9 6,4 0,1 36,1 73,9 26,1 69,8 30,2 1936 286,0 100,5 3,1 2,7 25,8 9,8 93,7 18,9 33,4 4,9 6,8 0,1 39,8 74,9 25,1 70,8 29,2 1937 348,6 123,3 4,2 3,7 36,1 10,9 116,6 19,6 37,2 5,3 8,4 0,1 39,6 73,6 26,4 69,5 30,5 1938 396,9 137,0 5,3 4,7 41,0 14,0 128,0 22,0 46,0 7,0 8,0 0,1 38,8 72,8 27,2 68,7 31,3 1939 140,0 5,3 4,8 43,1 14,1 147,8 41,6 72,4 27,6 68,3 31,7 1940 127,6 4,6 3,5 37,7 14,1 122,1 39,4 72,4 27,6 68,3 31,7 1941 148,3 5,2 4,8 41,3 14,0 137,0 39,1 74,1 25,9 70,0 30,0 1942 181,0 6,1 7,6 47,1 14,0 160,8 38,6 76,1 23,9 72,0 28,0 1943 216,4 7,0 8,7 49,5 12,2 179,2 37,9 79,0 21,0 74,9 25,1 1944 367,9 11,5 10,4 28,5 12,4 195,6 31,2 90,5 9,5 86,4 13,6 1945 619,8 18,6 31,0 74,2 10,9 377,8 33,4 88,7 11,3 84,6 15,4 1946 835,7 24,1 110,2 265,3 20,4 842,2 40,1 77,2 22,8 73,1 26,9 1947 1278 35,2 201,6 386,0 38,1 1266 39,5 78,1 21,9 74,0 26,0 1948 2061 54,3 344,1 751,1 52,2 2302 41,4 75,4 24,6 71,3 28,7 1949a 2249 56,4 464,1 979,1 87,2 2866 42,8 72,2 27,8 68,1 31,9 1. Cf. Hautcœur et Grottard (1999), qui proposent une estimation de l’évolution du partage capital/travail de la valeur ajoutée des entreprises fondée sur l’exploitation des statistiques issues de l’impôt sur les bénéfices de guerre.
- Page 1 and 2:
LES HAUTS REVENUS EN FRANCE AU XX e
- Page 3 and 4:
THOMAS PIKETTY LES HAUTS REVENUS EN
- Page 5:
SOMMAIRE Remerciements . . . . . .
- Page 9 and 10:
ANNEXE A Les tableaux statistiques
- Page 11 and 12:
Annexe A 557 1935 1936 1937 1938 Ta
- Page 13 and 14:
Annexe A 559 1971 1972 1973 1974 Ta
- Page 15 and 16:
Annexe A 561 de la tranche de reven
- Page 17 and 18:
Annexe A 563 effectivement été im
- Page 19 and 20:
Annexe A 565 toutes les autres majo
- Page 21 and 22:
Annexe A 567 Tableau A-2 (suite et
- Page 23 and 24:
Annexe A 569 tableaux « répartiti
- Page 25 and 26:
Annexe A 571 Ces publications du mi
- Page 27 and 28:
Annexe A 573 tulés « Les impôts
- Page 29 and 30:
Annexe A 575 Tableau A-6: Le rythme
- Page 31 and 32:
Annexe A 577 Tableau A-7 : Le monta
- Page 33 and 34:
Annexe A 579 1936 était de 1,342 m
- Page 35 and 36:
Annexe A 581 Tableau A-9: Le cas de
- Page 37 and 38:
Annexe A 583 millions de francs de
- Page 39 and 40:
Annexe A 585 (v) Nous avons regroup
- Page 41 and 42:
Annexe A 587 France », « revenus
- Page 43 and 44:
Annexe A 589 Commençons par les ta
- Page 45 and 46:
Annexe A 591 La suppression en 1959
- Page 47 and 48:
Annexe B 593 (P90-95 est le revenu
- Page 49 and 50:
Annexe B 595 Tableau B-1: Les coeff
- Page 51 and 52:
Annexe B 597 1965 1966 1967 1968 19
- Page 53 and 54:
Annexe B 599 plus bas peuvent être
- Page 55 and 56:
Annexe B 601 comparées aux fluctua
- Page 57 and 58:
Annexe B 603 Tableau B-2 (suite et
- Page 59 and 60:
Annexe B 605 Tableau B-4 (suite et
- Page 61 and 62:
Annexe B 607 foyers dont le revenu
- Page 63 and 64:
Annexe B 609 Tableau B-5: Les taux
- Page 65 and 66:
Annexe B 611 Tableau B-6: Les taux
- Page 67 and 68:
Annexe B 613 Tableau B-8 (suite et
- Page 69 and 70:
Annexe B 615 Tableau B-10: Résulta
- Page 71 and 72:
Annexe B 617 Tableau B-11 (suite et
- Page 73 and 74:
Annexe B 619 Tableau B-13 (suite et
- Page 75 and 76:
Annexe B 621 Tableau B-14 (suite et
- Page 77 and 78:
Annexe B 623 période). Il est donc
- Page 79 and 80:
Annexe B 625 Tableau B-16: Les rés
- Page 81 and 82:
Annexe B 627 Tableau B-16 (suite) 1
- Page 83 and 84:
Annexe B 629 Les tableaux B-17 et B
- Page 85 and 86:
Annexe B 631 P99-99,5 P99,5-99,9 P9
- Page 87 and 88:
Annexe B 633 P99,9-100 P99,99-100 P
- Page 89 and 90:
Annexe B 635 des différents fracti
- Page 91 and 92:
Annexe B 637 Tableau B-20 (suite et
- Page 93 and 94:
Annexe B 639 (pour le revenu imposa
- Page 95 and 96:
Annexe B 641 Tableau B-22 (suite et
- Page 97 and 98:
Annexe B 643 estimations des taux m
- Page 99 and 100:
Annexe B 645 marges d’erreur maxi
- Page 101 and 102:
ANNEXE C Données complémentaires
- Page 103 and 104:
Annexe C 649 Tableau C-3 : Les plaf
- Page 105 and 106: Annexe C 651 Tableau C-6: Les barè
- Page 107 and 108: 2. CHRONOLOGIE DES PRINCIPAUX TEXTE
- Page 109 and 110: Annexe C 655 Loi du 12/7/1965 : cr
- Page 111 and 112: ANNEXE D Données brutes, méthodol
- Page 113 and 114: Annexe D 659 Tableau D-2 : Les réf
- Page 115 and 116: Annexe D 661 Signalons enfin que le
- Page 117 and 118: Annexe D 663 Tableau D-6: Résultat
- Page 119 and 120: Annexe D 665 corrections effectuée
- Page 121 and 122: Annexe D 667 nombre de salariés ob
- Page 123 and 124: Annexe D 669 Tableau D-10: Les tabl
- Page 125 and 126: Annexe D 671 Lecture : Pour les ann
- Page 127 and 128: Annexe D 673 Tableau D-14 : Résult
- Page 129 and 130: Annexe D 675 Tableau D-16 : Résult
- Page 131 and 132: ANNEXE E Estimation de séries homo
- Page 133 and 134: Annexe E 679 Tableau E-1: Le salair
- Page 135 and 136: Annexe E 681 1946 semble plus fiabl
- Page 137 and 138: Annexe E 683 La colonne (3) du tabl
- Page 139 and 140: Annexe E 685 Tableau E-3 (suite et
- Page 141 and 142: Annexe E 687 les ouvriers agricoles
- Page 143 and 144: ANNEXE F Les indices de prix à la
- Page 145 and 146: Annexe F 691 Tableau F-1 (suite et
- Page 147 and 148: ANNEXE G Méthodologie et résultat
- Page 149 and 150: Annexe G 695 Tableau G-1 : PIB, RPB
- Page 151 and 152: Annexe G 697 Tableau G-2 : Revenu f
- Page 153 and 154: Annexe G 699 années de guerre 1 .
- Page 155: Annexe G 701 été menée en 1956,
- Page 159 and 160: Annexe G 705 Tableau G-4 (suite et
- Page 161 and 162: Annexe G 707 fectuer les décomposi
- Page 163 and 164: Annexe G 709 rentes. En particulier
- Page 165 and 166: Annexe G 711 Tableau G-6: Décompos
- Page 167 and 168: Annexe G 713 Tableau G-9: Décompos
- Page 169 and 170: Annexe G 715 Tableau G-13: L’éva
- Page 171 and 172: Annexe G 717 Tableau G-17 : Décomp
- Page 173 and 174: Annexe G 719 (2) et (3) = revenu na
- Page 175 and 176: ANNEXE H Population, ménages et st
- Page 177 and 178: Annexe H 723 Tableau H-1 (suite et
- Page 179 and 180: Annexe H 725 cours de la première
- Page 181 and 182: Annexe H 727 Tableau H-3: La répar
- Page 183 and 184: Annexe H 729 Tableau H-5: Le nombre
- Page 185 and 186: Annexe I 731 fiscaux » peuvent con
- Page 187 and 188: Annexe I 733 nière fois que le CER
- Page 189 and 190: Annexe I 735 nées 1960 selon les
- Page 191 and 192: Annexe I 737 connu une très nette
- Page 193 and 194: Annexe I 739 locatives aux revenus
- Page 195 and 196: Annexe I 741 peine plus de 10 % des
- Page 197 and 198: Annexe I 743 l’IGR. Mais les rép
- Page 199 and 200: Annexe J 745 au cours d’une anné
- Page 201 and 202: Annexe J 747 1932 1933 1935 1936 Ta
- Page 203 and 204: Annexe J 749 Tableau J-2 : Les réf
- Page 205 and 206: Annexe J 751 Tableau J-3: Les table
- Page 207 and 208:
Annexe J 753 « répartition » : l
- Page 209 and 210:
Annexe J 755 Précisons également
- Page 211 and 212:
Annexe J 757 1937 1938 1939 1940 Ta
- Page 213 and 214:
Annexe J 759 Tableau J-5: Résultat
- Page 215 and 216:
Annexe J 761 Tableau J-7: Résultat
- Page 217 and 218:
Annexe J 763 Tableau J-9: Résultat
- Page 219 and 220:
Annexe J 765 Tableau J-11: Résulta
- Page 221 and 222:
3.1. Parts successorales, successio
- Page 223 and 224:
Annexe J 769 La loi du 3 août 1926
- Page 225 and 226:
Annexe J 771 300 000 francs 1 . Le
- Page 227 and 228:
Annexe K 773 que pour les extrapola
- Page 229 and 230:
Annexe K 775 Tableau K-3: Les coeff
- Page 231 and 232:
TABLE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES Ta
- Page 233 and 234:
Table des tableaux et graphiques 79
- Page 235 and 236:
Table des tableaux et graphiques 79
- Page 237:
Table des tableaux et graphiques 79
- Page 240 and 241:
802 Les hauts revenus en France au
- Page 242 and 243:
804 Les hauts revenus en France au
- Page 244 and 245:
806 Les hauts revenus en France au