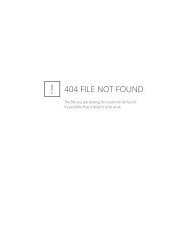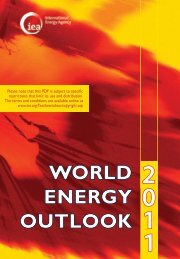annexes (pdf) - Thomas Piketty - Ens
annexes (pdf) - Thomas Piketty - Ens
annexes (pdf) - Thomas Piketty - Ens
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Annexe I 739<br />
locatives aux revenus était évidemment relativement incertain, puisqu’il fallait faire des hypothèses concernant<br />
l’évolution des ratios (valeurs locatives)/revenus en fonction du niveau de revenu.<br />
Tableau I-3: Les estimations de la distribution des revenus figurant dans les projets de loi Doumer (1896)<br />
et Caillaux (1907)<br />
1896 1907<br />
Nombre de revenus Montant des revenus bi Nombre de revenus Montant des revenus bi<br />
0-2 500 9 186 267 12 431 554 480 9 509 800 12 342 000 000<br />
2 500-3 000 562 850 1 537 405 400 2,57 563 000 1 597 000 000 2,73<br />
3 000-5 000 445 978 1 698 296 660 2,89 446 000 1 735 000 000 3,08<br />
5 000-10 000 294 456 2 008 920 990 2,63 294 000 2 109 000 000 2,84<br />
10 000-20 000 122 589 1 668 145 580 2,32 123 000 1 798 000 000 2,52<br />
20 000-50 000 50 809 1 498 915 810 2,08 51 000 1 673 000 000 2,27<br />
50 000-100 000 9 769 611 310 080 1,77 9 800 674 000 000 1,89<br />
100 000+ 3 321 545 451 000 1,64 3 400 572 000 000 1,68<br />
Totaux 10 676 039 22 000 000 000 11 000 000 22 500 000 000<br />
Sources: 1896: BSLC, tome 39, février 1896, p.186 (exposé des motifs du projet de loi déposé par le ministre des Finances Paul Doumer à la Chambre des<br />
députés le 1 er février 1896).<br />
1907: BSLC, tome 61, mars 1907, p.273 (exposé des motifs du projet de loi déposé par le ministre des Finances Joseph Caillaux à la Chambre des députés le<br />
8 février 1907).<br />
Ces chiffres ont également été reproduits par Colson (1903, p.313) (pour l’estimation de 1896) et par Colson (1918, p.420), Colson (1927, p.419) et Levasseur<br />
(1907, p.619) (pour l’estimation de 1907), à la différence près que Colson a regroupé certaines des tranches de revenus initialement utilisées par Doumer et<br />
Caillaux, et que Levasseur a légèrement modifié certains chiffres (apparemment par inadvertance); il est donc préférable de se référer aux publications<br />
originales indiquées ici.<br />
Lecture : D’après l’estimation présentée par Doumer, il existait en 1896 en France 3 321 ménages disposant de revenus supérieurs à 100 000 francs et le<br />
montant total de leurs revenus était d’environ 545 millions de francs (soit un coefficient de Pareto de 1,64)<br />
Notes: (i) Si l’on excepte les coefficients de Pareto bi que nous avons calculées à partir des chiffres fournis par Doumer et Caillaux, les tableaux reproduits ici<br />
sont rigoureusement identiques à ceux publiés dans les projets de loi (en particulier, ces derniers n’indiquaient pas de mentions « très gros revenus »,<br />
« revenus moyens », etc., du type de celles utilisées par Colson (cf. tableau I-4))<br />
(ii) Les coefficients de Pareto bi indiquent les ratios entre le revenu moyen au-delà d’un seuil donné et le seuil en question (cf. annexe B, tableau B-1): par<br />
exemple, d’après l’estimation de 1896, le revenu moyen des ménages disposant de revenus supérieurs à 100 000 francs était 1,64 fois supérieur à 100 000<br />
francs.<br />
Il ne fait aucun doute que cette estimation de 1896, de même que l’estimation de 1907 (qui lui est quasiment<br />
identique), sous-estime de façon importante le poids des très hauts revenus. Cette sous-estimation était<br />
d’ailleurs intentionnelle et affichée comme telle : les services de Doumer reconnaissaient explicitement<br />
qu’ils étaient restés volontairement « au-dessous de la réalité » pour les « gros revenus », et ce afin de se<br />
prémunir contre la fraude et d’aboutir à des prévisions de recettes dont personne ne puisse dire qu’elles<br />
étaient exagérément optimistes (les adversaires de l’impôt sur le revenu faisaient souvent valoir que<br />
l’opposition à l’inquisition fiscale serait telle que le nouvel impôt ne rapporterait pas grand-chose 1 ). Afin<br />
de bien montrer à quel point ils avaient sous-estimé le nombre et le montant des très hauts revenus, les services<br />
de Doumer allèrent même jusqu’à préciser qu’ils avaient évalué à guère plus de 13 000 le nombre de<br />
revenus supérieurs à 50 000 francs (cf. tableau I-3), et ce bien que Leroy-Beaulieu (peu suspect a priori de<br />
chercher à majorer l’importance des gros revenus) avait estimé en 1881 qu’il existait environ 18 000-<br />
20 000 revenus supérieurs à 50 000 francs dans la France de son temps 2 .<br />
Le fait que ces estimations de 1896 et de 1907 sous-estiment de façon importante le poids des très hauts<br />
revenus est également confirmé par l’examen des coefficients de Pareto, c’est-à-dire des ratios entre le re-<br />
été très clairement présentés à la commission de 1894 par le directeur général des contributions directes de l’époque (cf. Commission<br />
extraparlementaire de l’impôt sur les revenus instituée au ministère des Finances (décret du 16 juin 1894) – Procès-verbaux,<br />
tome 1, pp. 467-470, Imprimerie Nationale, 1895), et les services de Doumer n’avaient plus en 1896 qu’à compléter le travail<br />
déjà réalisé dans le cadre de cette commission (le rapport de la commission contenait tous ces matériaux statistiques bruts, mais il ne<br />
contenait par d’estimation de la distribution des revenus ; en particulier, le rapport présenté par le rapporteur général de la commission<br />
Adolphe Coste contenait uniquement des estimations des grands agrégats de revenus au niveau macroéconomique (cf. Commission<br />
extraparlementaire de l’impôt sur les revenus instituée au ministère des Finances (décret du 16 juin 1894) – Procès-verbaux,<br />
tome 2, p. 1077, Imprimerie Nationale, 1895), estimations qui étaient du même type que celles réalisées par Dugé de Bernonville<br />
dans l’entre-deux-guerres (cf. annexe G, tableau G-12), et que Coste avait simplement reprises de ses propres travaux publiées en<br />
1890 (cf. Coste (1890))).<br />
1. Cf. BSLC, tome 39, février 1896, p. 187.<br />
2. Cf. BSLC, tome 39, février 1896, p. 187. L’estimation de Leroy-Beaulieu se fondait elle aussi sur les classements des valeurs<br />
locatives portant sur la ville de Paris, et il avait légèrement rehaussé ses chiffres pour obtenir une estimation valables pour la France<br />
entière : Leroy-Beaulieu était ainsi parvenu à la conclusion qu’il devait exister environ 18 000-20 000 revenus supérieurs à 50 000<br />
francs, et environ 700-800 revenus supérieurs à 250 000 francs (cf. Leroy-Beaulieu (1881, p. 539)). Notons également que Neymarck<br />
(1911), pourtant tout aussi peu suspect que Leroy-Beaulieu de chercher à exagérer l’importance des gros revenus, estima à<br />
environ 20 000 le nombre de revenus supérieurs à 40 000 francs (et ce en considérant uniquement les revenus du capital, puisque<br />
Neymarck se fondait exclusivement sur les statistiques successorales).