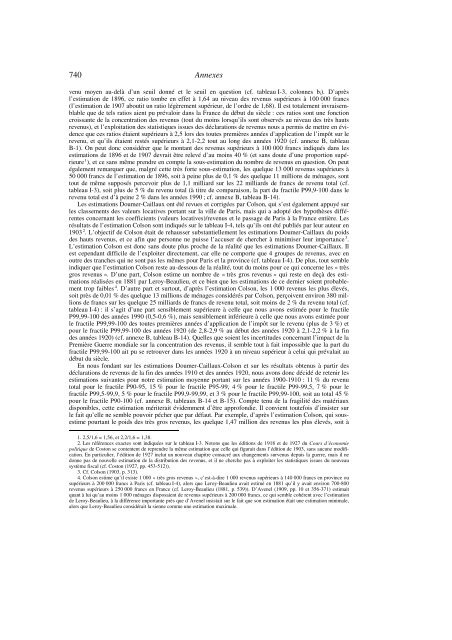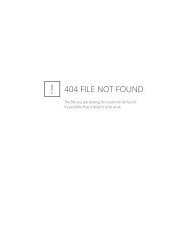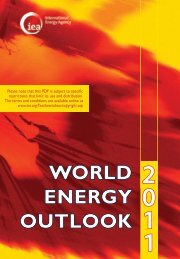annexes (pdf) - Thomas Piketty - Ens
annexes (pdf) - Thomas Piketty - Ens
annexes (pdf) - Thomas Piketty - Ens
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
740 Annexes<br />
venu moyen au-delà d’un seuil donné et le seuil en question (cf. tableau I-3, colonnes bi). D’après<br />
l’estimation de 1896, ce ratio tombe en effet à 1,64 au niveau des revenus supérieurs à 100 000 francs<br />
(l’estimation de 1907 aboutit un ratio légèrement supérieur, de l’ordre de 1,68). Il est totalement invraisemblable<br />
que de tels ratios aient pu prévaloir dans la France du début du siècle : ces ratios sont une fonction<br />
croissante de la concentration des revenus (tout du moins lorsqu’ils sont observés au niveau des très hauts<br />
revenus), et l’exploitation des statistiques issues des déclarations de revenus nous a permis de mettre en évidence<br />
que ces ratios étaient supérieurs à 2,5 lors des toutes premières années d’application de l’impôt sur le<br />
revenu, et qu’ils étaient restés supérieurs à 2,1-2,2 tout au long des années 1920 (cf. annexe B, tableau<br />
B-1). On peut donc considérer que le montant des revenus supérieurs à 100 000 francs indiqués dans les<br />
estimations de 1896 et de 1907 devrait être relevé d’au moins 40 % (et sans doute d’une proportion supérieure<br />
1 ), et ce sans même prendre en compte la sous-estimation du nombre de revenus en question. On peut<br />
également remarquer que, malgré cette très forte sous-estimation, les quelque 13 000 revenus supérieurs à<br />
50 000 francs de l’estimation de 1896, soit à peine plus de 0,1 % des quelque 11 millions de ménages, sont<br />
tout de même supposés percevoir plus de 1,1 milliard sur les 22 milliards de francs de revenu total (cf.<br />
tableau I-3), soit plus de 5 % du revenu total (à titre de comparaison, la part du fractile P99,9-100 dans le<br />
revenu total est d’à peine 2 % dans les années 1990 ; cf. annexe B, tableau B-14).<br />
Les estimations Doumer-Caillaux ont été revues et corrigées par Colson, qui s’est également appuyé sur<br />
les classements des valeurs locatives portant sur la ville de Paris, mais qui a adopté des hypothèses différentes<br />
concernant les coefficients (valeurs locatives)/revenus et le passage de Paris à la France entière. Les<br />
résultats de l’estimation Colson sont indiqués sur le tableau I-4, tels qu’ils ont été publiés par leur auteur en<br />
1903 2 . L’objectif de Colson était de rehausser substantiellement les estimations Doumer-Caillaux du poids<br />
des hauts revenus, et ce afin que personne ne puisse l’accuser de chercher à minimiser leur importance 3 .<br />
L’estimation Colson est donc sans doute plus proche de la réalité que les estimations Doumer-Caillaux. Il<br />
est cependant difficile de l’exploiter directement, car elle ne comporte que 4 groupes de revenus, avec en<br />
outre des tranches qui ne sont pas les mêmes pour Paris et la province (cf. tableau I-4). De plus, tout semble<br />
indiquer que l’estimation Colson reste au-dessous de la réalité, tout du moins pour ce qui concerne les « très<br />
gros revenus ». D’une part, Colson estime un nombre de « très gros revenus » qui reste en deçà des estimations<br />
réalisées en 1881 par Leroy-Beaulieu, et ce bien que les estimations de ce dernier soient probablement<br />
trop faibles 4 . D’autre part et surtout, d’après l’estimation Colson, les 1 000 revenus les plus élevés,<br />
soit près de 0,01 % des quelque 13 millions de ménages considérés par Colson, perçoivent environ 380 millions<br />
de francs sur les quelque 25 milliards de francs de revenu total, soit moins de 2 % du revenu total (cf.<br />
tableau I-4) : il s’agit d’une part sensiblement supérieure à celle que nous avons estimée pour le fractile<br />
P99,99-100 des années 1990 (0,5-0,6 %), mais sensiblement inférieure à celle que nous avons estimée pour<br />
le fractile P99,99-100 des toutes premières années d’application de l’impôt sur le revenu (plus de 3 %) et<br />
pour le fractile P99,99-100 des années 1920 (de 2,8-2,9 % au début des années 1920 à 2,1-2,2 % à la fin<br />
des années 1920) (cf. annexe B, tableau B-14). Quelles que soient les incertitudes concernant l’impact de la<br />
Première Guerre mondiale sur la concentration des revenus, il semble tout à fait impossible que la part du<br />
fractile P99,99-100 ait pu se retrouver dans les années 1920 à un niveau supérieur à celui qui prévalait au<br />
début du siècle.<br />
En nous fondant sur les estimations Doumer-Caillaux-Colson et sur les résultats obtenus à partir des<br />
déclarations de revenus de la fin des années 1910 et des années 1920, nous avons donc décidé de retenir les<br />
estimations suivantes pour notre estimation moyenne portant sur les années 1900-1910 : 11 % du revenu<br />
total pour le fractile P90-95, 15 % pour le fractile P95-99, 4 % pour le fractile P99-99,5, 7 % pour le<br />
fractile P99,5-99,9, 5 % pour le fractile P99,9-99,99, et 3 % pour le fractile P99,99-100, soit au total 45 %<br />
pour le fractile P90-100 (cf. annexe B, tableaux B-14 et B-15). Compte tenu de la fragilité des matériaux<br />
disponibles, cette estimation mériterait évidemment d’être approfondie. Il convient toutefois d’insister sur<br />
le fait qu’elle ne semble pouvoir pécher que par défaut. Par exemple, d’après l’estimation Colson, qui sousestime<br />
pourtant le poids des très gros revenus, les quelque 1,47 million des revenus les plus élevés, soit à<br />
1. 2,5/1,6 = 1,56, et 2,2/1,6 = 1,38.<br />
2. Les références exactes sont indiquées sur le tableau I-3. Notons que les éditions de 1918 et de 1927 du Cours d’économie<br />
politique de Coston se contentent de reprendre la même estimation que celle qui figurait dans l’édition de 1903, sans aucune modification.<br />
En particulier, l’édition de 1927 inclut un nouveau chapitre consacré aux changements survenus depuis la guerre, mais il ne<br />
donne pas de nouvelle estimation de la distribution des revenus, et il ne cherche pas à exploiter les statistiques issues du nouveau<br />
système fiscal (cf. Coston (1927, pp. 453-512)).<br />
3. Cf. Colson (1903, p. 313).<br />
4. Colson estime qu’il existe 1 000 « très gros revenus », c’est-à-dire 1 000 revenus supérieurs à 140 000 francs en province ou<br />
supérieurs à 200 000 francs à Paris (cf. tableau I-4), alors que Leroy-Beaulieu avait estimé en 1881 qu’il y avait environ 700-800<br />
revenus supérieurs à 250 000 francs en France (cf. Leroy-Beaulieu (1881, p. 539)). D’Avenel (1909, pp. 10 et 356-371) estimait<br />
quant à lui qu’au moins 1 000 ménages disposaient de revenus supérieurs à 200 000 francs, ce qui semble cohérent avec l’estimation<br />
de Leroy-Beaulieu, à la différence importante près que d’Avenel insistait sur le fait que son estimation était une estimation minimale,<br />
alors que Leroy-Beaulieu considérait la sienne comme une estimation maximale.