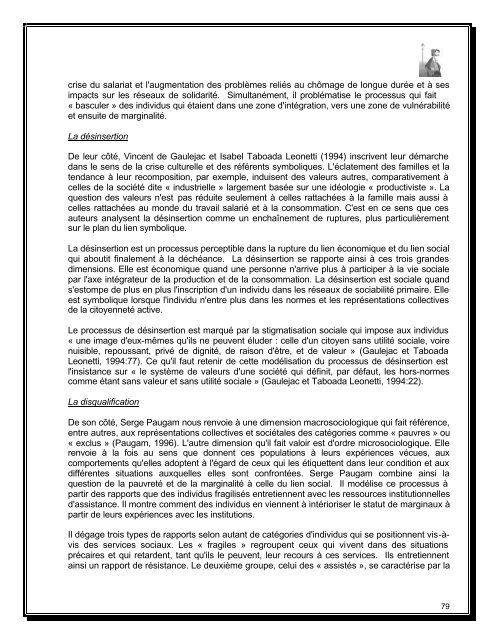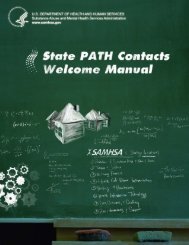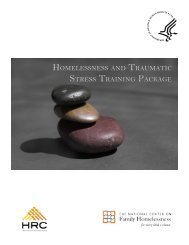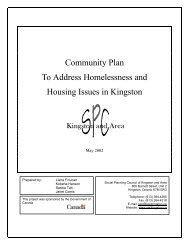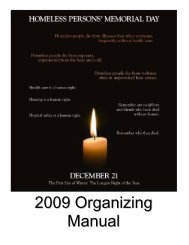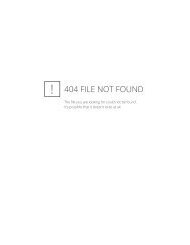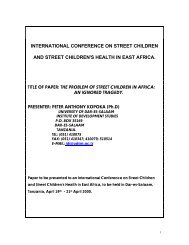Rapport de recherche sur la population itinérante et - Homelessness ...
Rapport de recherche sur la population itinérante et - Homelessness ...
Rapport de recherche sur la population itinérante et - Homelessness ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
crise du sa<strong>la</strong>riat <strong>et</strong> l'augmentation <strong>de</strong>s problèmes reliés au chômage <strong>de</strong> longue durée <strong>et</strong> à ses<br />
impacts <strong>sur</strong> les réseaux <strong>de</strong> solidarité. Simultanément, il problématise le processus qui fait<br />
« basculer » <strong>de</strong>s individus qui étaient dans une zone d'intégration, vers une zone <strong>de</strong> vulnérabilité<br />
<strong>et</strong> ensuite <strong>de</strong> marginalité.<br />
La désinsertion<br />
De leur côté, Vincent <strong>de</strong> Gaulejac <strong>et</strong> Isabel Taboada Leon<strong>et</strong>ti (1994) inscrivent leur démarche<br />
dans le sens <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise culturelle <strong>et</strong> <strong>de</strong>s référents symboliques. L'éc<strong>la</strong>tement <strong>de</strong>s familles <strong>et</strong> <strong>la</strong><br />
tendance à leur recomposition, par exemple, induisent <strong>de</strong>s valeurs autres, comparativement à<br />
celles <strong>de</strong> <strong>la</strong> société dite « industrielle » <strong>la</strong>rgement basée <strong>sur</strong> une idéologie « productiviste ». La<br />
question <strong>de</strong>s valeurs n'est pas réduite seulement à celles rattachées à <strong>la</strong> famille mais aussi à<br />
celles rattachées au mon<strong>de</strong> du travail sa<strong>la</strong>rié <strong>et</strong> à <strong>la</strong> consommation. C'est en ce sens que ces<br />
auteurs analysent <strong>la</strong> désinsertion comme un enchaînement <strong>de</strong> ruptures, plus particulièrement<br />
<strong>sur</strong> le p<strong>la</strong>n du lien symbolique.<br />
La désinsertion est un processus perceptible dans <strong>la</strong> rupture du lien économique <strong>et</strong> du lien social<br />
qui aboutit finalement à <strong>la</strong> déchéance. La désinsertion se rapporte ainsi à ces trois gran<strong>de</strong>s<br />
dimensions. Elle est économique quand une personne n'arrive plus à participer à <strong>la</strong> vie sociale<br />
par l'axe intégrateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> production <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation. La désinsertion est sociale quand<br />
s'estompe <strong>de</strong> plus en plus l'inscription d'un individu dans les réseaux <strong>de</strong> sociabilité primaire. Elle<br />
est symbolique lorsque l'individu n'entre plus dans les normes <strong>et</strong> les représentations collectives<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> citoyenn<strong>et</strong>é active.<br />
Le processus <strong>de</strong> désinsertion est marqué par <strong>la</strong> stigmatisation sociale qui impose aux individus<br />
« une image d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent élu<strong>de</strong>r : celle d'un citoyen sans utilité sociale, voire<br />
nuisible, repoussant, privé <strong>de</strong> dignité, <strong>de</strong> raison d'être, <strong>et</strong> <strong>de</strong> valeur » (Gaulejac <strong>et</strong> Taboada<br />
Leon<strong>et</strong>ti, 1994:77). Ce qu'il faut r<strong>et</strong>enir <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te modélisation du processus <strong>de</strong> désinsertion est<br />
l'insistance <strong>sur</strong> « le système <strong>de</strong> valeurs d'une société qui définit, par défaut, les hors-normes<br />
comme étant sans valeur <strong>et</strong> sans utilité sociale » (Gaulejac <strong>et</strong> Taboada Leon<strong>et</strong>ti, 1994:22).<br />
La disqualification<br />
De son côté, Serge Paugam nous renvoie à une dimension macrosociologique qui fait référence,<br />
entre autres, aux représentations collectives <strong>et</strong> sociétales <strong>de</strong>s catégories comme « pauvres » ou<br />
« exclus » (Paugam, 1996). L'autre dimension qu'il fait valoir est d'ordre microsociologique. Elle<br />
renvoie à <strong>la</strong> fois au sens que donnent ces popu<strong>la</strong>tions à leurs expériences vécues, aux<br />
comportements qu'elles adoptent à l'égard <strong>de</strong> ceux qui les étiqu<strong>et</strong>tent dans leur condition <strong>et</strong> aux<br />
différentes situations auxquelles elles sont confrontées. Serge Paugam combine ainsi <strong>la</strong><br />
question <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvr<strong>et</strong>é <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> marginalité à celle du lien social. Il modélise ce processus à<br />
partir <strong>de</strong>s rapports que <strong>de</strong>s individus fragilisés entr<strong>et</strong>iennent avec les ressources institutionnelles<br />
d'assistance. Il montre comment <strong>de</strong>s individus en viennent à intérioriser le statut <strong>de</strong> marginaux à<br />
partir <strong>de</strong> leurs expériences avec les institutions.<br />
Il dégage trois types <strong>de</strong> rapports selon autant <strong>de</strong> catégories d'individus qui se positionnent vis-àvis<br />
<strong>de</strong>s services sociaux. Les « fragiles » regroupent ceux qui vivent dans <strong>de</strong>s situations<br />
précaires <strong>et</strong> qui r<strong>et</strong>ar<strong>de</strong>nt, tant qu'ils le peuvent, leur recours à ces services. Ils entr<strong>et</strong>iennent<br />
ainsi un rapport <strong>de</strong> résistance. Le <strong>de</strong>uxième groupe, celui <strong>de</strong>s « assistés », se caractérise par <strong>la</strong><br />
79