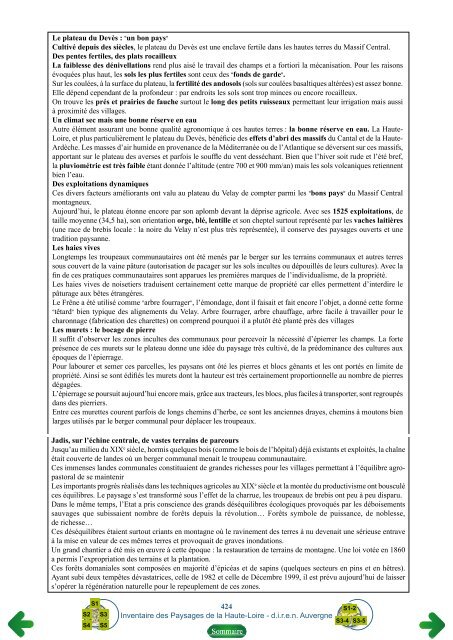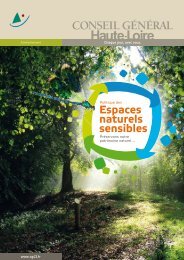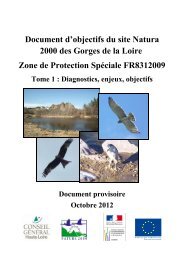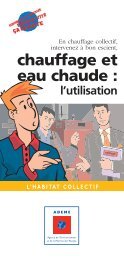Inventaire des Paysages de la Haute-Loire - Conseil général 43
Inventaire des Paysages de la Haute-Loire - Conseil général 43
Inventaire des Paysages de la Haute-Loire - Conseil général 43
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Le p<strong>la</strong>teau du Devès : « un bon pays »<br />
Cultivé <strong>de</strong>puis <strong><strong>de</strong>s</strong> siècles, le p<strong>la</strong>teau du Devès est une enc<strong>la</strong>ve fertile dans les hautes terres du Massif Central.<br />
Des pentes fertiles, <strong><strong>de</strong>s</strong> p<strong>la</strong>ts rocailleux<br />
La faiblesse <strong><strong>de</strong>s</strong> dénivel<strong>la</strong>tions rend plus aisé le travail <strong><strong>de</strong>s</strong> champs et a fortiori <strong>la</strong> mécanisation. Pour les raisons<br />
évoquées plus haut, les sols les plus fertiles sont ceux <strong><strong>de</strong>s</strong> « fonds <strong>de</strong> gar<strong>de</strong> » .<br />
Sur les coulées, à <strong>la</strong> surface du p<strong>la</strong>teau, <strong>la</strong> fertilité <strong><strong>de</strong>s</strong> andosols (sols sur coulées basaltiques altérées) est assez bonne.<br />
Elle dépend cependant <strong>de</strong> <strong>la</strong> profon<strong>de</strong>ur : par endroits les sols sont trop minces ou encore rocailleux.<br />
On trouve les prés et prairies <strong>de</strong> fauche surtout le long <strong><strong>de</strong>s</strong> petits ruisseaux permettant leur irrigation mais aussi<br />
à proximité <strong><strong>de</strong>s</strong> vil<strong>la</strong>ges.<br />
Un climat sec mais une bonne réserve en eau<br />
Autre élément assurant une bonne qualité agronomique à ces hautes terres : <strong>la</strong> bonne réserve en eau. La <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Loire</strong>, et plus particulièrement le p<strong>la</strong>teau du Devès, bénéficie <strong><strong>de</strong>s</strong> effets d’abri <strong><strong>de</strong>s</strong> massifs du Cantal et <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
Ardèche. Les masses d’air humi<strong>de</strong> en provenance <strong>de</strong> <strong>la</strong> Méditerranée ou <strong>de</strong> l’At<strong>la</strong>ntique se déversent sur ces massifs,<br />
apportant sur le p<strong>la</strong>teau <strong><strong>de</strong>s</strong> averses et parfois le souffle du vent <strong><strong>de</strong>s</strong>séchant. Bien que l’hiver soit ru<strong>de</strong> et l’été bref,<br />
<strong>la</strong> pluviométrie est très faible étant donnée l’altitu<strong>de</strong> (entre 700 et 900 mm/an) mais les sols volcaniques retiennent<br />
bien l’eau.<br />
Des exploitations dynamiques<br />
Ces divers facteurs améliorants ont valu au p<strong>la</strong>teau du Ve<strong>la</strong>y <strong>de</strong> compter parmi les « bons pays » du Massif Central<br />
montagneux.<br />
Aujourd’hui, le p<strong>la</strong>teau étonne encore par son aplomb <strong>de</strong>vant <strong>la</strong> déprise agricole. Avec ses 1525 exploitations, <strong>de</strong><br />
taille moyenne (34,5 ha), son orientation orge, blé, lentille et son cheptel surtout représenté par les vaches <strong>la</strong>itières<br />
(une race <strong>de</strong> brebis locale : <strong>la</strong> noire du Ve<strong>la</strong>y n’est plus très représentée), il conserve <strong><strong>de</strong>s</strong> paysages ouverts et une<br />
tradition paysanne.<br />
Les haies vives<br />
Longtemps les troupeaux communautaires ont été menés par le berger sur les terrains communaux et autres terres<br />
sous couvert <strong>de</strong> <strong>la</strong> vaine pâture (autorisation <strong>de</strong> pacager sur les sols incultes ou dépouillés <strong>de</strong> leurs cultures). Avec <strong>la</strong><br />
fin <strong>de</strong> ces pratiques communautaires sont apparues les premières marques <strong>de</strong> l’individualisme, <strong>de</strong> <strong>la</strong> propriété.<br />
Les haies vives <strong>de</strong> noisetiers traduisent certainement cette marque <strong>de</strong> propriété car elles permettent d’interdire le<br />
pâturage aux bêtes étrangères.<br />
Le Frêne a été utilisé comme « arbre fourrager » , l’émondage, dont il faisait et fait encore l’objet, a donné cette forme<br />
« têtard » bien typique <strong><strong>de</strong>s</strong> alignements du Ve<strong>la</strong>y. Arbre fourrager, arbre chauffage, arbre facile à travailler pour le<br />
charonnage (fabrication <strong><strong>de</strong>s</strong> charettes) on comprend pourquoi il a plutôt été p<strong>la</strong>nté près <strong><strong>de</strong>s</strong> vil<strong>la</strong>ges<br />
Les murets : le bocage <strong>de</strong> pierre<br />
Il suffit d’observer les zones incultes <strong><strong>de</strong>s</strong> communaux pour percevoir <strong>la</strong> nécessité d’épierrer les champs. La forte<br />
présence <strong>de</strong> ces murets sur le p<strong>la</strong>teau donne une idée du paysage très cultivé, <strong>de</strong> <strong>la</strong> prédominance <strong><strong>de</strong>s</strong> cultures aux<br />
époques <strong>de</strong> l’épierrage.<br />
Pour <strong>la</strong>bourer et semer ces parcelles, les paysans ont ôté les pierres et blocs gênants et les ont portés en limite <strong>de</strong><br />
propriété. Ainsi se sont édifiés les murets dont <strong>la</strong> hauteur est très certainement proportionnelle au nombre <strong>de</strong> pierres<br />
dégagées.<br />
L’épierrage se poursuit aujourd’hui encore mais, grâce aux tracteurs, les blocs, plus faciles à transporter, sont regroupés<br />
dans <strong><strong>de</strong>s</strong> pierriers.<br />
Entre ces murettes courent parfois <strong>de</strong> longs chemins d’herbe, ce sont les anciennes drayes, chemins à moutons bien<br />
<strong>la</strong>rges utilisés par le berger communal pour dép<strong>la</strong>cer les troupeaux.<br />
Jadis, sur l’échine centrale, <strong>de</strong> vastes terrains <strong>de</strong> parcours<br />
Jusqu’au milieu du XIX e siècle, hormis quelques bois (comme le bois <strong>de</strong> l’hôpital) déjà existants et exploités, <strong>la</strong> chaîne<br />
était couverte <strong>de</strong> <strong>la</strong>n<strong><strong>de</strong>s</strong> où un berger communal menait le troupeau communautaire.<br />
Ces immenses <strong>la</strong>n<strong><strong>de</strong>s</strong> communales constituaient <strong>de</strong> gran<strong><strong>de</strong>s</strong> richesses pour les vil<strong>la</strong>ges permettant à l’équilibre agropastoral<br />
<strong>de</strong> se maintenir<br />
Les importants progrès réalisés dans les techniques agricoles au XIX e siècle et <strong>la</strong> montée du productivisme ont bousculé<br />
ces équilibres. Le paysage s’est transformé sous l’effet <strong>de</strong> <strong>la</strong> charrue, les troupeaux <strong>de</strong> brebis ont peu à peu disparu.<br />
Dans le même temps, l’Etat a pris conscience <strong><strong>de</strong>s</strong> grands déséquilibres écologiques provoqués par les déboisements<br />
sauvages que subissaient nombre <strong>de</strong> forêts <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> révolution… Forêts symbole <strong>de</strong> puissance, <strong>de</strong> noblesse,<br />
<strong>de</strong> richesse…<br />
Ces déséquilibres étaient surtout criants en montagne où le ravinement <strong><strong>de</strong>s</strong> terres à nu <strong>de</strong>venait une sérieuse entrave<br />
à <strong>la</strong> mise en valeur <strong>de</strong> ces mêmes terres et provoquait <strong>de</strong> graves inondations.<br />
Un grand chantier a été mis en œuvre à cette époque : <strong>la</strong> restauration <strong>de</strong> terrains <strong>de</strong> montagne. Une loi votée en 1860<br />
a permis l’expropriation <strong><strong>de</strong>s</strong> terrains et <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ntation.<br />
Ces forêts domaniales sont composées en majorité d’épicéas et <strong>de</strong> sapins (quelques secteurs en pins et en hêtres).<br />
Ayant subi <strong>de</strong>ux tempêtes dévastatrices, celle <strong>de</strong> 1982 et celle <strong>de</strong> Décembre 1999, il est prévu aujourd’hui <strong>de</strong> <strong>la</strong>isser<br />
s’opérer <strong>la</strong> régénération naturelle pour le repeuplement <strong>de</strong> ces zones.<br />
424<br />
<strong>Inventaire</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Paysages</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Loire</strong> - d.i.r.e.n. Auvergne