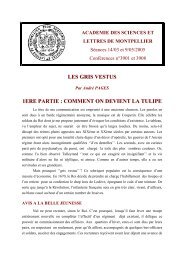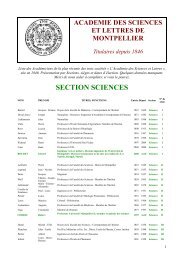le christianisme tragique de s. kierkegaard dans son journal
le christianisme tragique de s. kierkegaard dans son journal
le christianisme tragique de s. kierkegaard dans son journal
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Académie <strong>de</strong>s Sciences et Lettres <strong>de</strong> Montpellier, 2002, Bernard Chédozeau<br />
Au moins tel<strong>le</strong> que l’entend Kierkegaard (car comment y reconnaître toute l’ascèse<br />
médiéva<strong>le</strong> et tout <strong>le</strong> monachisme ?), cette ascèse est un élitisme, un « aristocratisme »,<br />
parfaitement contraire à la recherche chrétienne <strong>de</strong> l’exclusion par <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> et <strong>de</strong> la<br />
souffrance reçue <strong>de</strong> Dieu. L’ascète oublie <strong>de</strong> faire en sorte que sa vie « ressemb<strong>le</strong> à cel<strong>le</strong> <strong>de</strong>s<br />
miséreux » cclxxvii , d’être chassé du mon<strong>de</strong> en rai<strong>son</strong> <strong>de</strong> sa vie proprement chrétienne : « L’erreur<br />
<strong>de</strong> l’ascèse du Moyen Age était <strong>de</strong> biffer d’un trait la souffrance spécifiquement chrétienne,<br />
[qui est] souffrir du fait <strong>de</strong>s hommes » et non souffrir <strong>de</strong> <strong>son</strong> propre choix cclxxviii . Directement<br />
reconnaissab<strong>le</strong> comme tel, se donnant comme tel, l’ascète médiéval se présente comme<br />
admirab<strong>le</strong> par ses souffrances et <strong>son</strong> statut : « Le cloître […] acceptait <strong>de</strong> se laisser considérer,<br />
lui et sa vie, comme l’Extraordinaire, que payait directement l’admiration <strong>de</strong>s<br />
contemporains » cclxxix ; il aspirait « au prestige <strong>de</strong> l’Extraordinaire » cclxxx .<br />
Kierkegaard s’indigne <strong>de</strong> quelques exemp<strong>le</strong>s <strong>de</strong> ce « reconnaissab<strong>le</strong> direct », <strong>de</strong> cet<br />
« aristocratisme » : <strong>le</strong>s mortifications, humiliations, jeûnes, flagellations, et plus encore <strong>le</strong>s<br />
stigmates du Christ, toutes ces dévotions ne <strong>son</strong>t que « <strong>de</strong> l’exagération » ; ou <strong>le</strong> lavement <strong>de</strong>s<br />
pieds par <strong>le</strong> pape : tout <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> sait que c’est <strong>le</strong> pape qui agit, et « <strong>le</strong> gain est doub<strong>le</strong> :<br />
prestige pontifical et prestige <strong>de</strong> l’humilité » cclxxxi . Kierkegaard vomit cette « effronterie » <strong>de</strong> se<br />
prétendre meil<strong>le</strong>ur que <strong>le</strong>s autres, au lieu au minimum <strong>de</strong> passer inaperçu.<br />
Bref, loin d’en faire une victime du mon<strong>de</strong> cette imitation qui se veut ascétique rend<br />
en réalité <strong>le</strong> chrétien conforme au mon<strong>de</strong> : c’est une « mondanité déguisée », une complète<br />
trahi<strong>son</strong> <strong>de</strong> l’idéal du Christ. Cette imitation mal conçue se trahit, « se mondanise », el<strong>le</strong> se<br />
fait accepter par <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> au lieu <strong>de</strong> naître du refus du chrétien par <strong>le</strong> mon<strong>de</strong>, <strong>de</strong> <strong>son</strong><br />
exclusion hors du mon<strong>de</strong> par <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> ; à vue humaine, <strong>le</strong> chrétien y trouve même <strong>son</strong><br />
compte. C’est la condamnation au fond <strong>de</strong> l’ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong>s pratiques du monachisme, et <strong>le</strong><br />
catholicisme n’est pas moins la cib<strong>le</strong> <strong>de</strong>s attaques <strong>de</strong> Kierkegaard que <strong>le</strong> luthéranisme <strong>de</strong> ses<br />
compatriotes.<br />
pseudonymes.<br />
« Le message indirect » et <strong>le</strong>s pseudonymes<br />
C’est par cette volonté <strong>de</strong> s’effacer que s’explique, au moins en partie, <strong>le</strong> recours aux<br />
Certes Kierkegaard se sait l’Extraordinaire, mais il ne peut <strong>le</strong> reconnaître : « Je<br />
pourrais, je crois, avoir <strong>le</strong> courage <strong>de</strong> cé<strong>de</strong>r la vie pour faire place à l’Extraordinaire – mais<br />
quant à être tenu pour lui, non, j’en suis incapab<strong>le</strong> : il me semb<strong>le</strong>rait contaminer par là ce qui<br />
m’a été confié » cclxxxii . Pour éviter ce danger, « je revêtis l’existence d’un homme malin et léger<br />
en usant […] <strong>de</strong> pseudonymes », en un « parcours édifiant » qui est comme <strong>le</strong> Guadalquivir<br />
qui « se précipite sous terre à un certain endroit » 43 ; « ce n’était pas une idée fausse d’arrêter<br />
43 II A 497 et Xi A 546 ; voir aussi à propos <strong>de</strong> Crainte et tremb<strong>le</strong>ment, quand celui qu’on regardait comme<br />
l’auteur « se promenait sous l’incognito d’un flâneur avec l’air d’incarner l’espièg<strong>le</strong>rie, l’esprit, la légèreté… »<br />
(Xii A 15).<br />
31