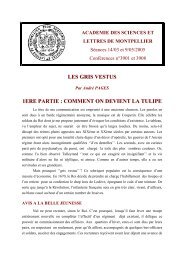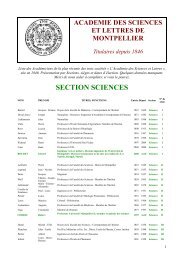le christianisme tragique de s. kierkegaard dans son journal
le christianisme tragique de s. kierkegaard dans son journal
le christianisme tragique de s. kierkegaard dans son journal
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Académie <strong>de</strong>s Sciences et Lettres <strong>de</strong> Montpellier, 2002, Bernard Chédozeau<br />
admirait ce prélat, et il a beaucoup <strong>de</strong> peine à prendre ses distances par rapport à lui. Mais il<br />
en vient peu à peu à <strong>de</strong>s attaques féroces : l’évêque Mynster « idolâtre l’ordre établi » ; <strong>le</strong><br />
dimanche, il « s’engraisse <strong>de</strong> mondanité et se farcit <strong>de</strong> dévotion » <strong>de</strong>rrière une soutane <strong>de</strong><br />
velours li . La critique peut-être la plus forte concerne sa religiosité, qui est <strong>de</strong> « vivre<br />
essentiel<strong>le</strong>ment comme un païen honnête, mais en avouant en même temps qu’on est loin<br />
d’avoir atteint l’idéal : c’est cet aveu qu’il considère comme <strong>le</strong> <strong>christianisme</strong> » lii . Pourtant <strong>le</strong>s<br />
attaques <strong>le</strong>s plus vio<strong>le</strong>ntes <strong>son</strong>t portées contre <strong>le</strong> successeur <strong>de</strong> Mynster, l’évêque Martensen liii .<br />
Il y a là entre l’Eglise et <strong>le</strong>s pouvoirs établis une relation déviante que Kierkegaard<br />
dénonce jusque chez Luther : « cette confusion d’être réformateur en s’aidant <strong>de</strong> la<br />
politique ». Il déplore ce qu’il juge être une collusion inadmissib<strong>le</strong> <strong>de</strong> l’Eglise et du mon<strong>de</strong> :<br />
<strong>le</strong>s relations entre l’Etat et l’Eglise établie <strong>son</strong>t une « forme supérieure <strong>de</strong> l’égoïsme » liv . Sur<br />
ce sujet, Kierkegaard développe une analyse profon<strong>de</strong>. Il estime en effet qu’une Eglise<br />
installée lv , une Eglise qui collabore p<strong>le</strong>inement avec <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> comme l’Eglise luthérienne<br />
danoise <strong>de</strong> <strong>son</strong> temps, est en contradiction avec <strong>le</strong> <strong>de</strong>venir chrétien : <strong>le</strong> <strong>christianisme</strong> est élan<br />
(« la vie chrétienne est en <strong>de</strong>venir », contre Sch<strong>le</strong>iermacher lvi ), mission, dynamique, et<br />
certainement pas état, stabilité : « L’Eglise doit en propre représenter <strong>le</strong> “<strong>de</strong>venir” », à l’Etat<br />
au contraire d’incarner <strong>le</strong> permanent. Il y a <strong>dans</strong> <strong>le</strong>ur liai<strong>son</strong> une contradiction scanda<strong>le</strong>use.<br />
C’est pourquoi Kierkegaard prône vigoureusement la séparation <strong>de</strong> l’Eglise et <strong>de</strong> l’Etat :<br />
« C’eût même été <strong>son</strong> <strong>de</strong>voir [au c<strong>le</strong>rgé] <strong>de</strong> la proposer lui-même » lvii . Et il s’indigne <strong>de</strong> ce<br />
que Guizot affirme que « la seu<strong>le</strong> politique pour l’Etat est l’indifférence en matière <strong>de</strong><br />
religion… », avec cet argument significatif : « … comme si l’Etat n’avait pas besoin <strong>de</strong> la<br />
religion - alors que c’est el<strong>le</strong> qui n’a pas besoin <strong>de</strong> lui » lviii .<br />
3. Le <strong>christianisme</strong> a évacué <strong>le</strong>s croyances dures<br />
Sur <strong>le</strong> plan doctrinal, Kierkegaard dénonce l’évacuation et fina<strong>le</strong>ment la disparition<br />
<strong>de</strong>s croyances dures portées par <strong>le</strong>s phrases exigeantes du Christ. « L’usage actuel, c’est<br />
d’omettre <strong>le</strong>s passages du Nouveau Testament qui exténuent [cf. exténuant] l’existence . On<br />
<strong>le</strong>s tait… » lix . L’exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong> plus net est la disparition <strong>de</strong> la croyance en la damnation éternel<strong>le</strong>,<br />
en l’éternité <strong>de</strong>s peines <strong>de</strong> l’enfer : « Le Nouveau Testament repose sur l’idée qu’il y a une<br />
perdition éternel<strong>le</strong>, et peut-être qu’il n’y en a pas un seul <strong>de</strong> sauvé sur <strong>de</strong>s millions d’hommes.<br />
Mais notre éducation chrétienne nous enseigne que fina<strong>le</strong>ment nous serons sauvés… » lx ; c’est<br />
« cette mol<strong>le</strong>sse <strong>de</strong> croire qu’en somme on sera tous sauvés » lxi . Kierkegaard imagine un<br />
dialogue fictif : « Tu ne crois pas à une damnation éternel<strong>le</strong> ? – Mais <strong>le</strong> <strong>christianisme</strong> <strong>le</strong> dit<br />
partout ! » lxii . Il en est <strong>de</strong> même à propos <strong>de</strong>s exigences du Christ <strong>de</strong> haïr père et mère : « La<br />
chrétienté, inversement, emploie <strong>le</strong> <strong>christianisme</strong> à resserrer au plus intime tous ces liens déjà<br />
profonds <strong>de</strong> nature : <strong>le</strong> <strong>christianisme</strong> [est-il enseigné aujourd’hui], c’est justement d’aimer<br />
père et mère » lxiii .<br />
Kierkegaard a <strong>de</strong>s formu<strong>le</strong>s très dures pour condamner cet affadissement. La<br />
chrétienté n’est plus qu’une « menterie pour l’existentiel » : « S’épargner passe pour sagesse<br />
9