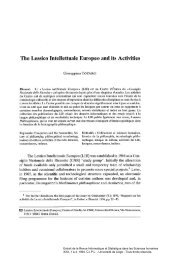Texte complet - Université de Liège
Texte complet - Université de Liège
Texte complet - Université de Liège
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Introduction au système <strong>de</strong> nomination <strong>de</strong>s serpents en grec ancien<br />
queue, <strong>de</strong>ux lignes noires 89 ; queue saturée <strong>de</strong><br />
noir 90 ; sur le corps entier [= dos et flancs],<br />
taches (stigmai) noires (melainai) et brun rouxorange<br />
(kirrai) 91 .<br />
B i o t o p e : désert <strong>de</strong> sable 92 (zone littorale 93 et<br />
arrière-pays 94 ).<br />
C o m p o r t e m e n t : se tient enfouie dans le<br />
sable 95 .<br />
89. Sostratos d’Alexandrie (i er siècle ; cf. Zucker 2008), (Les animaux<br />
qui frappent et les animaux qui mor<strong>de</strong>nt) fr. 5 (Wellmann 1891 :<br />
347, cf. 337 ; source : Élien, Le propre <strong>de</strong>s animaux, VI,<br />
51) ; synonyme : melanouros chez Élien, (Sextus) Julius<br />
Africanus, Hippiatrica Cantabrigiensia, Souda, [Zonaras] :<br />
voir p. 86, tableau 1 ; ci-<strong>de</strong>ssous, 2.3.2.2.1 [p. 100], tableau 4 :<br />
« 1. Morphologie, couleurs » ; comparer ci-<strong>de</strong>ssous, 3.3.1.2, ad<br />
n. 185-186 : Lettre d’Alexandre à Aristote (« ammodutai blancs …<br />
brun roux ») et, p. 109, tableau 5 : « Couleur et marquage ».<br />
90. Nicandre, Ther., 337 et schol. a Nicandre, Ther., 334 (Crugnola<br />
1971 : 147, l. 4). Cf. ci-<strong>de</strong>ssus, 2.1.3.1, ad n. 64 ; ci-<strong>de</strong>ssous,<br />
3.3.1.2 [p. 109], tableau 5 : « Couleur et marquage ».<br />
91. Philouménos, De ven. anim., 20, 1 (Wellmann 1908a : 26,<br />
l. 17) ; cf. Aétios d’Amida, Libri med., XIII, 24 (Zervos 1905 :<br />
285, l. 11-12). Voir ci-<strong>de</strong>ssous, 2.3.2.2.1 [p. 100], tableau 4 :<br />
« 1. Morphologie, couleurs » ; comparer 3.3.1.2 [p. 109], tableau<br />
5 : « Couleur et marquage ».<br />
92. Lucien, Dipsa<strong>de</strong>s, 1. Synonymes : ammoatis (Souda ;<br />
[Zonaras]) ; ammobatēs (Élien) ; ammodutēs ([Sextus] Julius<br />
Africanus, Hippiatrica Cantabrigiensia), voir ci-après tableau 1 ;<br />
ci-<strong>de</strong>ssous, 2.3.2.2.1 [p. 100], tableau 4 : « 2. Bio-écologie ».<br />
93. Lucien, Dipsa<strong>de</strong>s, 6 ; Galien, De simpl. med., I, 1 (Kühn, XII,<br />
1826 : 316, l. 9-11), dans l’exposé <strong>de</strong> son enquête auprès <strong>de</strong>s<br />
Marses en vue <strong>de</strong> déterminer la cause <strong>de</strong> la salinité <strong>de</strong> la chair <strong>de</strong>s<br />
dipsa<strong>de</strong>s, une propriété qui contribue aussi à justifier leur nom<br />
- et donc confirme son sens actif - et qui les fait exclure <strong>de</strong>s<br />
ingrédients <strong>de</strong> la thériaque, vu les effets assoiffants analogues à<br />
ceux du venin sur les consommateurs <strong>de</strong> cette chair (voir ci-<strong>de</strong>ssus,<br />
2.1.3.1, n. 56 : De sympt. causis ; cf. ibi<strong>de</strong>m, Oribase, Paul<br />
d’Égine) ; Aétios d’Amida, Libri med., XIII, 24 (Zervos 1905 :<br />
285, l. 10). Sur la thériaque, voir Watson 1966 : 64-82 ;<br />
Mayor 2010 : 239-247.<br />
94. Lucien, Dipsa<strong>de</strong>s, 2-4.<br />
95. Lucien, Dipsa<strong>de</strong>s, 8 (en l’occurrence, à proximité d’une<br />
ponte d’autruche sur le rivage <strong>de</strong> la Gran<strong>de</strong> Syrte ; voir ci-<strong>de</strong>ssus,<br />
2.1.3.1, ad n. 77 ; confirmation du comportement d’immersion<br />
par un témoin oculaire, cf. scholie au chap. 8 [Rabe 1906 : 232,<br />
l. 9] ; voir ci-<strong>de</strong>ssous, 2.3.2.2.1 [p. 100], tableau 4 : « 2. Bioécologie<br />
») ; cf. Dipsa<strong>de</strong>s, 6 : <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> la stèle funéraire<br />
sculptée du ramasseur d’œufs d’autruche décédé là <strong>de</strong>s suites <strong>de</strong><br />
la morsure d’une dipsas qui, se dégageant du sable, aurait, selon<br />
Lucien, attaqué l’individu (comparer ci-<strong>de</strong>ssus, n. 84 : Isidore <strong>de</strong><br />
Séville et renvois internes) et transcription <strong>de</strong> la première moitié<br />
<strong>de</strong> l’épitaphe (détails ci-<strong>de</strong>ssous, 2.1.3.2.2, n. 104 : Lucien).<br />
Comparer ci-<strong>de</strong>ssus, 2.1.2 (épitaphe d’Alciménès).<br />
Locomotion : « les dipsa<strong>de</strong>s sont paresseuses<br />
dans leur progression » 96 .<br />
Certains <strong>de</strong> ces traits (a) morphologiques ou<br />
(b) bio-écologiques et comportementaux ont<br />
valu à la dipsas afro-égyptienne cinq appellations<br />
synonymes dont l’une a <strong>de</strong>ux orthographes<br />
(cf. p. 86, tableau 1) : (a) kentrinēs/<br />
kentris « (le) piquant, (la) piqueuse » (voir<br />
ci-<strong>de</strong>ssous, 3.4.1 ; 3.5.1), melanouros « noirequeue<br />
» (voir ci-<strong>de</strong>ssous, 3.6.1.2) et (b) ammoatis<br />
« sablonneur » (voir ci-<strong>de</strong>ssous, 3.1.1),<br />
ammobatēs « marcheur-du-sable » (voir ci<strong>de</strong>ssous,<br />
3.2.1), ammodutēs « immergeur-dusable<br />
» (voir ci-<strong>de</strong>ssous, 3.3.1.2).<br />
Contrairement aux synonymes toxicologiques<br />
(voir ci-<strong>de</strong>ssous, 2.1.3.2.2, dont tableau 2), aucun<br />
<strong>de</strong> ces vocables ne se rencontre en rapport<br />
explicite avec dipsas dans les textes médicaux et<br />
pharmacologiques. D’autre part, Lucain mentionne<br />
hammodytes et Philouménos ammodutēs<br />
sans corrélation avec dipsas (voir ci-<strong>de</strong>ssous,<br />
2.1.3.2.2 [p. 89], tableau 3) dont tous <strong>de</strong>ux<br />
parlent par ailleurs.<br />
2.1.3.2.2. Caractéristiques toxicologiques<br />
Au total <strong>de</strong>s témoignages postérieurs à Nicandre<br />
qui évoquent la morsure - violente (biaios) 97 -<br />
<strong>de</strong> la dipsas afro-égyptienne, les premiers symptômes<br />
<strong>de</strong> l’injection <strong>de</strong> son épais (pachus) venin 98<br />
sont ceux du syndrome vipérin local tels qu’ils<br />
96. Schol. Nic., Ther., 343-354 (Crugnola 1971 : 149, l. 9 ; ci-<strong>de</strong>ssus,<br />
2.1.3.1, n. 67) ; voir ci-<strong>de</strong>ssous, 2.3.2.2.1 [p. 101], tableau 4 :<br />
« 3. Locomotion ». Comparer 4.3.1.2 ([Aélius Promotus]) et<br />
n. 293.<br />
97. Lucien, Dipsa<strong>de</strong>s, 4.<br />
98. Lucien, Dipsa<strong>de</strong>s, 4 et 5. Cf. Chippaux (2002 : 219) :<br />
« Syndrome vipérin … douleur immédiate… toujours vive, transfixiante,<br />
parfois syncopale … irradie rapi<strong>de</strong>ment vers la racine du<br />
membre et précè<strong>de</strong> les autres symptômes inflammatoires. D’abord<br />
probablement d’origine mécanique (injection du venin visqueux<br />
sous pression et en profon<strong>de</strong>ur), sa persistance est ensuite liée aux<br />
mécanismes complexes <strong>de</strong> l’inflammation, notamment à la présence<br />
<strong>de</strong> bradykinine. » ; Larréché et al. 2010a : 74-87 (84, 5.2.2 :<br />
« La douleur serait particulièrement importante en cas <strong>de</strong> morsure<br />
<strong>de</strong> Cerastes »).<br />
ANTHROPOZOOLOGICA • 2012 • 47. 1. 85