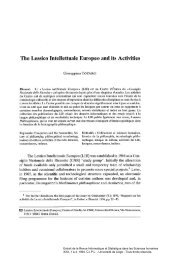Texte complet - Université de Liège
Texte complet - Université de Liège
Texte complet - Université de Liège
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Introduction au système <strong>de</strong> nomination <strong>de</strong>s serpents en grec ancien<br />
spécialistes <strong>de</strong>s bêtes venimeuses (thēriakoi),<br />
Philouménos (De ven. anim., 19, 1-2 [Wellmann<br />
1908a : 26, l. 4-13]) est contraint <strong>de</strong> se<br />
contenter <strong>de</strong> transcrire <strong>de</strong>s remè<strong>de</strong>s, ceux préconisés<br />
par Apollonios, mé<strong>de</strong>cin alexandrin<br />
du tournant <strong>de</strong> l’ère commune (Irby-Massie<br />
2008), dans ses Remè<strong>de</strong>s simples. Ils ont <strong>de</strong>s<br />
similitu<strong>de</strong>s avec les ordonnances <strong>de</strong> Dioscori<strong>de</strong>.<br />
L’unique <strong>de</strong>scription conservée, sans détail<br />
sur la distribution géographique, provient<br />
du pseudo-Aélius Promotus 291 : « Les serpents<br />
(opheis) 292 prēstēres sont longs d’une coudée,<br />
ont une couleur roussâtre (hupopurron),<br />
légèrement mêlée <strong>de</strong> noir, la tête tranquillement<br />
dressée ; il se meut rapi<strong>de</strong>ment 293 . À ceux<br />
qui ont été mordus par ce serpent adviennent<br />
dilatation (eparsis) <strong>de</strong> l’endroit touché 294 , douleur<br />
puissante (odunē sphodra) comme celle<br />
d’un feu, ampoules (phluktainai), effusions<br />
<strong>de</strong> flui<strong>de</strong>s (ichōres). Ils survivent (parateinousin,<br />
littéralement « poursuivent ») 295 pendant<br />
cinq jours au maximum. » Des remè<strong>de</strong>s partiellement<br />
analogues à ceux recommandés par<br />
Dioscori<strong>de</strong> (voir ci-<strong>de</strong>ssus) et i<strong>de</strong>ntiques à ceux<br />
291. [Aélius Promotus], De ven. anim., 18 (Ihm 1995 : 54, l. 29-<br />
55, l. 4 ; 98, § 18).<br />
292. Comparer ci-<strong>de</strong>ssus, 4.1.1.2, ad n. 255 (Philouménos : ophis<br />
kausōn) ; n. 256.<br />
293. Sur la position <strong>de</strong> la tête, voir ci-<strong>de</strong>ssus, 3.3.1.2 (Philouménos<br />
[a] ad n. 200). Si la <strong>de</strong>rnière indication se rapporte à la locomotion<br />
et non à la détente au moment <strong>de</strong> la frappe (cf. ci-<strong>de</strong>ssus, ibi<strong>de</strong>m),<br />
elle n’est pas incompatible avec celle <strong>de</strong> la scholie à Nic., Ther.,<br />
343-354 (Crugnola 1971 : 149, l. 8-9) qui parle, elle, <strong>de</strong> la lenteur<br />
<strong>de</strong> la dipsas (voir ci-<strong>de</strong>ssus, 2.1.3.2.1 : Locomotion). Le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
reptation usuel <strong>de</strong>s différentes espèces <strong>de</strong> serpents (chez celles <strong>de</strong>s<br />
déserts <strong>de</strong> sable : le déroulement latéral) et donc leur vitesse se<br />
modifient en fonction du substrat sur lequel elles se déplacent.<br />
Cf. Gasc 1994 : 64 (« La poussée en dérapage … mo<strong>de</strong> … très<br />
coûteux en énergie … peu d’efficacité »), 65-67 (« Le déroulement<br />
latéral »).<br />
294. Voir ci-<strong>de</strong>ssus, 2.1.3.2.2, ad n. 100 : oidēma, phlegmonē.<br />
295. Cf. Philouménos, De ven. anim., 18, 2 (Wellmann 1908a :<br />
25, l. 16-17), à propos <strong>de</strong>s victimes du kerastēs (« cornu ») : « Le plus<br />
généralement, ceux qui ont été frappés survivent (parateinousin)<br />
jusqu’à neuf jours. » ; Aétios d’Amida, Libri med., XIII,<br />
28 (Cornarius 1549 : 774) : « supersunt ». Comparer [Aélius<br />
Promotus], De ven. anim., 19 (Ihm 1995 : 55, l. 10) : ceux qui<br />
ont été mordus par un serpent akontitēs « continuent (diateinousi)<br />
[à vivre] neuf jours au maximum. »<br />
d’Apollonios-Philouménos sont énumérés, soit<br />
que, cette fois encore (cf. 3.3.1.2), l’auteur ait<br />
suivi le texte <strong>de</strong> Philouménos ou qu’il ait disposé<br />
<strong>de</strong>s mêmes sources que lui.<br />
À côté <strong>de</strong> ces attestations où, tantôt <strong>de</strong> manière<br />
explicite (Lucain), tantôt par déduction plausible<br />
(Pline l’Ancien et les trois écrivains grecs),<br />
prēstēr est une vipère afro-égyptienne, l’ophionyme<br />
fait partie <strong>de</strong>s synonymes <strong>de</strong> dipsas,<br />
quand l’« assoiffante » en est une (voir ci-après,<br />
p. 124, tableau 6) dans la littérature médicale 296<br />
et générale 297 (voir aussi ci-<strong>de</strong>ssous, 4.4).<br />
Élien, qui est le premier à transmettre l’ophionyme<br />
prēstēr dans la série <strong>de</strong>s synonymes <strong>de</strong><br />
dipsas, accor<strong>de</strong>, <strong>de</strong> plus, un court chapitre à un<br />
autre prēstēr (Le propre <strong>de</strong>s animaux, XVII, 4).<br />
Sauf la précision qu’il est un serpent 298 , il n’y est<br />
question que <strong>de</strong> symptômes <strong>de</strong> l’envenimation.<br />
Ils évoluent en trois temps : d’abord torpeur et<br />
prostration, puis faiblesse et asphyxie, perte <strong>de</strong><br />
conscience, rétention d’urine, chute <strong>de</strong> la pilosité,<br />
enfin suffocation et convulsions, agonie<br />
très douloureuse.<br />
4.3.2. Interprétations et traductions mo<strong>de</strong>rnes<br />
4.3.2.1. Avant Linné<br />
Mattioli (1554 : 181, l. 3, De mat. med., II,<br />
30 [= 31]) : traduction latine du chapitre avec<br />
296. [Diosc.], De iis, quae virus, 13 (Sprengel, II, 1830 : 71,<br />
l. 13) ; Paul d’Égine, Epit. med., V, 16, 2 (Heiberg, II, 1924 :<br />
19, l. 5, avec, p. 18, l. 19, le synonyme en tête dans le titre où les<br />
<strong>de</strong>ux ophionymes sont coordonnés par la conjonction disjonctive<br />
renforcée ētoi ; cf. Kühner & Gerth, II, 1898 : 298, § 538, 5 ;<br />
encore en évi<strong>de</strong>nce, coordonné au second synonyme kausōn [voir<br />
ci-<strong>de</strong>ssus, 4.1.1.2, n. 257], comme attribut <strong>de</strong> dipsas dans le<br />
texte) ; cf. ci-<strong>de</strong>ssus, 2.1.3.2.2, tableau 2 ; ci-après, tableau 6.<br />
Comparer Epit. med., VII, 3, 19 (Heiberg, II, 1924 : 265, l. 5) :<br />
remè<strong>de</strong> similaire pour ceux qui ont été mordus « par prēstēr ou par<br />
echidna », « enfleur-enflammeur », un <strong>de</strong>s noms toxicologiques<br />
<strong>de</strong> vipères non grecques, et « vipère » grecque commune, sous<br />
son nom zoologique (voir ci-<strong>de</strong>ssus, 1.2.2.1, Encadré : B.a), tous<br />
<strong>de</strong>ux épicènes.<br />
297. Élien, Le propre <strong>de</strong>s animaux, VI, 51 ; Souda, D 1306 (Adler,<br />
II, 1931 : 122, l. 20-21) ; [Zonaras], Lexicon, D, s. v. « Dipsas »<br />
(Tittmann, I, 1808 : 522, l. 17) ; cf. ci-<strong>de</strong>ssus, 2.1.3.2.2, tableau<br />
2 ; ci-après, tableau 6.<br />
298. Comparer ci-<strong>de</strong>ssus, 4.1.1.2 (Philouménos) ; 4.3.1.2 (Dioscori<strong>de</strong><br />
ad n. 284 ; [Aélius Promotus] ad n. 291).<br />
ANTHROPOZOOLOGICA • 2012 • 47. 1. 123