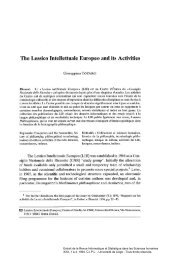Texte complet - Université de Liège
Texte complet - Université de Liège
Texte complet - Université de Liège
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Introduction au système <strong>de</strong> nomination <strong>de</strong>s serpents en grec ancien<br />
Fig. 3b.– Cerastes cerastes (Linné, 1758), Vipère à cornes ou Céraste. Sans cornes.<br />
Désert du Negev (Israël), avril 1994.<br />
Cliché et © Andréas Meyer. Avec l’aimable autorisation <strong>de</strong> l’auteur.<br />
meridionalis Boulenger, 1903, la Vipère ammodyte<br />
ou Vipère <strong>de</strong>s sables (Fig. 1) 142 , toujours<br />
la plus commune <strong>de</strong>s cinq espèces <strong>de</strong> Viperidae<br />
helléniques continentaux et insulaires 143 . Les<br />
cf. Krauskopf 1988 : 313, n° 312, détail <strong>de</strong> droite ; au bord <strong>de</strong><br />
l’égi<strong>de</strong> d’Athéna, sur la statue monumentale <strong>de</strong> bronze (milieu<br />
du iv e siècle) du Musée archéologique du Pirée (Inv. n° 4646),<br />
cf. Demargne 1984 : 980-981, n° 254 ; Bodson 1990b : 59-60.<br />
— Voir ci-<strong>de</strong>ssous, 3.3.1.2, n. 198, les indices zoogéographiques<br />
qui i<strong>de</strong>ntifient le kenchrinēs <strong>de</strong> Nicandre.<br />
142. Références ci-<strong>de</strong>ssus, 2.3.1, n. 134.<br />
143. Sur Macrovipera schweizeri : voir ci-<strong>de</strong>ssous, 4.3.3.2.3, n. 318 ;<br />
Montivipera xanthina : voir ci-<strong>de</strong>ssous, 3.3.1.2, n. 198 ; 4.3.3.2.3,<br />
n. 319 ; Vipera berus, voir ci-<strong>de</strong>ssous, 2.3.2.2.1, n. 155 ; sur Vipera<br />
‘ursinii’ graeca Nilson & Andrén, 1988, la Vipère d’Orsini, la<br />
plus petite <strong>de</strong>s vipères européennes, limitée en Grèce à quelques<br />
stations montagneuses d’Épire et <strong>de</strong> Macédoine, cf. Bruno &<br />
Maugeri 1990 : 212-216 (ill.) ; Gruber 1992 : 217-220 (ill.) ;<br />
David & Ineich 1999 : 341-343 ; Arnold & Oven<strong>de</strong>n 2002 :<br />
228-229, 285 (carte 185) et pl. 48, 1 ; Mallow et al. 2003 : 274-<br />
276 et pl. 14, 17-18 ; Dely & Joger 2005 : 375-382, 391-393,<br />
396-397 ; Herpetomania 2006, s. v. « Vipera ursinii » : trois clichés<br />
par D. Jablonski & R. Šmejkal ; Valachos et al. 2008 : 414-417 et<br />
fig. 407-410 ; Phelps 2010 : 503-508 et fig. 533-541, carte n° 97 ;<br />
(20/09/2010).<br />
Grecs l’appelaient « zoologiquement » echidna,<br />
echis « vipère » 144 dans l’acception « spécifique »<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux substantifs (voir ci-<strong>de</strong>ssus, 1.2.2.1,<br />
Encadré : B.a), c’est-à-dire, suivant la première<br />
étymologie que les grammairiens anciens en<br />
donnent par référence à son mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> reproduction<br />
145 : « celle qui retient ses jeunes [pendant<br />
la gestation] » 146 . De même que près <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux-<br />
144. Voir ci-<strong>de</strong>ssus, 1.2.2.1, Encadré : B (a). L’usage se perpétue<br />
en grec mo<strong>de</strong>rne (cf., par exemple, Valachos et al. 2008 : 406) :<br />
ochia (ojciav, dérivé <strong>de</strong> echis) « ‘la’ vipère ».<br />
145. Cf. Aristote, HA, I, 6, 490b25 (echidna) ; III, 1, 511a16 (echis<br />
épicène) ; V, 34, 558a25-31 (echis épicène) ; GA, II, 1, 732b21 (echeis<br />
épicène) ; Nicandre, Ther., 135 ; schol. a ad 135 (Crugnola 1971 :<br />
82, l. 19-21) ; comparer Hérodote, III, 108, 1 ; 109.<br />
146. EG, s. v. « echis » (De Stefani 1909 : 575, l. 1-3), citant l’article<br />
du grammairien Seleucos (i er siècle EC ; cf. Reitzenstein 1897 : 159,<br />
n° 16), lequel est repris textuellement, à un mot près et sans le nom<br />
du grammairien, dans Eklogai, s. v. « echis » (Cramer, II, 1835 :<br />
433, l. 24-26) ; Souda, E 4007 (Adler, II, 1931 : 494, l. 25-28) ;<br />
EM, 404, l. 28-29, 36-38 (Gaisford 1848). Valeur épicène (voir<br />
ci-<strong>de</strong>ssus, 1.2.2.1) du lemme echis dans tous ces articles où<br />
l’argument étymologique est l ’ o v o v i v i p a r i t é . Étymologie<br />
mo<strong>de</strong>rne : incertaine ; voir, s. v. « echis », Chantraine 1999 : 392 ;<br />
Beekes 2010 : 489 ; cf. Sancassano 1996 : 63-67 ; 1997 : 165-<br />
ANTHROPOZOOLOGICA • 2012 • 47. 1. 95