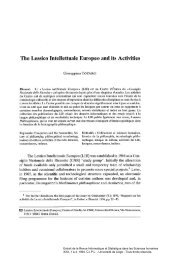Texte complet - Université de Liège
Texte complet - Université de Liège
Texte complet - Université de Liège
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Introduction au système <strong>de</strong> nomination <strong>de</strong>s serpents en grec ancien<br />
3.3.1.2. Ammodutēs ophionyme<br />
Les treize occurrences herpétologiques (fréquence<br />
absolue) <strong>de</strong> ammodutēs enregistrées<br />
dans le TLG 173 et, par emprunt au grec, les sept<br />
<strong>de</strong> (h)ammodytes (-dites) 174 <strong>de</strong> la littérature latine<br />
(TLL, I, 1900 : 1940, 21-25) concernent<br />
<strong>de</strong>s serpents occupant <strong>de</strong>s milieux où, selon<br />
l’exégèse antique, le sable offre la possibilité<br />
<strong>de</strong> « se cacher » 175 . L’une d’elles se rattache aux<br />
libues (« libyens ») <strong>de</strong> Ther., 490 176 . Ceux-ci figurent,<br />
en <strong>de</strong>uxième place, dans l’énumération<br />
<strong>de</strong>s serpents inoffensifs (car n’injectant pas <strong>de</strong><br />
venin) par laquelle Nicandre clôt rapi<strong>de</strong>ment le<br />
catalogue <strong>de</strong>s ophidiens, sans autre indication<br />
à leur sujet que leur biotope (488-489) i<strong>de</strong>ntique,<br />
mot pour mot, à celui qu’ont détaillé<br />
les vers 27-28 (cf. ci-<strong>de</strong>ssus, 2.1.3.1, n. 60).<br />
De même que les « élopes » (elopes), « attrapemuridés<br />
» (muagroi), « javelots » (akontiai),<br />
« molures » (molouroi), « aveugles » (tuphlopes)<br />
<strong>de</strong>s vers 490-492, les « libyens » vivent non sur<br />
un sol <strong>de</strong> sable, mais dans « la forêt (hulē), les<br />
bosquets, les fourrés et les combes », c’est-à-dire<br />
<strong>de</strong>s éléments du paysage grec. La scholie b au<br />
98-99 ; voir aussi Strömberg 1943 : 81) à l’Uranoscope ou Rascasse<br />
blanche Uranoscopus scaber Linné, 1758 (,<br />
26/08/2010) ; b) le processus<br />
d’« immersion » <strong>de</strong> l’une et <strong>de</strong> l’autre.<br />
173. Contrôle additionnel : (25/10/10). Voir ci-<strong>de</strong>ssous [p. 109], tableau 5.<br />
174. Polémius Silvius, Laterculus, 3 (Mommsen 1892 : 543,<br />
l. 34) : « hamodita » (dans une liste mêlant les noms <strong>de</strong> serpents<br />
européens et africains). Sur ces sept occurrences (fréquence<br />
absolue), outre Polémius Silvius, voir ci-après, n. 175 (Commenta<br />
Bernensia : lemme) ; n. 185 (Julius Valerius) ; Lucain ad<br />
n. 194 (Solin, Isidore <strong>de</strong> Séville : <strong>de</strong>ux fois).<br />
175. Cf. Commenta Bernensia ad Lucain, Pharsale, IX, 716<br />
(Usener 1869 : 309, l. 15) : « Ammodites : a latendo sub arena. »<br />
(« Ammodites : du fait qu’il se cache sous le sable. »).<br />
176. Cf. Épiphanios <strong>de</strong> Salamine, Pan., 62 (Contre les Sabelliens),<br />
8, 5 (Holl & Dummer, II, 1980 : 398, l. 5-6), d’après Nicandre :<br />
« libus ou molouros ou elops ou l’un <strong>de</strong>s reptiles les plus effrayants,<br />
mais incapables <strong>de</strong> faire du mal [au sens <strong>de</strong> « i n j e c t e r un<br />
venin »] par leurs morsures ». Voir Chippaux 1995 : 224 : « Toute<br />
morsure <strong>de</strong> serpent, même en l’absence d’envenimation, requiert<br />
<strong>de</strong>s soins. » ; sur les morsures <strong>de</strong> couleuvres, Larréché et al. 2010c.<br />
vers 490 177 commente : « Il appelle “libyens” les<br />
ammodutai ; <strong>de</strong>s pareils, en effet, il s’en trouve<br />
beaucoup en Libua. » La remarque ne jette aucune<br />
clarté sur ce que sont les libues grecs ou<br />
eurasiatiques auxquels songe Nicandre dans<br />
les Theriaka où il n’emploie pas l’ophionyme<br />
ammodutēs 178 . Elle confirme, en revanche, que<br />
les « immergeurs-du-sable » étaient connus<br />
comme typiques <strong>de</strong> la Libua. De fait, les autres<br />
mentions d’ammodutai désignent <strong>de</strong>s serpents<br />
qui habitent les uns <strong>de</strong>s déserts africains, les<br />
autres <strong>de</strong>s déserts asiatiques et sont, eux, tous<br />
venimeux.<br />
Des ammodutai sont signalés par Strabon<br />
(XVII, 1, 21 [C. 803]) dans le désert entre<br />
Péluse et le fond du golfe <strong>de</strong> la Cité-<strong>de</strong>s-Héros<br />
179 (aujourd’hui, golfe <strong>de</strong> Suez), en quantité<br />
telle que la zone, écrit le géographe, plus encore<br />
que le reste <strong>de</strong> l’Arabia 180 , est infranchissable<br />
pour les armées 181 .<br />
177. Crugnola 1971 : 196, l. 17-18. Eutecnios, Paraphrasis 483-<br />
492 (Papathomopoulos 1976 : 28, l. 6 ; Gualandri 1968 : 46,<br />
l. 12) : « libues » sans plus. Illustrations du serpent légendé<br />
libuos (sic) dans les manuscrits <strong>de</strong> la Paraphrasis : Dioscuri<strong>de</strong>s<br />
Vindobonensis graecus 1 (premières années du vi e siècle, avant 512),<br />
f o 411 r , n° 18 (fac-similé 1970 ; cf. Kádár 1978 : pl. 25, 18,<br />
noir et blanc) ; dans ses dérivés New York M. 652 (x e siècle),<br />
f o 353 v ; Vat. Chis. 53 (F. VII. 159 ; xv e siècle), f o 226 v , n° 4 ;<br />
Bol. B. U. gr. 3632 (xvi e siècle), f o 385 v (cf. Kádár 1978 : pl. 39,<br />
1 ; 49, 23 ; 58 [noir et blanc]).<br />
178. Hésychios, L 945 (Latte, II, 1966 : 595) : « Libues : certains<br />
<strong>de</strong>s serpents sont appelés ainsi. » ; L 947 (Latte, II, 1966 : 595) :<br />
« Bête libyque : puisqu’il y a là <strong>de</strong>s reptiles mortels. ». Quoi qu’en<br />
ait pensé Jacques (2002 : 145, n. 51, 2), le scholiaste n’explicite<br />
pas l’emploi que fait Nicandre du terme « libues », il procè<strong>de</strong> par<br />
enchaînement d’idées ; voir ci-<strong>de</strong>ssous, 3.3.3.1, n. 212. Pour un<br />
cas analogue, voir scholie a Nicandre, Ther., 817 (Crugnola 1971 :<br />
288, l. 15-289, l. 5) : chalkis « lézard » (cf. Bodson 2009 : 114-<br />
117, 175-179).<br />
179. Sur la localisation <strong>de</strong> la Cité-<strong>de</strong>s-Héros (Hērōōnpolis) par<br />
Strabon, voir Yoyotte & Charvet 1997 : 116, n. 244 ; 284, carte V.<br />
180. La zone désertique orientale, que les Égyptiens et Strabon<br />
qui suit leur usage nomment Arabia, inclut le pays entre le Nil et<br />
le Golfe arabique (mo<strong>de</strong>rne : Mer rouge) y compris le Nord du<br />
Sinaï. Cette région est la voie stratégique <strong>de</strong> communication vers<br />
l’Est, en particulier celle du commerce avec les Arabes nabatéens.<br />
Voir Yoyotte & Charvet 1997 : 39 ; 116, n. 242-243 ; 117 : photo<br />
du tell <strong>de</strong> Péluse.<br />
181. Le traducteur ([Yoyotte &] Charvet 1997 : 117) n’entend<br />
pas ammodutai comme l’ophionyme qu’il est, en apposition<br />
‘spécificative’ (voir ci-<strong>de</strong>ssus, 2.1.3.1, n. 56 : Kühner & Gerth) du<br />
génitif herpetōn (« reptiles » au sens <strong>de</strong> « serpents » : voir ci-<strong>de</strong>ssus,<br />
ANTHROPOZOOLOGICA • 2012 • 47. 1. 105