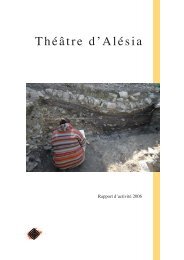Montrond-les-Bains (Loire), Le Château L ... - Archeodunum SA
Montrond-les-Bains (Loire), Le Château L ... - Archeodunum SA
Montrond-les-Bains (Loire), Le Château L ... - Archeodunum SA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Montrond</strong>-<strong>les</strong>-<strong>Bains</strong> (F-42) – <strong>Le</strong> Château5. Conclusion91Il aurait ainsi été assez simpledans ce cas précis, au moment dela découverte des bâtiments accolésaux courtines et en fonction de leurétat de conservation, de redéfinir leprojet d’aménagement et de repousserla rampe à créer pour accéder à latour-porte en avant de la façade desbâtiments utilitaires. Cette optionaurait permis tout à la fois de réaliserl’aménagement, de conserver<strong>les</strong> vestiges, de <strong>les</strong> donner à voir etde restituer le dispositif architecturalréellement mis en œuvre dans lechâteau au moment de la constructionde ces bâtiments.L’étude archéologique préventive mise œuvre au début de l’année 2007 a permisd’éclairer d’un jour nouveau la basse cour et l’enceinte extérieure du château de<strong>Montrond</strong>. Si <strong>les</strong> résultats restent partiels et limités à l’emprise des travaux d’aménagementdu site, ils ont mis en évidence la construction de l’enceinte basse, dont<strong>les</strong> dispositifs sont partiellement conservés en élévation, dans le courant du XIV esiècle et <strong>les</strong> multip<strong>les</strong> remaniements apportés à l’édifice. Si la présence de bâtimentsappuyés sur <strong>les</strong> courtines était envisageable, la fouille a permis de <strong>les</strong> caractériser enpartie et d’envisager la chronologie de leur construction à la fin du Moyen Âge et àl’Époque moderne.Néanmoins, nous ne pourrons que regretter l’absence de prise en compte desvestiges enfouis dans le projet d’aménagement. Il est regrettable que <strong>les</strong> bâtimentsmis au jour aient été purement et simplement démolis pour permettre la réalisationdes travaux, là où il aurait été possible d’envisager une mise en valeur des vestiges,leur conservation in situ et la restitution des solutions architectura<strong>les</strong> réellementmises en œuvre sur le site par ses bâtisseurs 91 . Qu’un ensemble architectural tel quele château de <strong>Montrond</strong>, propriété d’une commune, site inscrit à l’Inventaire supplémentairedes Monuments historiques, lieu de manifestations culturel<strong>les</strong> ouvert à lavisite du public, n’ait pu donner lieu à une adaptation des travaux projetés aux résultatsde l’étude archéologique nous semble assez symptomatique des progrès encore àaccomplir dans l’articulation des études scientifiques, des restaurations et de la miseen valeur des sites patrimoniaux. Il faut aujourd’hui se réjouir de la prise en comptedans <strong>les</strong> aménagements et restaurations engagés sur le site d’une approche archéologiquequi, si elle reste limitée par des interventions courtes et ciblées dans l’espace,permet de renouveler la connaissance du château. Tout monument, du plus humbleau plus ostentatoire, sans analyse et interprétation des vestiges, resterait un simpleassemblage hétérogène de maçonneries certes impressionnantes et évocatrices, maisincomprises et engoncées dans une vision « romantique » de la ruine. Dans ce domaine,il nous reste à progresser dans l’articulation des contraintes et des apports respectifsdes études scientifiques et des restaurations et travaux de mise en valeur. Sans laprise en compte dès la définition du projet d’aménagement des apports des différentsintervenants, il est à craindre que <strong>les</strong> monuments de notre patrimoine architectural nerestent que des coquil<strong>les</strong> vides de sens ou de simp<strong>les</strong> décors pittoresques.L’archéologie préventive peut certes prétendre sauvegarder <strong>les</strong> informationsavant leur destruction irrémédiable. Mais elle ne peut seule garantir la restitutionet la diffusion de ses apports à la collectivité, en particulier lorsque <strong>les</strong> questionnementsscientifiques et, par conséquent, <strong>les</strong> résultats sont strictement limités dansl’espace à une emprise de travaux par définition arbitraire. Que la notion d’emprisede travaux soit une stricte limite posée comme préalable aux chantiers de constructiontraditionnels, routiers ou immobiliers, est compréhensible. Dans le cadre d’unsite protégé au titre du patrimoine architectural, elle devrait néanmoins pouvoir êtreadaptée à la nature même du site et prendre en compte ses caractères intrinsèquespour conserver <strong>les</strong> vestiges et <strong>les</strong> considérer comme une véritable plus-value tant surle plan de la mise en valeur et de la présentation au public que sur le plan scientifique.Gageons que la prise de conscience, au cours de l’intervention ou à son issue,de ces éléments par <strong>les</strong> différents intervenants –aménageurs, architectes, institutions,archéologues– permettra à l’avenir de réunir dans une perspective commune desinstitutions dont <strong>les</strong> attributions et <strong>les</strong> préoccupations respectives restent encore fortementcloisonnées.74