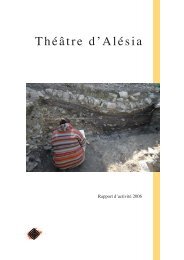<strong>Montrond</strong>-<strong>les</strong>-<strong>Bains</strong> (F-42) – <strong>Le</strong> Château103<strong>Le</strong>s dessins sont à l’échelle1/3 e , conformément aux normes envigueur.104Guyot (S.), La céramique médiévaleen Basse Auvergne, Thèse dedoctorat de l’E. H. E. S. S., 2004,vol. I, pp. 64‐106.105Guyot (S.), Etude du mobiliercéramique recueilli sur le site deChangy (<strong>Loire</strong>), D. F. S. de fouillepréventive, I. N. R. A. P., Arbois,2004, 39 p.106Arlaud (C.) et alii, Lyon, <strong>les</strong>dessous de la presqu’île, Bourse-République-Cé<strong>les</strong>tins-Terreaux,2000, Lyon, p. 172.107Goy (M.) et alii, <strong>Le</strong>s sitesmédiévaux de la Petite Perche.Route Nationale 7. Trévol « LaPetite Perche» (03 290 034 AH)(Allier), D. F. S. dactylographié,Clermont‐Ferrand, 1999‐2000,66 p., +pl.108Goy (C.) Cantrelle (S.) Humbert(S.) et Munier (C.), Besançon(Doubs). Lycée professionnelCondé, t. II, Epoques médiévaleet moderne, D. A. F. , 2000,pp. 121‐158, +pl.Etude morpho‐typologique 103La description et l’analyse de la céramique cataloguée reprennent le vocabulaire etla hiérarchisation établis lors de notre doctorat 104 .• Poterie 1 : vase fermé, marmiteLa Poterie 1 n’est représentée que par un individu composé de sept tessons. Tous ontété découverts dans la couche 2010.Il possède une lèvre arrondie, un reborden petit bourrelet externe relativement plat(diam. ouv. : 155 mm) et un col évasé. Lajonction du rebord et du col est marquée par une petite gorge et un renflement en faceinterne, alors que le col comporte un renflement externe au point le plus convexe. Lapartie inférieure du pot n’a pas été découverte.L’argile employée comprend du quartz et des paillettes de mica en petite quantité.En ce qui concerne la cuisson, trois étapes ont été observées. La cuisson s’avèreoxydante mais durant la post‐cuisson, le potier semble avoir sous‐estimé son tempspuisque celle‐ci est marquée par une période de réduction relativement conséquente,puis par une nouvelle cuisson a priori très énergique. Cette particularité jamais rencontréeà ce jour est trahie par une âme rose, puis de part et d’autre grise, puis encorede part et d’autre rose‐rougeâtre.<strong>Le</strong>s comparaisons montrent à l’instar de plusieurs autres céramiques décrites icicertaines analogies morphologiques mais pas complètes. Des distinctions sont ainsirelevées au niveau du rebord et du col, signes que la concordance des aires de diffusionmais plus particulièrement celle de la chronologie s’avère insuffisante. Néanmoins,plusieurs céramiques découvertes en 2004 à Changy (<strong>Loire</strong>) sont proches mais pastotalement identiques 105 . Cel<strong>les</strong>‐ci ont été datées des XIII e ‐XIV e sièc<strong>les</strong>, en privilégiantce dernier. En revanche, l’étude engagée sur ce même site avait permis de déceler desparallè<strong>les</strong> s’orientant vers la fin du XIV e siècle et plus particulièrement au cours duXV e siècle, voire comme c’est le cas à Lyon jusqu’au XVI e siècle 106 . Toutefois, cesmarmites en l’occurrence sont souvent associées dans ce dernier lieu à une anse coudéece qui n’est pas le cas des individus étudiés. Dans l’Allier, sur la commune de Trévol,une forme très proche est signalée dans des contextes datés à partir du XII e siècle maisprincipalement axés vers <strong>les</strong> XIII e ‐XIV e sièc<strong>les</strong> 107 . Enfin, une forme identique est observéeà Besançon (Doubs), dans des niveaux du XV e siècle 108 .• Poterie 2 : forme fermée, marmiteQuatre individus constituent le groupe technique de la Poterie 2. Ils ont été mis aujour dans <strong>les</strong> unités stratigraphiques 2011, 2012, 2030 (2 I. V.), 2067 et 2084.Ces récipients possèdent une lèvre arrondie et un rebord en collerette externe évasée(diam. ouv. : de 140 à 225 mm). <strong>Le</strong> col n’est pas considéré pour cette forme. La partiesupérieure de la panse est à profil globulaire ou ovoïde à extremum haut. En ce quiconcerne la base de la panse et le fond, ceux‐ci n’ont pas été retrouvés. Néanmoins, ceprofil adopte fréquemment un fond convexe pour <strong>les</strong> plus anciens ou plats pour <strong>les</strong> plusrécents. Deux parties supérieures d’anse sont visib<strong>les</strong> sur <strong>les</strong> poteries (3) et (6). La premièreest attachée à la lèvre et une partie du rebord interne, tandis que sur la seconde, elleprend place au sommet de l’épaule. Il faut également préciser que deux anses diamétralementopposées peuvent être envisagées pour cette forme. Enfin, il faut toutefois noterque cette dernière, la céramique (6), diffère quelque peu des autres individus.Du point de vue technique, <strong>les</strong> pâtes sont globalement homogènes. Cinq comprennentdu quartz et des paillettes de mica et deux des particu<strong>les</strong> ferriques. Enrevanche, la distinction est plus nette pour ce qui est des cuissons. <strong>Le</strong>s individus (3),(9) et (10) ont subi une cuisson et une post‐cuisson réductrices alors que <strong>les</strong> troisautres ont été cuites en mode oxydant.84
6. Étude du mobilier céramique<strong>Le</strong>s parois des récipients sont enduites d’une fine couche d’engobe, apposée lorsdu façonnage. Seul l’individu (24) possède une décoration externe. Il s’agit d’unebande rapportée de section plate, où des empreintes digita<strong>les</strong> ont été poinçonnéesdans l’argile encore molle. Cette applique a été collée sur la paroi à l’aide d’une finepellicule de barbotine.Ces récipients sont peu rencontrés dans le lyonnais 109 , la vallée du Rhôneou plus à l’Est. En revanche, on <strong>les</strong> retrouve dans le Roannais 110 et abondammentdans la moitié nord de toute la Basse Auvergne et le Bourbonnais 111 . Pources deux dernières entités, el<strong>les</strong> sont observées dans des contextes essentiellementdes XIII e ‐XIV e sièc<strong>les</strong>, avec une persistance pour le Puy‐de‐Dôme jusqu’auXIX e siècle – surnommée « oreille de cochon ». Seul un site situé à quelques kilomètresdu département de la <strong>Loire</strong> envisage une chronologie carolingienne – deux14C : 900‐973 et 830‐940 ap. J.‐C. Il s’agit de deux fours de potiers fouillés sur lacommune de Droiturier (Allier). Ces récipients ne correspondent cependant pasà ceux qui sont étudiés ici. Dans le Val de <strong>Loire</strong>, ce profil est répertorié dans descontextes similaires en privilégiant toutefois le XIV e siècle – Changy, Montbrison,Pacaudière pour ne citer qu’eux 112 . En revanche, le soin apporté aux faces externescomme internes déroge quelques peu à ces individus assez précoces. Une chronologieplus tardive, axée de préférence vers le XV e siècle, ou tout du moins dans laseconde moitié du XIV e siècle, reste privilégiée. En revanche, la persistance desformes en milieux ruraux n’est pas à écarter, même si cet aspect reste difficile àmesurer dans l’état actuel des connaissances.• Poterie 3 : forme ferméeLa Poterie 3, découverte dans l’us 2038, est unique dans le lot.Elle possède une lèvre arrondie, unrebord en bourrelet (diam. ouv. : 160 mm)externe et <strong>les</strong> prémisses d’un col évasé.La gorge externe du rebord n’est pas notable, mais une certaine parenté peut êtreenvisagée avec <strong>les</strong> derniers rebords en bandeau. La partie inférieure du récipient n’apas été découverte lors des excavations.Comme la majeure partie des autres récipients catalogués ici, ce vase possèdeune faible quantité de paillettes de mica. <strong>Le</strong> quartz est en revanche plus abondantdans l’âme de la paroi.109Faure‐Boucharlat (E.) et alii,Pots et potiers en Rhône‐Alpes, Epoquemédiévale, Epoque moderne,(D. A. R. A.), Lyon, 1996, 315 p. ; <strong>les</strong>individus décelés appartiennent auxXII e ‐XIII e sièc<strong>les</strong> ce qui ne concordepas avec nos contextes.110Guyot (S.), Etude du mobiliercéramique recueilli sur le site deChangy (<strong>Loire</strong>), D. F. S. de fouillepréventive, I. N. R. A. P., Arbois,2004, 39 p. ; Remy (A.‐C.) et alii,Déviation de la R. N. 7. La Pacaudièreet Changy (<strong>Loire</strong>), D. F. S. d’évaluationarchéologique, I. N. R. A. P.,Lyon, 2002, 202 p.111Guyot (S.), La céramique médiévaleen Basse Auvergne, Thèse dedoctorat de l’E. H. E. S. S., 2004,vol. I, 713 p.112Bocquet (S.) et alii, Mont-brison(42), « Rue Chenevotterie», D. F. S.de fouille préventive, I. N. R. A. P.,Lyon, 2003, 81 p. ; Guyot (S.), Etudedu mobilier céramique recueilli surle site de Changy (<strong>Loire</strong>), D. F. S.de fouille préventive, I. N. R. A. P.,Arbois, 2004, 39 p. ; Remy (A.‐C.) etalii, Déviation de la R. N. 7. La Pacaudièreet Changy (<strong>Loire</strong>), D. F. S. d’évaluationarchéologique, I. N. R. A. P.,Lyon, 2002, 202 p.85
- Page 1:
Montrond-les-Bains (Loire), Le Châ
- Page 4 and 5:
SommaireSommaire ..................
- Page 7 and 8:
Section I :L’operation archéolog
- Page 9 and 10:
Responsable scientifique de l’op
- Page 12 and 13:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 14 and 15:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 16 and 17:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 18:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 21 and 22:
Cahier des charges de la fouille pr
- Page 24:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 28 and 29:
Projet scientifique et techniqued
- Page 30 and 31:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 32 and 33:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 34: Arrêté d’autorisation de fouill
- Page 38 and 39: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 40 and 41: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 42 and 43: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 44 and 45: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 46 and 47: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 49 and 50: 2. La tour-porte et la courtine de
- Page 51 and 52: 2. La tour-porte et la courtine de
- Page 53 and 54: 2. La tour-porte et la courtine de
- Page 55 and 56: 2. La tour-porte et la courtine de
- Page 57 and 58: 2. La tour-porte et la courtine de
- Page 59 and 60: 2. La tour-porte et la courtine de
- Page 61 and 62: 3. La basse cour : circulations et
- Page 63 and 64: 3. La basse cour : circulations et
- Page 65 and 66: 3. La basse cour : circulations et
- Page 67 and 68: 3. La basse cour : circulations et
- Page 69 and 70: 3. La basse cour : circulations et
- Page 71 and 72: 4. SynthèseAu terme de cette étud
- Page 73 and 74: 4. Synthèsecatum. Ce type de const
- Page 76 and 77: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 78 and 79: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 80 and 81: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 82 and 83: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 86 and 87: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 88 and 89: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 90 and 91: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 92 and 93: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 94 and 95: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 96 and 97: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 98 and 99: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 101 and 102: Montrond-les-Bains (Loire), Le Châ
- Page 103 and 104: Liste des figures , planches et ann
- Page 105 and 106: Fig. 41 : Vue de l’intérieur de
- Page 107: Fig. 89 : Sondage 4, détail de l
- Page 111: 352.55355.40355.83356.64356.04356.2
- Page 115: SD 1999-1Mur 18Mur 19Mur 20SD 1999-
- Page 119: MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 122 and 123: MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 124 and 125: MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 126 and 127: MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 128 and 129: MONTROND-LES-BAINS (Loire), châtea
- Page 130: MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 134:
MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 137 and 138:
MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 140:
MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 143 and 144:
MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 145:
MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 149:
MONTROND-LES-BAINS (Loire), le Châ
- Page 152 and 153:
MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 155:
MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 158 and 159:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 160 and 161:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 162 and 163:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 164 and 165:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 166 and 167:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 168 and 169:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 170 and 171:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 172 and 173:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 174 and 175:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 176 and 177:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 178 and 179:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 180 and 181:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 182 and 183:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 184 and 185:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 186 and 187:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 188 and 189:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 190 and 191:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 192 and 193:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 194 and 195:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 196 and 197:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 198 and 199:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 200 and 201:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 202 and 203:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 204 and 205:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 206:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ