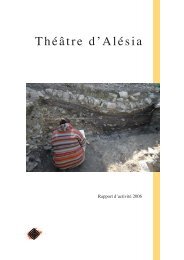<strong>Montrond</strong>-<strong>les</strong>-<strong>Bains</strong> (F-42) – <strong>Le</strong> ChâteauEn quelques chiffres…Nature de la pâteContrairement au matériel de nombreux de sites, celui étudié ici s’avère relativementhomogène du point de vue de la nature de pâte. La majeure partie des individus s’inscriten effet au sein d’un seul groupe technique : <strong>les</strong> pâtes mi‐fines (XX). La secondevariété se limite à seulement sept individus‐vases qui adoptent une pâte considéréecomme fine (X).Nature de la pâte I. V. Oxydante‐oxydante(en I. V.)Oxydante‐réductrice(en I. V.)Réductrice-oxydante(en I. V.)Réductrice‐réductrice(en I. V.)Fine (X) 7 (2,49 %) 7 (100 %) - - -mi‐fine (XX) 274 (97,51 %) 124 (45,26 %) 10 (3,65 %) 1 (0,36 %) 139 (50,73 %)mi‐grossière(XXX)- - - - -• <strong>Le</strong>s pâtes fines (X) : <strong>les</strong> pâtes concernent seulement 7 individus (soit 2,49 % dumatériel) sur l’ensemble du mobilier. Toutes ont subi une cuisson oxydante et unepost‐cuisson oxydante. <strong>Le</strong>s pâtes rosâtres sont relativement claires et dépourvues dedégraissants de taille importante. Quelques quartz et des oxydes ferriques sont observésdans <strong>les</strong> argi<strong>les</strong> mais en quantité limitée. <strong>Le</strong>s paillettes de mica sont en revancheabsentes. Parmi ces individus‐vases, deux variétés distinctes se côtoient, six moderneset une gallo‐romain. La première est identifiable par l’engobe recouvert par uneglaçure vert pomme alors que la seconde est enduite d’un engobe marron‐noir.97<strong>Le</strong>s oxydes varient de colorationen fonction de l’apport en oxygènedurant la cuisson et la post‐cuisson.Ainsi, une cuisson oxydanteengendrera une teinte rose à rougeâtre(ferrique) alors qu’une cuissonréductrice produira une couleurnoire (ferreux).• <strong>Le</strong>s pâtes mi‐fines (XX) : l’homogénéité de ce groupe technique est quelque peuatypique pour un mobilier provenant d’une fouille préventive. Certes, cette excavationest relativement limitée en surface mais le mobilier n’appartient pas qu’à uneseule période.<strong>Le</strong> matériel, qu’il soit médiéval ou moderne, est constitué majoritairementd’une pâte à cuisson et à post‐cuisson réductrice‐réductrice comme le prouve letableau ci‐dessus – nous y reviendrons. <strong>Le</strong>s argi<strong>les</strong> employées sont relativementfines, où <strong>les</strong> dégraissants et <strong>les</strong> impuretés prennent une place non négligeable.Ainsi, <strong>les</strong> cristaux de quartz sont <strong>les</strong> plus répandus puisqu’ils sont relevés au seinde 133 individus‐vases (soit 48,54 %). Ces nodu<strong>les</strong> sont d’une taille respectableatteignant parfois 1,5 mm de longueur. L’observation macroscopique a égalementpermis de repérer des arêtes sur ces cristaux, envisageant le broyage deblocs plus conséquents. Cette spécificité contribue en admettre un apport anthropiqueplutôt que naturel. <strong>Le</strong>s oxydes 97 sont également observés. Ils ne sontprésents qu’en quantité limitée. <strong>Le</strong>s oxydes ferriques observés dans <strong>les</strong> pâtesoxydantes sont remarqués dans 9 individus‐vases (soit 3,28 %) alors que <strong>les</strong> ferreux,visib<strong>les</strong> dans <strong>les</strong> autres pâtes à l’exception des oxydantes, sont au nombrede 8 (soit 2,92 %). Enfin, la présence des feldspaths est négligeable. Quant auximpuretés, seul le mica est considéré ici. <strong>Le</strong>s paillettes sont présentes en faiblenombre sur <strong>les</strong> parois mais également dans l’âme.Nature des cuissonsA l’issue des analyses, <strong>les</strong> quatre variétés de cuissons ont été observées. Deuxgroupes techniques se distinguent toutefois, <strong>les</strong> cuissons et <strong>les</strong> post‐cuissonsoxydantes‐oxydantes et <strong>les</strong> réductrices‐réductrices. El<strong>les</strong> représentent la majeurepartie du mobilier avec respectivement 124 individus‐vases (soit 45,26 % dumatériel) et 139 I. V. (soit 50,73 %). <strong>Le</strong>s deux autres groupes techniques se limitentà 10 I. V. (soit 3,65 %) pour <strong>les</strong> oxydants‐réducteurs et 1 I. V. (soit 0,36 %)pour le réducteur‐oxydant.78
6. Étude du mobilier céramique• Cuisson réductrice et post‐cuisson oxydante – mode A – : un seul individu‐vaseest pourvu d’une âme grise et des surfaces rosâtres. Il s’agit d’un petit tesson depanse en pâte mi‐fine. Du quartz et quelques paillettes de mica sont visib<strong>les</strong>.• Cuisson réductrice et post‐cuisson réductrice – mode B – : ce mode de cuissonest majoritaire dans cet ensemble, puisqu’il regroupe 139 individus‐vases, représentant50,73 % du matériel découvert. <strong>Le</strong>s cuissons et <strong>les</strong> post‐cuissons sont assezhomogènes. <strong>Le</strong>s colorations de l’argile cuite vont de gris à noir. La distinction entre<strong>les</strong> deux phases est parfois observée par un changement de teinte, mais celle‐ci selimite à quelques individus. Aucune sur‐cuisson n’est remarquée dans ce groupetechnique. Comme le prouve le tableau ci‐dessous, tous <strong>les</strong> individus cuits en modeB disposent d’une pâte mi‐fine.• Cuisson oxydante et post‐cuisson oxydante – mode C – : à l’instar du précédentgroupe technique, le mode B s’avère relativement abondant dans ce mobilier,puisqu’il représente 45,26 % du mobilier. D’ordinaire et pour une plagechronologique analogue, ce mode est fréquemment majoritaire ce qui n’est pasle cas ici. Quoi qu’il en soit, cette forme de cuisson est essentiellement représentéepar des individus‐vases dotés de pâtes mi‐fines, puisque seu<strong>les</strong> sept sontconsidérées comme fines.<strong>Le</strong>s colorations des argi<strong>les</strong> cuites sont de rose à brun. Aucune sur‐cuisson n’estobservée, ce qui n’est pas le cas de cuisson insuffisante, trahie par une teinte plutôtmarron. Notons en revanche, une seule pâte kaolinitique provenant d’un pichet décoré,découvert dans la couche 2157. Celui‐ci peut être daté de la fin du XIII e siècle.• Cuisson oxydante et post‐cuisson réductrice – mode D – : <strong>les</strong> cuissons oxydantes‐réductricess’avèrent globalement homogènes, même si <strong>les</strong> limites entre <strong>les</strong> cuissonset <strong>les</strong> post‐cuissons ne sont pas toujours franches. Pour la plupart d’entre‐el<strong>les</strong>cette distinction est bien délimitée, ce qui induit que le laboratoire a été fermé aprèsla phase de la cuisson. <strong>Le</strong> potier a ainsi fait redescendre la température dans le fouraprès avoir obstrué l’orifice de l’alandier.Ce groupe technique n’est pas courant dans le mobilier médiéval et moderne.Seule une quantité très limitée de fragments se remarque à chaque reprise. Quoi qu’ilen soit, <strong>les</strong> teintes des argi<strong>les</strong> ne se distinguent pas des autres modes. El<strong>les</strong> oscillentde rose à brun pour <strong>les</strong> cuissons et de gris à noir pour <strong>les</strong> post‐cuissons. Enfin, onnotera que tous <strong>les</strong> individus‐vases recensés ici possèdent une pâte mi‐fine.Revêtements : argile liquide, glaçure et émail 98L’examen des parois montre que <strong>les</strong> revêtements externes ou internes s’avèrent trèslimités. Seuls 65 individus‐vases (soit 23,13 % du matériel) en arborent, n’induisantpas exclusivement une rehausse esthétique ou une imperméabilisation des surfaces,souvent poreuses. Parmi ces I. V., 59 portent de la glaçure (soit 90,77 % des revêtements),5 de l’engobe (soit 7,69 %) et un seul de la faïence (soit 1,54 %).• Argile liquide – engobe ou barbotine – : l’argile liquide seule consacrée au revêtementdes récipients 99 est observée sur 5 individus‐vases (soit 1,78 %). Elle secirconscrit exclusivement en bribes de décorations plus importantes, apposées sur<strong>les</strong> panses de récipients exclusivement fermés. Cet engobe uniquement de couleurblanche est appliqué au pinceau. Si de nombreux exemp<strong>les</strong> sont observés dès leXIII e siècle, ces décors se développent durant la seconde moitié du XV e siècle,pour devenir courants à l’Epoque moderne. <strong>Le</strong>s motifs présentés ici se localisentà l’épaule de récipients oxydants, probablement des cruches. Il s’agit de bandeslinéaires vertica<strong>les</strong> ou obliques.98<strong>Le</strong>s dessins sont à l’échelle1/2 e , conformément aux normes envigueur.99Nous ne considérons pas la barbotineemployée pour le collage deséléments de préhension ou verseurcomme un revêtement, de mêmeque l’engobe fréquemment utilisé àla fin de façonnage d’un pot.79
- Page 1:
Montrond-les-Bains (Loire), Le Châ
- Page 4 and 5:
SommaireSommaire ..................
- Page 7 and 8:
Section I :L’operation archéolog
- Page 9 and 10:
Responsable scientifique de l’op
- Page 12 and 13:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 14 and 15:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 16 and 17:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 18:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 21 and 22:
Cahier des charges de la fouille pr
- Page 24:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 28 and 29: Projet scientifique et techniqued
- Page 30 and 31: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 32 and 33: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 34: Arrêté d’autorisation de fouill
- Page 38 and 39: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 40 and 41: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 42 and 43: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 44 and 45: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 46 and 47: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 49 and 50: 2. La tour-porte et la courtine de
- Page 51 and 52: 2. La tour-porte et la courtine de
- Page 53 and 54: 2. La tour-porte et la courtine de
- Page 55 and 56: 2. La tour-porte et la courtine de
- Page 57 and 58: 2. La tour-porte et la courtine de
- Page 59 and 60: 2. La tour-porte et la courtine de
- Page 61 and 62: 3. La basse cour : circulations et
- Page 63 and 64: 3. La basse cour : circulations et
- Page 65 and 66: 3. La basse cour : circulations et
- Page 67 and 68: 3. La basse cour : circulations et
- Page 69 and 70: 3. La basse cour : circulations et
- Page 71 and 72: 4. SynthèseAu terme de cette étud
- Page 73 and 74: 4. Synthèsecatum. Ce type de const
- Page 76 and 77: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 80 and 81: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 82 and 83: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 84 and 85: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 86 and 87: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 88 and 89: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 90 and 91: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 92 and 93: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 94 and 95: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 96 and 97: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 98 and 99: Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 101 and 102: Montrond-les-Bains (Loire), Le Châ
- Page 103 and 104: Liste des figures , planches et ann
- Page 105 and 106: Fig. 41 : Vue de l’intérieur de
- Page 107: Fig. 89 : Sondage 4, détail de l
- Page 111: 352.55355.40355.83356.64356.04356.2
- Page 115: SD 1999-1Mur 18Mur 19Mur 20SD 1999-
- Page 119: MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 122 and 123: MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 124 and 125: MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 126 and 127: MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 128 and 129:
MONTROND-LES-BAINS (Loire), châtea
- Page 130:
MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 134:
MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 137 and 138:
MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 140:
MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 143 and 144:
MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 145:
MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 149:
MONTROND-LES-BAINS (Loire), le Châ
- Page 152 and 153:
MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 155:
MONTROND-LES-BAINS (Loire), Le Châ
- Page 158 and 159:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 160 and 161:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 162 and 163:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 164 and 165:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 166 and 167:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 168 and 169:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 170 and 171:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 172 and 173:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 174 and 175:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 176 and 177:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 178 and 179:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 180 and 181:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 182 and 183:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 184 and 185:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 186 and 187:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 188 and 189:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 190 and 191:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 192 and 193:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 194 and 195:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 196 and 197:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 198 and 199:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 200 and 201:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 202 and 203:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 204 and 205:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ
- Page 206:
Montrond-les-Bains (F-42) - Le Châ