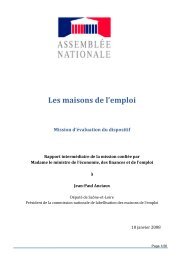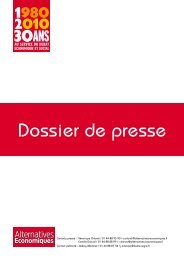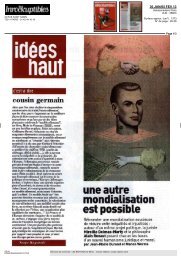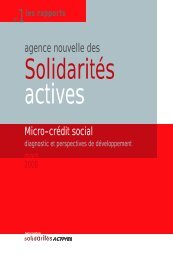Quel potentiel de développement pour l'économie sociale et solidaire
Quel potentiel de développement pour l'économie sociale et solidaire
Quel potentiel de développement pour l'économie sociale et solidaire
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Quel</strong> <strong>potentiel</strong> <strong>de</strong> <strong>développement</strong> <strong>pour</strong> l’économie <strong>sociale</strong> <strong>et</strong> <strong>solidaire</strong> ?Annexe 3Positionnement stratégique <strong>de</strong>s organisations <strong>de</strong> l’ESSselon les statutsL’économie <strong>sociale</strong> <strong>et</strong> <strong>solidaire</strong> regroupe <strong>de</strong>s entreprises<strong>de</strong> statut varié. Ces statuts sont issus d’histoiresparticulières, validées par la loi <strong>et</strong> qui renvoientbien souvent à <strong>de</strong>s positionnements sectoriels spécifiques.Il est donc important, <strong>pour</strong> qui s’intéresse à ladiversification ou au changement d’échelle possible<strong>de</strong> l’ESS, d’examiner plus en détail leur positionnementstatut par statut.1. Les Scop : une diversité sectorielle entrompe-l’œilLes Scop, en dépit <strong>de</strong> leur puissance limitée (2000entreprises, 40 000 salariés), sont présentes dans ungrand nombre <strong>de</strong> secteurs d’activité. A la différence<strong>de</strong>s autres organisations <strong>de</strong> l’économie <strong>sociale</strong>, ellessont notamment implantées dans l’industrie <strong>et</strong> dansle bâtiment-génie civil, même si elles ne contribuentque <strong>de</strong> manière très marginale à l’emploi dans ces<strong>de</strong>ux secteurs.A c<strong>et</strong>te diversité, une raison simple : les Scop sont<strong>pour</strong> la plupart d’entre elles fondées par <strong>de</strong>s personnesqui veulent créer leur propre emploi en se regroupantsur une base égalitaire <strong>et</strong> <strong>pour</strong> valoriser leurscompétences <strong>et</strong> qualifications sans vendre leur force<strong>de</strong> travail à un employeur. A ce point <strong>de</strong> vue, ellessont la seule famille <strong>de</strong> l’ESS qui peut se prévaloir <strong>de</strong>proposer une forme <strong>de</strong> dépassement <strong>de</strong> la conditionsalariale. L’objectif premier d’une Scop n’est doncpas, en règle générale, <strong>de</strong> rendre un service spécifiqueà <strong>de</strong>s tiers (comme le font les créateurs bénévoles<strong>de</strong>s associations à vocation <strong>sociale</strong>) ou <strong>de</strong> faireproduire par d’autres un service qui leur est <strong>de</strong>stiné(comme les sociétaires <strong>de</strong>s mutuelles, banquescoopératives ou les adhérents d’une coopérative <strong>de</strong>consommation). Au contraire, les Scop se développentle plus souvent dans <strong>de</strong>s activités où elles s<strong>et</strong>rouvent en concurrence frontale avec <strong>de</strong>s entreprises<strong>de</strong> statut capitaliste.En pratique cependant, la gran<strong>de</strong> masse <strong>de</strong>s effectifs<strong>de</strong>s Scop, en entreprises comme en salariés, seconcentre sur un nombre limité d’activités, commel’illustre le tableau ci-après. C<strong>et</strong>te concentration s’expliquepar les conditions stratégiques qui prélu<strong>de</strong>nten général à la création d’une Scop. On peut ainsi distinguerquatre modèles stratégiques <strong>de</strong> Scop, mêmesi le premier est très largement dominant (voir tableau7 ci-après) :La Scop d’égaux. La gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong>s Scopregroupent <strong>de</strong>s personnes exerçant <strong>de</strong>s métiersqualifiés, qui <strong>pour</strong>raient être exercé en solo parcequ’ils ne s’insèrent pas dans <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> productionoù la division du travail s’est imposée commeune nécessité absolue. Le fait <strong>de</strong> se regrouperà plusieurs présente néanmoins <strong>de</strong> nombreuxavantages : cela perm<strong>et</strong> seulement d’être pluscrédible vis-à-vis <strong>de</strong>s clients, <strong>et</strong> <strong>de</strong> m<strong>et</strong>tre encommun les services supports (administration, gestion,service commercial, <strong>et</strong>c.). De même que lespremières coopératives <strong>de</strong> production apparuesau XIX e siècle ont regroupé <strong>de</strong>s ouvriers hautementqualifiés <strong>de</strong> type artisanal, souvent propriétaires<strong>de</strong> leurs outils (comme dans la bijouterie oudans l’artisanat du bâtiment du second œuvre), onen voit émerger aujourd’hui dans les activités <strong>de</strong>services aux entreprises : conseil, mark<strong>et</strong>ing, servicesinformatiques, cabin<strong>et</strong>s d’architecture… Lalogique à l’œuvre est la même : ces personnesconstituent <strong>de</strong>s Scop d’ « égaux » où la qualification<strong>de</strong>s coopérateurs est relativement homogène,<strong>de</strong> même que leur rémunération. Ces entreprisesrestent généralement <strong>de</strong> très p<strong>et</strong>ite taille, legroupe initial se satisfaisant d’avoir créé ses moyensd’existence. Elles travaillent le plus souvent sur<strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong> proximité. Un grand nombred’entre elles sont en étroite relation avec <strong>de</strong>sclients publics (notamment <strong>de</strong>s collectivités territoriales)<strong>et</strong>/ou en synergie avec d’autres entreprises<strong>de</strong> l’économie <strong>sociale</strong> <strong>et</strong> <strong>solidaire</strong>. L’activité<strong>de</strong> ces coopératives débouche rarement surl’émergence d’une marque forte associée à <strong>de</strong>sproduits matériels ou immatériels. La valorisation<strong>de</strong> l’entreprise <strong>de</strong>meure donc limitée au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> lavaleur <strong>de</strong> ses actifs physiques <strong>et</strong> <strong>de</strong> son portefeuille<strong>de</strong> clients. Du coup, l’adoption du statutScop ne conduit pas les coopérateurs à renoncer àd’importantes plus-values latentes, tout en leurperm<strong>et</strong>tant <strong>de</strong> bénéficier <strong>de</strong>s avantages fiscauxliés au statut.51