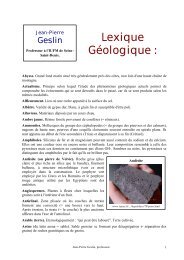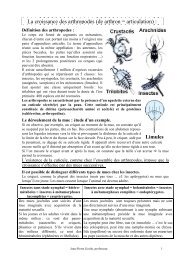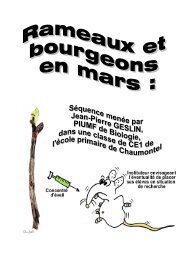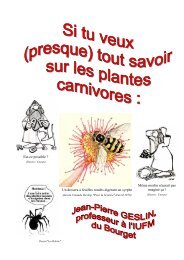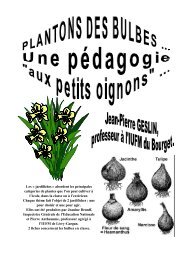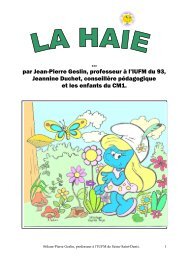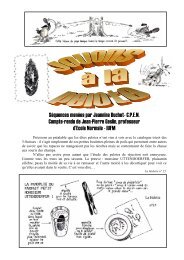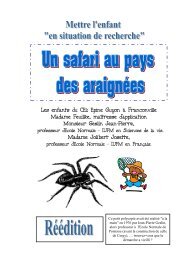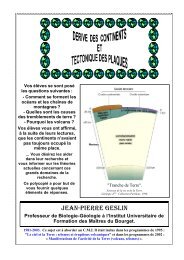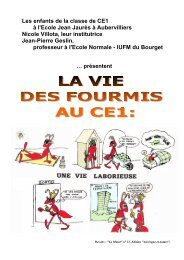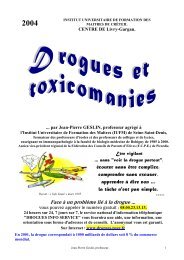Dinosaure complet J-P Geslin.pdf - Free
Dinosaure complet J-P Geslin.pdf - Free
Dinosaure complet J-P Geslin.pdf - Free
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
?<br />
I- HOMEOTHERMES ET POÏKILOTHERMES :<br />
Tous les êtres vivants produisent de la chaleur, cette production étant liée aux combustions<br />
cellulaires. Parmi les vertébrés, on a l’habitude de distinguer ceux à "sang chaud" et ceux à<br />
"sang froid".<br />
A) LES VERTEBRES À "SANG CHAUD" :<br />
Ce sont les oiseaux et les mammifères. Ils maintiennent la température de leur corps à un<br />
niveau constant (37 °C chez l’homme, 38 °C chez la baleine, 39 °C chez le lapin et chez le<br />
chien, 42 °C chez la poule et le canard)<br />
Dans nos régions tempérées, la température interne de ces animaux est donc supérieure à celle<br />
du milieu ambiant… d’où le nom d’animaux "à sang chaud". Les biologistes préfèrent le terme<br />
d’ENDOTHERMES qui indique que la principale source de chaleur est d’origine interne ou<br />
celui d’HOMÉOTHERMES (de homoios = semblable et thermos = chaleur) qui se réfère à la<br />
permanence de la température de l’organisme.<br />
Les oiseaux et les mammifères sont bien isolés du milieu extérieur par leur plumage ou leur<br />
fourrure et par leur graisse.<br />
La constance de leur température corporelle est liée à une fonction : la régulation thermique<br />
ou thermorégulation. Leur homéothermie résulte en effet d’un équilibre entre production de<br />
chaleur et déperdition calorique.<br />
- En cas de lutte contre le froid, il y a augmentation de la production de chaleur (frissons,<br />
libération hormones surrénaliennes et thyroïdiennes qui accroissent les activités cellulaires) et<br />
diminution des pertes thermiques (par baisse du débit sanguin au niveau de la peau, par<br />
hérissement des plumes et horripilation des poils et augmentation de leurs qualités isolantes<br />
durant la « mauvaise » saison…)<br />
A ces mécanismes physiologiques, s’en ajoutent d’autres d’ordre comportemental : repliement<br />
sur soi, tendance au regroupement, construction ou recherche d’abris et modification du régime<br />
alimentaire (avec augmentation de l’ingestion des graisses).<br />
- En cas de lutte contre une élévation de température, on pourrait penser qu’il y a<br />
diminution de la thermogenèse (= production de chaleur) et augmentation de la thermolyse (=<br />
perte de chaleur). En fait, seul le second mécanisme<br />
intervient. La thermogenèse ne passe par une valeur<br />
minimum que lorsque sont remplies les conditions<br />
du métabolisme basal.<br />
L’augmentation de la déperdition se produit grâce à<br />
une dilatation des vaisseaux de la peau, par<br />
accroissement de la sudation ou encore par<br />
polypnée thermique (cf. halètement du chien) chez<br />
les animaux dépourvus de glandes sudoripares.<br />
A ceci s’ajoutent des mécanismes comportementaux<br />
: recherche d’abris, diminution de<br />
l’activité musculaire, ingestion de boissons<br />
fraîches…<br />
Les dinosaures<br />
avaient-ils le<br />
sang chaud ?<br />
Métabolisme basal :<br />
Quantité de chaleur produite, en 1<br />
heure et par mètre carré de surface<br />
corporelle, par un homéotherme à<br />
jeun depuis 12 heures, au repos<br />
<strong>complet</strong> et à la température de<br />
neutralité thermique (= température<br />
pour laquelle le sujet n’éprouve ni<br />
sensation de chaud, ni sensation de<br />
froid = température pour laquelle les<br />
mécanismes thermorégulateurs n’ont<br />
pas à intervenir).<br />
Jean-Pierre <strong>Geslin</strong>, professeur à l’IUFM du Bourget. 57