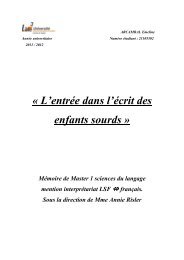comptes-rendus des séances - Savoirs Textes Langage - Lille 3
comptes-rendus des séances - Savoirs Textes Langage - Lille 3
comptes-rendus des séances - Savoirs Textes Langage - Lille 3
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
qui se peut dire de l’une et ce qui se peut dire de l’autre" écrit Leibniz dans une lettre à Arnauld<br />
(correspondant d’obédience cartésienne à qui il a envoyé les abrégés de son Discours<br />
de Métaphysique). Cette définition de l’expression correspond à la définition de l’analogie<br />
mathématique qui ne se soucie pas <strong>des</strong> caractères communs aux termes comparés mais de la<br />
structure existant entre les termes.<br />
Si on s’en tenait à cette acception du troisième sens de l’analogie, on pourrait à bon droit<br />
se demander dans quelle mesure elle se distingue radicalement d’une figure méthodologique<br />
et de quelle manière elle constitue un objet théorique.<br />
C’est la raison pour laquelle il faut expliciter ce qu’est l’expression dans la pensée de<br />
Leibniz, plus exactement dans quelle mesure l’expression s’apparente à la perception. Or,<br />
précisément Leibniz définit la perception comme l’action propre à toute substance par laquelle<br />
cette substance exprime l’univers selon son point de vue. Autrement dit, l’analogie est<br />
objet de l’expression ou encore de la perception, c’est-à-dire que la perception est l’action<br />
par laquelle j’exprime <strong>des</strong> relations (ou correspondances réglées) entre toutes les substances<br />
de l’univers selon mon point de vue.<br />
L’enjeu de cette précision est de se demander si Leibniz a un usage univoque de l’analogie<br />
sommairement définie comme une mise en relation entre <strong>des</strong> entités hétérogènes ou bien s’il<br />
produit en acte, autrement dit dans l’utilisation même de la figure de l’analogie, un nouveau<br />
sens. Notre travail a donc consisté à procéder à un repérage <strong>des</strong> usages explicites et implicites<br />
de l’analogie pour produire une définition comme écart.<br />
Comment penser ces différents usages de l’analogie ? Faut-il considérer que l’analogie<br />
travaille selon <strong>des</strong> régimes différents dans les textes de Leibniz sans forcément entretenir de<br />
relations entre eux ou bien faut-il au contraire penser qu’il y a une relation entre l’analogie<br />
comme méthode et l’analogie comme objet de la perception ?<br />
Notre hypothèse de lecture fut que l’analogie devient explicitement heuristique, c’està-dire<br />
dotée d’une réelle fécondité à partir du moment où dans un même texte son statut<br />
change, autrement dit à partir du moment où elle passe de méthode à objet théorique. Les<br />
textes consacrés à la Dynamique ont constitué, en ce sens, un terrain privilégié pour observer<br />
ce changement et en particulier le second Essay de Dynamique de 1699-1701.<br />
Quelques références :<br />
<strong>Textes</strong> de Leibniz :<br />
-"Dynamica de potentia" (1689-1690) in Mathematische Schriften, vol.6, éd. Gerhardt, rééd.<br />
Olms, 1971, pp.281-514.<br />
-"Essay de Dynamique" (1692) in Leibniz et la Dynamique en 1692. <strong>Textes</strong> et commentaires.<br />
éd. P. Costabel, Paris, Vrin, 1981.<br />
-"De Ipsa natura"(1698) in G.W. Leibniz, Opuscules philosophiques choisis, traduits du latin<br />
par Paul Schrecker, Paris, Vrin, 1978 (1˚ éd. 1966), pp. 93-112.<br />
-"Essay de dynamique sur les lois du mouvement où il est montré qu’il ne se conserve pas<br />
la même quantité de mouvement, mais la même force absolue, ou bien la même Quantité de<br />
l’Action Motrice" (1699-1701) in Mathematische Schriften, vol.6, éd. Gerhardt, rééd. Olms,<br />
24