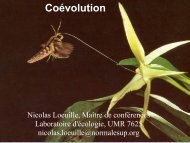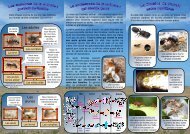rapport d'auto-Žvaluation - Ecologie & Evolution - Université Pierre ...
rapport d'auto-Žvaluation - Ecologie & Evolution - Université Pierre ...
rapport d'auto-Žvaluation - Ecologie & Evolution - Université Pierre ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
mathématique fine de processus de branchement incluant une régulation logistique de la population.<br />
Nous avons notamment établi des conditions générales sous lesquelles la distribution quasistationnaire<br />
(DQS) de la population, qui décrit asymptotiquement son état conditionnellement à la<br />
non-extinction, est unique. Nous avons également clarifié les liens mathématiques unissant processus<br />
de branchement logistiques et processus généalogiques. [5, 25]<br />
Dynamiques écologiques et dynamiques adaptatives hors-équilibre. Nous avons enfin<br />
généralisé le cadre mathématique des dynamiques adaptatives au cas où les dynamiques écologiques<br />
rendent le gradient de sélection discontinu. Dans ce cas, la dynamique adaptative d’une population<br />
peut se stabiliser sur un « pseudo-équilibre », suivre de longs transients le long des bifurcations<br />
écologiques, favoriser sa diversification sans passer par des points de branchement, ou au contraire<br />
conduire à l’extinction (« suicide évolutif »). [58, 62, 79]<br />
B. Applications théoriques<br />
EEM utilise ses avancées mathématiques fondamentales (section A) pour mener une recherche<br />
innovante sur des problèmes théoriques généraux. Quatre thèmes ont été particulièrement<br />
développés au cours de la période contractuelle écoulée : évolution de la coopération ; évolution des<br />
mutualismes ; évolution de la virulence et dynamiques épidémiques ; évolution et structuration des<br />
communautés dans des environnements hétérogènes.<br />
<strong>Evolution</strong> de la coopération. La théorie des dynamiques adaptatives pour des populations<br />
structurées nous a permis d’aborder la question de l’évolution de la coopération entre différents<br />
stades du cycle de vie—en particulier le problème de l’évolution du parental care (thèse de S.<br />
Lion). Les modèles révèlent les conséquences de l’évolution du parental care sur la structuration<br />
spatiale de la population elle-même. La question de l’origine de cette structuration (et notamment la<br />
formation de groupes) est au centre de la thèse (en cours) de T. Garcia. [12, 26, 43, 94, 98, 103]<br />
Avec le recrutement de Jean-Baptiste André, l’équipe a pu élargir son champ de recherche théorique<br />
sur l’évolution de la coopération au problème fondamental du comportement social de l’Homme,<br />
avec un enjeu théorique particulier : modéliser les interactions entre coopération et culture et<br />
intégrer des formes non-génétiques de transmission de l’information. Partant de l’observation que<br />
la coopération chez l’Homme obéit au principe de l’équité, qui est probablement universel et inné,<br />
nos modèles ont montré que des mécanismes de choix du partenaire pouvait entrainer l’évolution<br />
d’une stratégie de partage équitable (collaboration avec N. Baumard). Sur cette base nous avons<br />
développé une théorie alternative de la réciprocité, visant à expliquer la nature des informations<br />
véhiculées par le comportement des autres (collaboration avec O. Morin et N. Claidière). [49, 68, 69,<br />
70, 88, 90]<br />
Coopération entre espèces : mutualismes et facilitation. Le développement de modèles de<br />
coopération entre espèces, ou mutualisme, s’est poursuivi (collaboration avec J. Bronstein, S. Kéfi, S.<br />
Rinaldi, F. Dercole, M. Loreau). Nos travaux ont porté sur les réponses éco-évolutives des mutualistes<br />
au changements environnementaux, ces derniers pouvant être biotiques, avec l’introduction<br />
d’espèces parasites « tricheuses » potentiellement invasives ; ou abiotiques. Nos analyses ont révélé<br />
en quoi la présence d’espèces tricheuses pouvait affecter la co-évolution des mutualistes ; et<br />
comment ces effets co-évolutionnaires rétroagissaient sur l’écologie des parasites et leur évolution.<br />
Ces travaux nous ont conduit à proposer un nouveau cadre théorique de l ‘écologie et de l’évolution<br />
des mutualismes ; la compétition intraspécifique pour l’accès à la ressource que constitue l’espèce<br />
partenaire (ou exploitée) y joue un rôle central. Ce cadre permet d’élargir la question de l’évolution<br />
des mutualismes à celle de l’évolution de la facilitation. [10, 11, 24, 40, 95]<br />
Interactions hôtes-parasites : évolution de la virulence et dynamiques épidémiques. Afin<br />
d’identifier les facteurs écologiques et évolutifs impliqués dans l'émergence et la persistence de la<br />
virulence, nous utilisons des modèles emboités qui combinent une représentation explicite des<br />
processus intra-hôte (compétition pour les ressources, réponse immunitaire) à la dynamique<br />
épidémiologique. Nous avons ainsi pu établir une base mécaniste au trade-off fondamental entre<br />
transmission et virulence (collaboration avec S. Alizon). Ces modèles nous ont aussi permis d’étudier<br />
le cas où le temps de génération du pathogène (VIH ou grippe, par exemple) est si court qu’il est<br />
susceptible d’évoluer au cours des infections individuelles de son hôte (thèses de S. Ballesteros, A.<br />
Camacho, collaborations avec S. Alizon, S. Gandon, A. Lambert). Un problème connexe est celui des<br />
co-infections, qui créent une hétérogénéité dans la population hôte ; cette hétérogénéité peut être<br />
à l’origine d’une pression de sélection disruptive sur le parasite et conduire à l’évolution de souches<br />
45