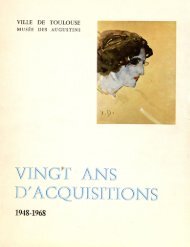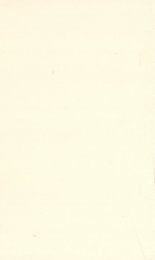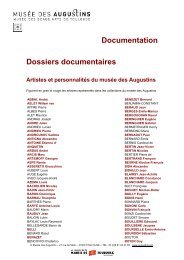Bilan des acquisitions de 1984 - Musée des Augustins
Bilan des acquisitions de 1984 - Musée des Augustins
Bilan des acquisitions de 1984 - Musée des Augustins
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
trouvera d'autant plus facilement réalisable" (Archives<br />
<strong>de</strong> la mairie <strong>de</strong> Saint-Rustice, Lettre d'Esquié au Préfet).<br />
L'église <strong>de</strong> Fitte ne fut bâtie qu'en 1865-1866 et une<br />
partie seulement <strong><strong>de</strong>s</strong> éléments indiqués par Esquié y<br />
furent remployés.<br />
Et le souvenir <strong>de</strong> l'église romane se perdit au point que,<br />
<strong>de</strong> nos jours, l'on n'en connaissait plus l'aspect. Heureusement,<br />
les archives <strong>de</strong> la mairie <strong>de</strong> Saint-Rustice conservent<br />
encore le plan <strong>de</strong> cet édifice relevé par Esquié le<br />
11 juin 1863. Une absi<strong>de</strong> majeure <strong>de</strong> 7 m d'ouverture et<br />
<strong>de</strong>ux absidioles marquaient vers l'Est l'achèvement <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
trois nefs <strong>de</strong> cette église parfaitement romane. Sur le<br />
collatéral méridional se greffait une tour d'escalier qui<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong>servait probablement le clocher et les combles.<br />
Des <strong>de</strong>mi-colonnes adossées recevaient les retombées<br />
<strong>de</strong> l'arc triomphal ou <strong><strong>de</strong>s</strong> gran<strong><strong>de</strong>s</strong> arca<strong><strong>de</strong>s</strong> séparant la<br />
nef principale <strong><strong>de</strong>s</strong> collatéraux. Seule une pile paraît,<br />
sur le plan, avoir gardé sa structure cruciforme<br />
complète d'origine. Elle correspond à un édifice voûté.<br />
Les trois autres ont été modifiées ou remplacées et ce<br />
probablement à la suite <strong><strong>de</strong>s</strong> dévastations que connut<br />
l'église en février 1567. Cette année-là, <strong><strong>de</strong>s</strong> troupes<br />
calvinistes <strong>de</strong> Montauban la pillèrent et l'incendièrent.<br />
Le registre <strong><strong>de</strong>s</strong> délibérations du conseil municipal nous<br />
apprend en 1849 "que le plafond qui est en planches<br />
tombe en morceaux..." et, en 1860, un procès-verbal<br />
du conseil <strong>de</strong> fabrique précise : "les colonnes <strong>de</strong> cette<br />
église sont couronnées <strong>de</strong> chapiteaux très remarquables<br />
dont quelques-uns sont cachés par un plancher..." (Archives<br />
communales <strong>de</strong> Saint-Rustice). La voûte n'existait<br />
probablement plus. Un document <strong>de</strong> 1615 indique<br />
par ailleurs que l'église était bâtie sur trois côtés <strong>de</strong><br />
pierres <strong>de</strong> taille et <strong>de</strong> briques ; la faça<strong>de</strong> où se trouvait<br />
l'entrée principale se présentait sous la forme d'un amalgame<br />
<strong>de</strong> " paroits en torchis et bois estant en prou<br />
mauvais estat". On remarquera, sur le plan, qu'a<br />
l'épaisseur <strong><strong>de</strong>s</strong> murs <strong><strong>de</strong>s</strong> absi<strong><strong>de</strong>s</strong> et <strong><strong>de</strong>s</strong> collatéraux —<br />
aux maçonneries bien romanes s'oppose la minceur<br />
du mur <strong>de</strong> faça<strong>de</strong> auquel s'articule un porche. Il est<br />
permis <strong>de</strong> penser que cette église, inscrite selon le plan<br />
d'Esquié dans un carré <strong>de</strong> 20 m <strong>de</strong> côté, était plus<br />
développée ou avait été prévue plus longue vers l'Ouest.<br />
Le mur <strong>de</strong> torchis et le plafond <strong>de</strong> planches seraient la<br />
réparation hâtive faite après les <strong><strong>de</strong>s</strong>tructions <strong><strong>de</strong>s</strong> protestants.<br />
Seules <strong><strong>de</strong>s</strong> fouilles permettraient en fait <strong>de</strong><br />
reconnaître le plan complet primitif <strong>de</strong> l'édifice.<br />
Nous noterons surtout ici qu'en <strong>de</strong>hors <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>ux fenêtres<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> absidioles les six autres baies <strong>de</strong> cette église, ébrasées<br />
vers l'intérieur et vers l'extérieur comprenaient<br />
chacune quatre colonnes. Ces <strong>de</strong>rnières portaient <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
chapiteaux qui furent remployés, sans doute dans leur<br />
majorité, dans les baies <strong>de</strong> l'église construite par Fitte.<br />
Dans celles-ci, qui sont au nombre <strong>de</strong> treize, on disposa,<br />
à raison <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux par baie, vingt-cinq chapiteaux romans<br />
<strong>de</strong> même gabarit ; le vingt-sixième n'était qu'une pierre<br />
hâtivement et grossièrement taillée afin <strong>de</strong> faire la paire<br />
dans la <strong>de</strong>rnière fenêtre. Or, vingt-quatre chapiteaux<br />
seulement ornaient les six fenêtres <strong>de</strong> l'église romane.<br />
C'est un <strong>de</strong> trop. Il faut en déduire que ce chapiteau<br />
supplémentaire et même quelques autres — on ne récupéra<br />
peut-être que vingt-cinq chapiteaux en 1865-66,<br />
les autres étant alors détruits ou en mauvais état —<br />
28<br />
avaient pris place ailleurs, lors <strong>de</strong> la construction <strong>de</strong><br />
l'église romane. Il n'est pas exclu qu'ils soient originaires<br />
d'une porte. Un seuil est bien indiqué, sous la<br />
fenêtre du collatéral <strong>de</strong> droite, près <strong>de</strong> la tourelle<br />
d'escalier<br />
Exposés durant plus d'un siècle aux intempéries, ainsi<br />
que les colonnes, bases et morceaux d'impostes remployés<br />
avec eux, la plupart <strong>de</strong> ces chapiteaux sont<br />
arrivés jusqu'à nous dans un état <strong>de</strong> dégradation très<br />
avancé. Les maladies <strong>de</strong> la pierre n'ont que trop largement<br />
accompli leur oeuvre <strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong>truction. Fort heureusement,<br />
la municipalité <strong>de</strong> Saint-Rustice, sur l'impulsion<br />
luci<strong>de</strong> <strong>de</strong> M. Otal, adjoint au maire, prit conscience <strong>de</strong><br />
ce phénomène irréversible et décida <strong>de</strong> confier ces sculptures<br />
au musée <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Augustins</strong>. C'était adopter sagement<br />
la <strong>de</strong>rnière mesure susceptible <strong>de</strong> les sauver <strong>de</strong> l'anéantissement<br />
total. L'atelier <strong>de</strong> restauration <strong><strong>de</strong>s</strong> musées <strong>de</strong><br />
Toulouse procéda à leur enlèvement et à leur consolidation.<br />
Des moulages <strong><strong>de</strong>s</strong> oeuvres les mieux conservées<br />
ont été remis dans les baies afin <strong>de</strong> ne pas appauvrir et<br />
dénaturer l'architecture <strong>de</strong> l'église du village.<br />
Tous ces chapiteaux, décrits ci-<strong><strong>de</strong>s</strong>sous, sont taillés dans<br />
une même pierre. Les blocs d'origine, sciés, avaient<br />
environ 30 cm <strong>de</strong> hauteur, 25 cm <strong>de</strong> largeur et <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur.<br />
Leur abaque est toujours marquée par les<br />
cornes et petits modillons centraux dérivant du chapiteau<br />
corinthien antique. Ces remarques montrent la<br />
gran<strong>de</strong> unité technique <strong>de</strong> la série. Ils se répartissent<br />
en trois catégories : chapiteaux à décor végétal (11),<br />
ceux où apparaissent animaux et monstres (10 ou 11),<br />
enfin ceux qui portent <strong><strong>de</strong>s</strong> figures humaines (3). Dans<br />
cette classification on n'a retenu que le thème dominant,<br />
les différents sujets pouvant se mêler sur une même<br />
oeuvre. Ces décors, par l'iconographie comme le style,<br />
sont à rattacher aux créations du cloître <strong>de</strong> Moissac et,<br />
à Toulouse, à celles du cloître <strong>de</strong> la Daura<strong>de</strong> et <strong>de</strong> la<br />
basilique Saint-Sernin vers 1100. A quelques exceptions<br />
près ils n'atteignent pas toujours la qualité <strong><strong>de</strong>s</strong> plus<br />
belles créations sculpturales <strong>de</strong> ces édifices. On peut<br />
supposer que l'un <strong><strong>de</strong>s</strong> sculpteurs <strong>de</strong> Moissac fut le<br />
maître <strong>de</strong> Saint-Rustice, suivi par un ou plusieurs<br />
compagnons <strong>de</strong> moindre talent qui cherchèrent à imiter<br />
<strong>de</strong> leur mieux ses réalisations.<br />
Il ne nous semble pas souhaitable d'envisager un long<br />
étalement dans le temps <strong>de</strong> ces travaux étant donné la<br />
relative mo<strong><strong>de</strong>s</strong>tie <strong>de</strong> l'entreprise par rapport au cloître<br />
<strong>de</strong> Moissac, à celui <strong>de</strong> la Daura<strong>de</strong> ou au chantier <strong>de</strong><br />
Saint-Sernin. L'étu<strong>de</strong> du plan <strong>de</strong> l'édifice a révélé sa<br />
gran<strong>de</strong> unité. On la retrouve dans les caractères techniques<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> chapiteaux. La datation peut être assez sûre<br />
et nous proposons l'année 1107 ou les années suivantes.<br />
Le cloître <strong>de</strong> Moissac était achevé en 1100. Ses artistes<br />
se dispersèrent ensuite vers plusieurs chantiers dont les<br />
prieurés <strong>de</strong> la Daura<strong>de</strong>, <strong>de</strong> Saint-Michel <strong>de</strong> Lescure<br />
(Tarn) et <strong>de</strong> Saint-Rustice.<br />
Bibi. : ESCUDIER (Adrien), Monographie <strong>de</strong> Saint- Rustice, Toulouse, 1935;<br />
PARADIS (Magella), La restauration au XIXe siècle <strong><strong>de</strong>s</strong> églises romanes, rurales,<br />
non classées, du département <strong>de</strong> la Haute-Garonne d'après les archives départementales,<br />
D.E.A., mémoire dactylographié, Université <strong>de</strong> Toulouse-Le Mirait,<br />
juin 1977, p. 12-29; DURLIAT (Marcel), Haut-Languedoc roman, coll.<br />
Zodiaque, La Pierre-qui-vire, 1978, p. 41.<br />
D.C.