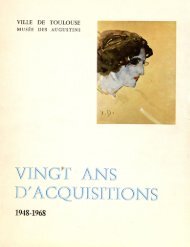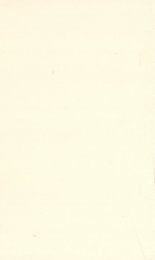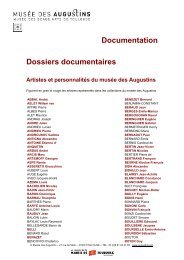Bilan des acquisitions de 1984 - Musée des Augustins
Bilan des acquisitions de 1984 - Musée des Augustins
Bilan des acquisitions de 1984 - Musée des Augustins
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Le 26 avril 1977, alors que l'on creusait dans la galerie<br />
orientale du grand cloître <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Augustins</strong> une tranchée pour<br />
l'installation <strong>de</strong> canalisations <strong>de</strong> chauffage, la pelle rencontra<br />
une résistance particulière <strong>de</strong>vant la gran<strong>de</strong> fenêtre septentrionale<br />
<strong>de</strong> la chapelle Notre-Dame-<strong>de</strong>-Pitié. Le dégagement<br />
du remblai fut poursuivi avec attention et, dans<br />
l'émotion générale, les fouilleurs virent apparaître, soigneusement<br />
rangées dans une fosse selon trois couches<br />
successives séparées par <strong><strong>de</strong>s</strong> lits <strong>de</strong> sable, neuf sculptures<br />
<strong>de</strong> la fin du Moyen Age.<br />
Dans leur majorité, ces oeuvres étaient brisées en plusieurs<br />
morceaux ou mutilées. La plupart <strong><strong>de</strong>s</strong> figures humaines<br />
avaient perdu leurs têtes. Malgré une fouille complète et<br />
systématique <strong>de</strong> la fosse, tous les éléments constitutifs <strong>de</strong><br />
ces sculptures ne purent être trouvés et l'on dut en conclure<br />
qu'elles avaient été enterrées déjà morcelées et incomplètes.<br />
Deux interprétations <strong>de</strong> cet enfouissement se présentent à<br />
l'esprit. Dans le cadre d'une première hypothèse il est permis<br />
<strong>de</strong> penser qu'il a été effectué à la suite d'un acte iconoclaste<br />
dont les circonstances historiques ne sont pas<br />
connues mais pourraient être les luttes religieuses <strong>de</strong> la<br />
secon<strong>de</strong> moitié du XVIe siècle, ou bien le vandalisme <strong>de</strong><br />
l'époque révolutionnaire. Une <strong>de</strong>uxième explication se<br />
relierait plus aisément, pensons-nous, à ce qui se produisit<br />
effectivement au musée <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Augustins</strong> dans les premières<br />
décennies du XIXe siècle. Les autres découvertes faites<br />
récemment aux <strong>Augustins</strong> démontrent que l'on procéda<br />
alors à la mise au rebut ou au remploi dans <strong><strong>de</strong>s</strong> maçonneries,<br />
d'ceuvres cassées, mutilées ou fragmentaires que l'on<br />
46<br />
La fosse aux neuf sculptures<br />
du grand cloître <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Augustins</strong><br />
n'avait pas eu le soin <strong>de</strong> rapprocher — cela aurait souvent<br />
pu être fait — <strong><strong>de</strong>s</strong> morceaux complémentaires existant<br />
dans la collection. Lors <strong><strong>de</strong>s</strong> transferts ou <strong><strong>de</strong>s</strong> manutentions,<br />
les pièces lapidaires furent souvent brisées. Les morceaux<br />
d'une seule et unique pièce connurent ensuite <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong>tinations<br />
différentes à l'intérieur du musée, lors <strong><strong>de</strong>s</strong> tris nécessaires<br />
en vue <strong>de</strong> la présentation <strong><strong>de</strong>s</strong> collections !<br />
On aurait ainsi " mis <strong>de</strong> côté" ces neuf sculptures dans<br />
une fosse avec le souci <strong>de</strong> ne pas les détruire et <strong>de</strong> ne pas<br />
les noyer dans le mortier d'un mur. La prise <strong>de</strong> conscience<br />
<strong>de</strong> leur caractère d'images sacrées ayant servi au culte peut<br />
éventuellement aussi justifier le soin avec lequel elles furent<br />
disposées dans l'excavation.<br />
Trois <strong><strong>de</strong>s</strong> neuf sculptures trouvées dans la fosse et cataloguées<br />
ci-<strong><strong>de</strong>s</strong>sous ont <strong><strong>de</strong>s</strong> relations techniques et stylistiques<br />
évi<strong>de</strong>ntes avec <strong>de</strong>ux sculptures déjà conservées en tant<br />
qu'oeuvres <strong>de</strong> musée dans la collection lapidaire <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
<strong>Augustins</strong>. La statue <strong>de</strong> sainte Barbe (n° 98) avait une statue<br />
soeur dont nous conservons encore la partie basse (présentée<br />
dans notre exposition hors catalogue). L'évêque<br />
céphalophore (n° 96) et la statue représentant peut-être<br />
saint Jean-Baptiste (n° 97) forment un groupe cohérent<br />
avec une figure <strong>de</strong> saint Jean l'Evangéliste cataloguée dès<br />
1805 et qui fut donc retenue dès cette époque comme digne<br />
d'être exposée.<br />
Bibi. : D. MILHAU, Découvertes archéologiques au monastère <strong><strong>de</strong>s</strong> ermites <strong>de</strong><br />
saint Augustin et données nouvelles sur l'histoire du couvent, dans Mémoires <strong>de</strong><br />
la société archéologique du Midi <strong>de</strong> la France, t. XLI, Toulouse, 1977.<br />
D.C.