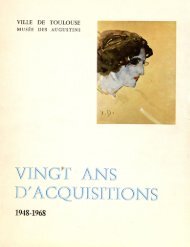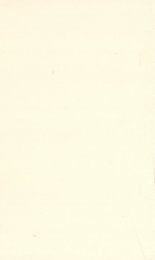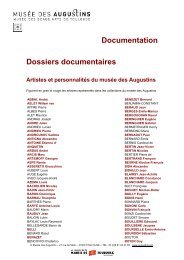Bilan des acquisitions de 1984 - Musée des Augustins
Bilan des acquisitions de 1984 - Musée des Augustins
Bilan des acquisitions de 1984 - Musée des Augustins
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
54<br />
ondulant sous une carapace annelée et dressé<br />
sur une double queue reptilienne, gueule <strong>de</strong>ntée<br />
gran<strong>de</strong> ouverte, cou squameux. Les <strong>de</strong>ux monstres<br />
placés à l'angle libre <strong>de</strong> la corbeille saisissent<br />
<strong>de</strong> leurs longues et maigres pattes une tête<br />
humaine dont la frange <strong>de</strong> la chevelure est<br />
encore perceptible malgré son état dégradé.<br />
Ceux qui sont tournés vers les côtés tiennent<br />
un curieux motif formé <strong>de</strong> quatre ou cinq cylindres<br />
emboités que l'on a assez fréquemment<br />
employé sur les chapiteaux <strong>de</strong> la cathédrale <strong>de</strong><br />
Jaca en Aragon. Ces animaux s'attaquant à<br />
une tête d'homme existent aussi bien à la basilique<br />
Saint-Sernin qu'a Moissac. Dans le<br />
cloître <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier lieu se retrouvent, i<strong>de</strong>ntiques,<br />
les monstres <strong>de</strong> Saint-Rustice (chapiteau<br />
n° 32 <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> d'E. Rupin citée plus haut).<br />
Mais la corbeille <strong>de</strong> notre chapiteau n'est pas<br />
aussi évasée que celle <strong>de</strong> Moissac : le thème est<br />
plus ramassé, les animaux ne pouvant se développer<br />
selon <strong><strong>de</strong>s</strong> courbes aussi harmonieuses.<br />
55<br />
D.C.<br />
Chapiteau d'angle pour une colonne<br />
Pierre ocrée. H. 0,300; L. 0,245;<br />
P. 0,230; diamètre du plan d'application<br />
<strong>de</strong> la colonne : environ 0,170.<br />
Eglise romane <strong>de</strong> Saint-Rustice (Haute-<br />
Garonne).<br />
1107 ou peu après.<br />
Inv. 83-5-15.<br />
Ce chapiteau est presque complètement ruiné.<br />
Toutefois on <strong>de</strong>vine une partie <strong>de</strong> son décor sur<br />
l'un <strong><strong>de</strong>s</strong> petits côtés. Un grand oiseau représenté<br />
<strong>de</strong> face, le cou et la tête infléchis, se dressait<br />
sur l'astragale. Peut-on aussi reconnaître les<br />
vestiges <strong>de</strong> la tête et <strong><strong>de</strong>s</strong> épaules d'un homme<br />
placé <strong>de</strong>rrière lui ?<br />
D.C.<br />
56<br />
Chapiteau d'angle pour une colonne<br />
Pierre ocrée. Vestiges infimes <strong>de</strong> peinture :<br />
blanc-rosé, rouge. H. 0,300; L. 0,245;<br />
P. 0,235; diamètre du plan d'application<br />
<strong>de</strong> la colonne : 0,170.<br />
32<br />
Eglise romane <strong>de</strong> Saint-Rustice (Haute-<br />
Garonne).<br />
1107 ou peu après.<br />
Inv. 83-5-13.<br />
Un tracé <strong>de</strong> taille est gravé sur le plan d'attente<br />
<strong>de</strong> l'abaque. De face, un grand aigle aux ailes<br />
éployées occupe l'angle libre <strong>de</strong> la corbeille. De<br />
part et d'autre sont <strong>de</strong>ux hommes <strong>de</strong>bout dont<br />
les jambes écartées laissent s'épanouir entre<br />
elles un large motif végétal en palme renversée.<br />
D'une <strong>de</strong> leurs mains, ils en tiennent la tige terminée<br />
en crossette. Ils sont nus, côtes et poitrines<br />
bien marquées. Le visage <strong>de</strong> l'un d'eux, en<br />
partie conservé, présente un profil assez lourd<br />
et est couronné d'une chevelure à large frange.<br />
Chacun <strong>de</strong> ces hommes a le bras levé et semble<br />
s'accrocher <strong>de</strong> sa main au rebord d'une aile <strong>de</strong><br />
l'aigle. S'agit-il <strong>de</strong> la capture <strong>de</strong> l'oiseau ou <strong>de</strong><br />
l'enlèvement d'âmes vers les cieux ? La signification<br />
du thème est difficile à établir bien que<br />
ce sujet ne soit pas isolé dans l'art roman. On<br />
le retrouve en effet sur un chapiteau <strong>de</strong> la tribune<br />
occi<strong>de</strong>ntale du croisillon méridional du<br />
transept <strong>de</strong> la basilique Saint-Sernin.<br />
Les détails <strong>de</strong> la représentation <strong>de</strong> l'aigle d'une<br />
part et, <strong>de</strong> l'autre, les types humains trapus<br />
(trois têtes pour la hauteur totale du corps) aux<br />
visages caractéristiques nous ramènent , quant<br />
au style, vers le cloître <strong>de</strong> Moissac ou les premiers<br />
chapiteaux sculptés pour le cloître <strong>de</strong> la<br />
Daura<strong>de</strong> à Toulouse.<br />
D.C.<br />
57<br />
56<br />
Chapiteau d'angle pour une colonne<br />
Pierre ocrée. Traces infimes <strong>de</strong><br />
peinture :blanc-rosé. H. 0,300; L. 0,250;<br />
P.0,250 ; diamètre du plan d'application<br />
<strong>de</strong> la colonne : 0,170.<br />
Eglise romane <strong>de</strong> Saint-Rustice (Haute-<br />
Garonne).<br />
1107 ou peu après.<br />
Inv. 83-5-21.<br />
Cette oeuvre, malgré sa dégradation, est d'une<br />
qualité exceptionnelle. Le tracé <strong>de</strong> taille <strong>de</strong><br />
l'abaque est rigoureux : les cornes ont été dégagées<br />
d'après <strong><strong>de</strong>s</strong> lignes nettement définies au<br />
compas, les modillons centraux, d'une gran<strong>de</strong><br />
saillie, étant précisément arrondis.<br />
Dans l'angle <strong>de</strong> la corbeille trône le Christ glorieux<br />
du retour. Il se tient <strong>de</strong> face, bénit <strong>de</strong> sa<br />
main droite levée et présente un livre ouvert qui<br />
est posé sur son genou gauche. La gloire est<br />
indiquée par la traditionnelle mandorle tenue à<br />
pleines mains par <strong>de</strong>ux anges <strong>de</strong>bout qui, peut-<br />
être éblouis par la lumière divine et ne pouvant<br />
en soutenir l'éclat, détournent leurs visages.<br />
Cette iconographie pleinement romane s'est<br />
essentiellement définie à partir <strong>de</strong> l'Evangile <strong>de</strong><br />
Matthieu (XXV, 31). Ce type <strong>de</strong> Christ se<br />
retrouve sur le Dieu <strong>de</strong> Majesté au tétramorphe<br />
présenté dans le déambulatoire <strong>de</strong> la basilique<br />
Saint-Sernin. Quant à l'ensemble <strong>de</strong> cette<br />
représentation, il existe, i<strong>de</strong>ntique mais plus<br />
développé, sur la face antérieure <strong>de</strong> la table<br />
d'autel (1096, signée par le sculpteur Bernard<br />
Gilduin) et sur un célèbre chapiteau <strong>de</strong> la tribune<br />
Sud (vers 1096-1100) <strong>de</strong> cette même basilique.<br />
Un petit détail nous paraît établir encore<br />
plus la relation entre ces oeuvres et le chapiteau<br />
<strong>de</strong> Saint-Rustice. Dans toutes ces sculptures<br />
les mains inférieures <strong><strong>de</strong>s</strong> anges passent <strong>de</strong>vant<br />
le cadre <strong>de</strong> la mandorle tandis que leurs mains<br />
supérieures le retiennent par <strong>de</strong>rrière.<br />
L'art <strong>de</strong> cette composition procè<strong>de</strong> sans doute<br />
<strong>de</strong> certains chapiteaux du cloître <strong>de</strong> Moissac<br />
(attitu<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> marche, mandorle dans laquelle<br />
sont les âmes <strong><strong>de</strong>s</strong> saints Fructueux, Euloge et<br />
Augure) mais aussi <strong><strong>de</strong>s</strong> tailloirs <strong>de</strong> ce même<br />
cloître que l'on rapproche habituellement <strong>de</strong> la<br />
table d'autel et <strong><strong>de</strong>s</strong> oeuvres <strong>de</strong> Bernard Gilduin<br />
à Saint-Sernin. Une différence existe entre les<br />
types humains assez raffinés du Christ et <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
anges <strong>de</strong> ce chapiteau et ceux, plus sommaires,<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> hommes placés <strong>de</strong> part et d'autre d'un aigle<br />
décrits à la notice précé<strong>de</strong>nte. La sculpture que<br />
nous essayons d'analyser ici, malgré ses mutilations<br />
et son usure, pose <strong>de</strong> nouveau la difficile<br />
question du passage du style vivant et narratif<br />
<strong>de</strong> Moissac vers celui, plus solennel et antiquisant<br />
<strong>de</strong> Bernard Gilduin. Elle est l'oeuvre du<br />
meilleur sculpteur <strong>de</strong> Saint-Rustice, issu certainement<br />
<strong>de</strong> Moissac mais qui a pu connaître<br />
aussi l'oeuvre <strong>de</strong> Gilduin.<br />
D.C.<br />
58<br />
57<br />
Chapiteau d'angle pour une colonne<br />
Pierre ocrée. H. 0,295 ; L. 0,245;<br />
P.0,210 ; diamètre du plan d'application<br />
<strong>de</strong> la colonne : 0,170. Traces <strong>de</strong> peinture :<br />
blanc-rosé, rouge.<br />
Eglise romane <strong>de</strong> Saint-Rustice (Haute-<br />
Garonne).<br />
1107 ou peu après.<br />
Inv. 83-5-25.