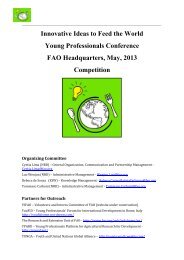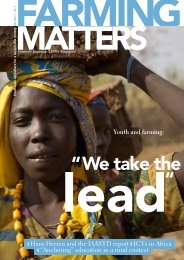UNIVERSITE DE DSCHANG - YPARD
UNIVERSITE DE DSCHANG - YPARD
UNIVERSITE DE DSCHANG - YPARD
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Dans ce contexte économique et social marqué par l’augmentation de la population, la fluctuation des<br />
prix des produits agricoles et alimentaires, l’augmentation des besoins de bases des exploitations<br />
familiales,et surtout le désengagement de l’Etat de nombreuses fonctions d’appui aux producteurs<br />
ainsi que l’émergence des organisations paysannes (OP), l’Etat et d’autres structures de<br />
développement doivent renforcer les capacités des paysans en vue d’augmenter la production<br />
agricole (Balkissou, 2003 ; Faure et al., 2004). C’est à ce sujet que de nombreux États africains ont<br />
adopté des programmes de vulgarisation type "Formation et Visites" pour la diffusion des innovations<br />
techniques (Balkissou, 2003). Mais aujourd’hui, ces programmes basés sur le renforcement des<br />
appareils administratifs et un transfert de technologies standardisées ne sont plus fonctionnels dans<br />
leur grande majorité et les dispositifs de vulgarisation disparaissent progressivement (Inter-réseaux,<br />
2007).<br />
L’une des causes de la disparition de cette approche de vulgarisation est sa méthode caractérisée de<br />
« top down » car elle ne prenait pas en compte les besoins réels des paysans pour qui l’innovation<br />
était construite (Havard et al., 2001 ; Faure et al., 2004 ; Lapbim et al., 2006). D’ailleurs, Tchouamo et<br />
Steele (1997), Lapbin (2005) rapportent que seuls 30 % des paysans de l’Ouest-Cameroun ont estimé<br />
être satisfaits par cette approche.<br />
Ondoa (2006) souligne que dans le cadre de la définition des nouvelles politiques agricoles en vue de<br />
la relance de l’économie et surtout la lutte contre l’insécurité alimentaire qui domine en Afrique, on a<br />
assisté au Cameroun à une restructuration réussie de certaines entreprises publiques, l’adoption de<br />
nouvelles lois régissant le mouvement coopératif, la promotion des organisations interprofessionnelles<br />
agricoles, la libéralisation de la commercialisation des produits agricoles, le développement des<br />
systèmes de micro-finance, la mise en œuvre d’une nouvelle démarche de vulgarisation agricole, la<br />
libéralisation du commerce des intrants agricoles, la mise sur pied de divers projets d’appui à la<br />
consolidation des organisations paysannes et à l’amélioration de la sécurité alimentaire.<br />
Selon Mohamed et al. (2007), des institutions de recherche et de développement en Afrique de<br />
l’Ouest et du Centre ont testé et développé de nouvelles méthodes d’appui aux producteurs. Ces<br />
dernières sont basées sur l’élaboration de conseils à l’exploitation familiale favorisant la participation<br />
des producteurs. Parmi elles, celles relatives au conseil de gestion, mises en place dans plusieurs<br />
pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire et Mali.) et<br />
ayant mobilisé des producteurs (de quelques dizaines à plusieurs milliers selon les cas), des<br />
organisations paysannes, des ONG et des structures étatiques (Inter-réseaux, 2007).<br />
Appliquée au Cameroun d’abord dans la région septentrionale par le biais du Pôle de Recherche<br />
Appliquée au Développement des Savanes d’Afrique Centrale (PRASAC), l’approche conseil aux<br />
exploitations familiales (CEF) s’étend timidement dans d’autres zones agro écologiques du pays. Elle<br />
sert de référence au programme : « Amélioration de la compétitivité des exploitations familiales<br />
agropastorales » (ACEFA) du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINA<strong>DE</strong>R) et du<br />
Ministère de l’Elevage, des Pêches, et des Industries Animales (MINEPIA) mis en œuvre en 2008. A<br />
l’initiative du MINA<strong>DE</strong>R, et avec la collaboration des OP, des réflexions sont en cours sur la place et le<br />
rôle du conseil agricole dans les politiques agricoles (MINA<strong>DE</strong>R et MINEPIA, 2007).<br />
1.2. Problème<br />
Sous l’impulsion des bailleurs de fonds parmi lesquels la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire<br />
International, l’Etat camerounais s’est désengagé de plusieurs fonctions d’appui à l’agriculture<br />
(approvisionnement en intrants et crédit) et a supprimé les subventions. Ce désengagement est dû à<br />
la chute des cours mondiaux des produits de rente couplée à la dévaluation du franc CFA en 1994.<br />
Ceci a donc causé une réduction de la production agricole et alimentaire, une augmentation de<br />
l’insécurité alimentaire et une augmentation de la pauvreté (Dipoko, 2001). Selon Faure et al. (2004),<br />
cette situation peut s’améliorer grâce à une modernisation de l’agriculture dite « traditionnelle ». Cette<br />
modernisation se fera, comme le précisent Daouda (2002), Djoukam (2003) et Havard et al. (2007),<br />
par une professionnalisation des agriculteurs.<br />
Kamajou (1985), pensait que la disponibilité du capital constituait un frein à la modernisation de<br />
l’agriculture (professionnalisation des agriculteurs). Or pour Fouda (2002), malgré l’émergence des<br />
Etablissements de Microfinance (EMF) au Cameroun qui mettent le capital à la disposition des<br />
paysans, plusieurs exploitations agricoles pratiquent encore l’agriculture traditionnelle. Des études<br />
Ngouambe Nestor, FASA, Mémoire Ingénieur Agronome page 2