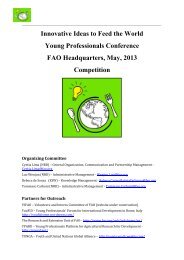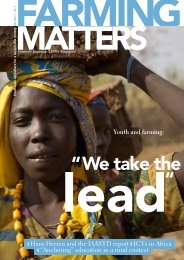UNIVERSITE DE DSCHANG - YPARD
UNIVERSITE DE DSCHANG - YPARD
UNIVERSITE DE DSCHANG - YPARD
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Selon Fouda (1998), l’évaluation est une attitude permanente de questionnement, une attitude critique<br />
d’analyse, une dynamique, un outil de gestion, un temps d’arrêt pour réfléchir et faire le bilan. Ainsi,<br />
l’évaluation consiste en un rapprochement des objectifs prévisionnels aux réalisations par la mesure<br />
des écarts et une identification des obstacles ayant empêché la réalisation des objectifs prévisionnels.<br />
Le même auteur précise que bien que souvent perçue comme un contrôle suivi de sanction,<br />
l’évaluation a une dimension pédagogique qui conditionne l’apprentissage de leçon et le choix des<br />
orientations futures. Or Girardin (2007) pense plutôt que l’évaluation n’est pas un contrôle. Car selon<br />
le même auteur, un contrôle est une vérification de l’application d’un règlement, du respect des<br />
cahiers de charges ou de justification d’une subvention.<br />
Patton (1982), précise que le concept d’évaluation avait été initié en 1960 par les bailleurs de fonds<br />
américains en vue de s’assurer l’utilisation efficace et efficiente des fonds investis dans les projets de<br />
développement. Afin de mieux apprécier une évaluation, il est important de préciser les indicateurs ou<br />
critères d’évaluation (Patton, 1982, Fouda, 1998 et Girardin, 2007). Pour Girardin (2007), un<br />
indicateur est « une variable qui fournit des renseignements au sujet d’un système complexe en vue<br />
de faciliter sa compréhension aux utilisateurs de sorte qu’ils puissent prendre des décisions<br />
appropriées qui mènent à la réalisation des objectifs ». Fouda (1998), indique que les critères<br />
d’évaluation des projets et des programmes couramment utilisés sont :<br />
- l’efficacité qui consiste à comparer les objectifs aux résultats ;<br />
- l’efficience qui permet de mesurer les ressources utilisées pour la réalisation des objectifs. C’est<br />
l’analyse coût-bénéfice ;<br />
- l’impact qui relève d’un ensemble d’effets sur l’environnement au sens large (technique,<br />
économique, social, culturel, écologique etc.…) ;<br />
- la viabilité qui réfère à une estimation des chances de survie c'est-à-dire la capacité de poursuivre<br />
les activités ou les actions ;<br />
- la participation des bénéficiaires qui représente l’implication de ces derniers et leur appropriation<br />
de la stratégie d’intervention.<br />
2.2.8. Mesure des effets et d’impact du conseil<br />
Les effets du conseil permettent d’apprécier les premiers changements (court et moyen termes) chez<br />
les bénéficiaires, par exemple l’amélioration de la gestion des facteurs (optimisation des ressources)<br />
de production et la prise de décision, l’augmentation du revenu (Miste, 2008). L’impact du conseil<br />
quant à lui permet d’apprécier les conséquences à long terme de la mise en œuvre du CEF. Misté<br />
(2008), souligne que ces changements de long terme se traduisent par une croissance pro-pauvre.<br />
Havard précise six critères de mesure d’effet et d’impact du CEF :<br />
1. Prise de décision (Niveau de centralisation, Niveau de contrôle, Capacité de réaction)<br />
2. Gestion (Niveau d’enregistrement, Niveau de prévision, Niveau d’analyse par rapport à la gestion<br />
du stock vivrier, la gestion de la trésorerie, le plan de campagne/déroulement des opérations,<br />
l’organisation du travail sur l’exploitation, les résultats technico-économiques..)<br />
3. Capacité d’innovation (innovation technique) tel que amélioration des pratiques<br />
4. Performances technico-économiques qui permettent évaluer critères 1, 2 et 3 notamment les<br />
rendements, les recettes, les dépenses, les résultats par rapport aux coûts<br />
- en rapport à une année de référence<br />
- en rapport à une innovation technique<br />
- en rapport à une prise de décision liée à un changement de structure : investissement,<br />
capitalisation élevage, accroissement des superficies…<br />
5. Diffusion du conseil (circulation de l’information, transfert de connaissances, transfert de<br />
pratiques en matière de gestion ou d’innovations techniques)<br />
6. Capacités d’appropriation de la démarche (expression des besoins et évolution, évolution du<br />
type de conseil, capacités d’innovation, de diffusion)<br />
Ngouambe Nestor, FASA, Mémoire Ingénieur Agronome page 14